|

| ||||
| |||||
|
Mercredi 1er Avril - Départ vers le nord:
1 -
D'abord DALI et ses
environs
![]()
![]()
![]() Pour cette boucle dans le nord, changement d'autocar (marque chinoise Higer)
encore plus spacieux (41 places) et aussi de chauffeur.
Pour cette boucle dans le nord, changement d'autocar (marque chinoise Higer)
encore plus spacieux (41 places) et aussi de chauffeur.
8H30, après une nuit passée à Kunming à la fin de notre petite boucle dans le sud, départ
vers le nord, ou plus exactement le nord-ouest...
350km au menu. Pas très drôle...
Nos laissons derrière nous la banlieue de Kunming, le lac Dian, les Monts de
l'Ouest et ses autoroutes-ponts au bord desquels des travailleurs attendent leur
embauche. Pour notre distraction et notre culture,
Delphine
nous montre des
billets de très petite valeur que nous n'avons guère de chance de nous faire
remettre par les commerçants. Leur intérêt, c'est qu'ils sont à l'effigie
d'ethnies. La plus petite coupure de 1 Jiao vaut 1/10e de Yuan. La seconde de 5
Jiao vaut donc 1/2 Yuan. La plus petite monnaie est une pièce de 5 Fen (soit
0,005¥).
![]() Des grandes zones d'industries chimiques voisinent avec des cultures maraichères
et des serres-tunnels. Puis ce sont des hameaux, des paysages de vallées
et de collines dont les terrasses portent des céréales dont le murissement est
en cours comme le révèle leur jaunissement. Dans certains endroits, seules les
vallées sont cultivées tandis que les collines sont boisées. Petits villages
avec parfois une mosquée. Bien sûr, l'infrastructure autoroutière est toujours
exceptionnelle bien que sinueuse surtout si l'on considère la maigreur du
trafic.
Des grandes zones d'industries chimiques voisinent avec des cultures maraichères
et des serres-tunnels. Puis ce sont des hameaux, des paysages de vallées
et de collines dont les terrasses portent des céréales dont le murissement est
en cours comme le révèle leur jaunissement. Dans certains endroits, seules les
vallées sont cultivées tandis que les collines sont boisées. Petits villages
avec parfois une mosquée. Bien sûr, l'infrastructure autoroutière est toujours
exceptionnelle bien que sinueuse surtout si l'on considère la maigreur du
trafic.
Nous roulons depuis deux heures et
Delphine nous fait remarquer que dans la
région de Chuxiong (150 000 hab.) où nous sommes maintenant les maisons
des Bai et des Yi sont chaulées et ornées de dessins circulaires ou de
diagrammes animistes. A 11H, petite pause d'un quart d'heure dans une aire de
service d'où la vue porte sur un temple et une pagode (à 9 toits) construits au
sommet d'une colline. Plus nous progressons, plus les champs de céréales
semblent proches de la moisson, avec parfois un dégradé de couleurs allant du
vert tendre au blond doré dans un même vallon. Au bord des champs on peut
voir d'étranges grosses fleurs jaunes poussant au sommet d'un tronc bas. Ce sont
des Lotus d'Or dits aussi Bananiers des Neiges (ils résistent à -10°) ou Ananas du
Yunnan (Musella lasiocarpa). C'est une espèce de bananier semi nain qui
ne dépasse pas 1,50 mètre de haut.
![]()

![]()
![]() Puis
arrive l'un des ratages de notre voyage.
Puis
arrive l'un des ratages de notre voyage.
Nous quittons l'autoroute vers midi et
quart pour partir à la quête du village de Yunnanyi.
Ni
Delphine, ni le
chauffeur n'y sont encore allé. Le réceptif qui les emploie ne leur a donné
aucune indication. Les cartes routières à leur disposition sont-elles à ce point
déficientes? Pourtant, avec GoogleMap ou avec OpenStreetMap, on arrive à le situer
exactement (25° 26'0" N 100° 42'0" E), non loin de Xiangyun qui figure sur la
carte touristique que l'on nous a remise au début du voyage... Nous avons bien
quitté la G56 pour la G320 qui nous fait traverser une zone de hameaux
campagnards et au bout d'une douzaine de kilomètres, nous aurions dû atteindre
notre objectif. Nous passons près de tombes Han puis peu après la localité de Laozhangying, nous passons au-dessus de l'autoroute et nous trouvons en surplomb
d'une batterie de séchoirs à céréales. Nous restons sur la route G320 et
au bout d'un moment, nous revenons sur nos pas, bredouilles, nous nous bornons à
participer avec notre autocar au battage de la moisson étalée sur la route. Nous
croisons une voiture transportant des jeunes mariés et, un instant plus tard,
des hommes transportant des couronnes funéraires.
Delphine n'arrive pas à se
faire renseigner correctement par les villageois.
Dommage! Alors que le vieux
village que nous cherchions se trouve juste à l'écart, au sud de la route neuve.

![]() Pour que
le ratage de cette journée soit presque complet,
Delphine
nous fait revenir sur
l'autoroute et nous fait déjeuner dans un restoroute sur une aire de service.
Immense salle et sale, self-service mais comme il est déjà beaucoup de plats ne
sont plus ravitaillés... Trois quarts d'heure suffisent donc!
Pour que
le ratage de cette journée soit presque complet,
Delphine
nous fait revenir sur
l'autoroute et nous fait déjeuner dans un restoroute sur une aire de service.
Immense salle et sale, self-service mais comme il est déjà beaucoup de plats ne
sont plus ravitaillés... Trois quarts d'heure suffisent donc!![]()
Arrivée à DALI: la ville, ses rues, le musée, l'église...![]()
![]() Nous
n'étions plus qu'à 50km environ de Dali où nous arriverons peu après 15H30. Un
peu avant, une monumentale bouteille d'alcool He Qing Gan se dresse au
bord de la route avant d'arriver à Xiaguan, les faubourgs modernes au sud du Lac Erhai.
Au plus chaud de l ajournée d'aujourd'hui les prévisions donnaient 27° mais la
météo doit se dégrader et dès que le ciel se couvre, un vent bien frais se lève.
Certes nous sommes sous le tropique du Cancer mais en altitude! Les tenues pelures d'oignons (dont une pelure imperméable) s'imposent ici.
Nous
n'étions plus qu'à 50km environ de Dali où nous arriverons peu après 15H30. Un
peu avant, une monumentale bouteille d'alcool He Qing Gan se dresse au
bord de la route avant d'arriver à Xiaguan, les faubourgs modernes au sud du Lac Erhai.
Au plus chaud de l ajournée d'aujourd'hui les prévisions donnaient 27° mais la
météo doit se dégrader et dès que le ciel se couvre, un vent bien frais se lève.
Certes nous sommes sous le tropique du Cancer mais en altitude! Les tenues pelures d'oignons (dont une pelure imperméable) s'imposent ici.
La ville de Dali se trouve à 1984 mètres d'altitude, sur les rives du lac Erhai, au pied des monts Diancangshan qui culminent à 4120 mètres. La région bénéficie d’un climat subtropical tempéré. La population (légère majorité chinoise Han et un tiers de Bai) est passé de 500 000 habitants en 1999 à 650 000 en 2010. La ville était jadis ceinte de murailles sur un périmètre de 6km, avec 7,50m. de haut et 6m. d'épaisseur, dont ne subsistent que les portes situées au nord et au sud. La ville de Dali est aussi réputée pour les nombreux marbres qu'elle produit et qui servent soit de matériau de construction soit pour fabriquer des objets d'art. De fait, ces marbres sont si célèbres que le mot marbre se dit littéralement en chinois "pierre de Dali".
La
circulation automobile dans la ville ancienne est interdite. Nous allons y pénétrer par la Porte Sud (précisément orientée au sud-sud-est)
datant du XVe siècle et restaurée en 1982.
C’est un portail chinois percé dans la muraille crénelée, surmonté d’un pavillon
à double toiture recourbée. Nous constatons rapidement que le plan de la ville
est de type damier.
| ||||
Présentation générale et historique de Dali par le Petit Futé:
«Dali est resté le sanctuaire des populations Bai, et les célèbres Trois Pagodes à 1km plus au nord attestent de leur passé glorieux. C’est une "Chine millénaire" qui semble figée dans le passé, les quelques hameaux avoisinants semblent sortir tout droit du Moyen Age. Entre la ville et le lac s’étendent les rizières où on laboure toujours à l’aide de buffles et où canards et oies pataugent dans les mares. La ville elle-même, bien ramassée à l’intérieur de ses murailles (qui l’entourent toujours sur trois côtés), se visite facilement à pied. Comme toutes les vieilles villes fortifiées, Dali est divisée par des rues qui se coupent à angle droit, et dont les principales sont la Fuxing Lu (qui va de la porte sud à la porte nord) et la Huguo Lu (la rue des cafés). Il faut juste une petite demi-heure pour aller de la porte sud à la porte nord à pied. Il n’y a pratiquement pas de constructions modernes, seulement de vieilles maisons basses avec des fenêtres à petits carreaux et des galeries en bois couvertes au premier étage (avec un vague air tibétain mâtiné d’isba russe) ou en pisé blanchi à la chaux avec un motif noir et blanc peint sur le faîtage sous le toit cornu à la chinoise. Dans la partie sud, vers les rizières, quelques anciennes maisons de maître sont regroupées autour d’une cour carrée et enfermées derrière de hauts murs protecteurs percés d’un portail (sur la Xinmin Lu). Partout dans la ville, on entend les grelots des clochettes des petits chevaux qui trottinent en tirant de grosses charges ou des charrettes transformées en sièges pour touristes. Des motoculteurs transportant des choux dans leur remorque et crachant des fumées noirâtres passent sans cesse dans les petites rues, même en centre-ville. L’air cristallin et pur de ces montagnes serait si merveilleux, sans cela... Dali est peuplée d’une vingtaine de minorités ethniques. Outre les Bai, qui constituent la communauté la plus fournie, on recense aussi des Yi, Hui, Lisu, Naxi et Tibétains. Dans les rues, on voit encore de nombreuses vieilles femmes en costume traditionnel Bai bleu et noir, mais aussi de jeunes Yi habillées en blanc, rose et rouge, des femmes au visage tanné descendues des montagnes environnantes avec de superbes corsages rouges et verts, brodés et serrés dans de multiples ceintures en tissu retenant de petits tabliers superposés sur leur pantalon. Sur le dos, elles portent soit une hotte en bambou, soit leur bambin dans de superbes porte-bébés très ouvragés.
Les premiers Bai se sont établis dans les régions du lac Erhai depuis 3000 ans. L’actuelle petite ville de Dali fut jadis la capitale du puissant royaume de Nanzhao, fondé au VIIIe siècle. Il fut suivi du royaume de Dali qui perdura de 938 à 1254. Au déclin de la dynastie Song du Nord et du Sud (960-1279), des hordes barbares composées de Tartares et de Mongols déferlèrent sur la Chine. Gengis Khan mit à sac Pékin en 1215. Les Mongols conquirent le Nord en 1234, puis envahirent la Chine du Sud et le Yunnan, les derniers refuges des Song. Ils imposèrent aussi leur suzeraineté au Tibet. En 1279, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilay Khan, fonda la dynastie Yuan (1279-1368) et prit pour capitale Pékin. C’est également l’époque des voyages de Marco Polo en Chine (1271-1295). Le royaume de Dali, défait par l’avancée des Mongols, éclata en une multitude de petits groupes ethniques. »
[...]
Dali a également été le centre de la révolte du sultan Du Wenxiu contre la dynastie Qing. Cette révolte, connue en chinois sous le nom de Du Wenxiu Qiyi, a duré de 1856 à 1873.
[...]
Ces "minorités nationales", comme on les appelle aujourd’hui, furent particulièrement brimées lors de la Révolution culturelle dans les années 1960. Le développement touristique pose aujourd’hui la question de la préservation de ces cultures ancestrales, mais largement menacées.
[...]
«Dali a l’honneur de figurer parmi les plus belles villes médiévales de Chine. Visiter la cité fortifiée fait partie des incontournables pour les touristes chinois depuis des années. Profitant de quelques jours de congés, certains n’hésitent pas à traverser tout le pays pour rester même 48 heures au coeur des remparts de Dali. En réalité, avec le développement soutenu du tourisme domestique, la ville de Dali a de plus en plus la fâcheuse tendance à se transformer en sorte de parc d’attractions. A l’image de Lijiang, les ruelles de la ville sont prises d’assaut à toute heure de la journée par des hordes de touristes bruyants qui s’entassent dans les boutiques de souvenirs. La rue principale, charmante au demeurant, n’est guère plus qu’une longue galerie commerçante où échoppes et restaurants se succèdent les uns après les autres. Même si la ville est jolie et mérite d’être vue, elle risque cependant de faire rapidement fuir les visiteurs en quête de sérénité et d’authenticité. Après une rapide découverte, nous vous conseillons de sortir de la vieille Dali et de visiter les environs du lac Erhai, qui ne manqueront pas de vous surprendre par leur incroyable beauté. Enfin, si elle ne présente aucun intérêt particulier, Xiaguan, la ville moderne autour des gares ferroviaire et routière traitée dans ces pages, est étonnement agréable et très propre (pour une ville chinoise de cette taille), et témoigne des dividendes de l’activité liée au tourisme.»
![]()
![]() Nous sommes immergés dans une cohue de touriste chinois dans la rue
Fuxing
bordées d'échoppes à souvenirs qui se sont installées dans les anciennes
maisons. Le tourisme a fait la fortune de leurs propriétaires qui vivent en
dehors dans des maisons confortables grâce aux rentes qu'ils perçoivent en
échange de la location aux commerçants.
Nous sommes immergés dans une cohue de touriste chinois dans la rue
Fuxing
bordées d'échoppes à souvenirs qui se sont installées dans les anciennes
maisons. Le tourisme a fait la fortune de leurs propriétaires qui vivent en
dehors dans des maisons confortables grâce aux rentes qu'ils perçoivent en
échange de la location aux commerçants.
Bientôt nous arrivons à la Tour Wuhua, le monument central de la vieille ville.
![]() Nous arrivons bientôt devant un monument commémoratif de la guerre avec un
soldat tout doré avant d'entrer au Musée Bai installé dans l'ancienne résidence du
sultan Du Wenxiu et présentant de nombreux bronzes du royaume de Dali, datant de
l'époque des Song. Nous jouons de malchance, il y a des jours comme cela. En
effet, la salle principale est fermée non pas à cause de l'heure (il est 16H15)
mais pour travaux. Nous profiterons du jardin qui abrite une belle forêt de
stèles et quelques vieilles pierres tombales.
Nous arrivons bientôt devant un monument commémoratif de la guerre avec un
soldat tout doré avant d'entrer au Musée Bai installé dans l'ancienne résidence du
sultan Du Wenxiu et présentant de nombreux bronzes du royaume de Dali, datant de
l'époque des Song. Nous jouons de malchance, il y a des jours comme cela. En
effet, la salle principale est fermée non pas à cause de l'heure (il est 16H15)
mais pour travaux. Nous profiterons du jardin qui abrite une belle forêt de
stèles et quelques vieilles pierres tombales.
![]()
![]() Nous
revenons sur nos pas par la rue Fuxing et croisant les écoliers en uniformes qui
rentrent chez eux et aussi des femmes en costume traditionnel bleu et portant une hotte de bambou sur le dos.
Nous passons le carrefour avec la rue Huguo surnommée rue des Etrangers (Yangren
Jie) depuis l'afflux des routards dans la ville. Tandis que sur la rue
Fuxing nous avons en perspective la Tour Wuhua, à son intersection avec le
carrefour avec la rue Renmin (rue du Peuple), nous tournons à gauche (direction
est).
Nous
revenons sur nos pas par la rue Fuxing et croisant les écoliers en uniformes qui
rentrent chez eux et aussi des femmes en costume traditionnel bleu et portant une hotte de bambou sur le dos.
Nous passons le carrefour avec la rue Huguo surnommée rue des Etrangers (Yangren
Jie) depuis l'afflux des routards dans la ville. Tandis que sur la rue
Fuxing nous avons en perspective la Tour Wuhua, à son intersection avec le
carrefour avec la rue Renmin (rue du Peuple), nous tournons à gauche (direction
est).

![]() Le temps se fait très menaçant et nous perdons Chantal allée acheter un
parapluie car nous avons tourné rapidement dans une ruelle sur la droite pour aller
visiter l'église catholique. Dans la ruelle, on aperçoit un peu plus loin dans la
ruelle l'entrée d'un collège catholique. Personne ne reste au carrefour pour l'orienter et
le panonceau signalant l'église est peu visible. L’église construite en 1927
témoigne du passé colonial de la ville en mêlant les styles architecturaux avec
une apparence extérieure. Ce sont d’anciens missionnaires français qui ont érigé le bâtiment
si l'on excepte une croix qui la surmonte. Ce sont d’anciens missionnaires
français qui ont érigé le bâtiment. L'intérieur de l'édifice tout peint en bleu
est très sobre. Quatre religieuses sont en prière. Un coup d'oeil au Missel,
tout en chinois, avec comme il se droit l'écriture en colonne de haut en bas et
de droite à gauche et donc un livre qui se lit "en commençant par la fin" en se
basant sur nos critères! Le presbytère et le logement des religieuses se trouvent
tout à côté de l'église.
Le temps se fait très menaçant et nous perdons Chantal allée acheter un
parapluie car nous avons tourné rapidement dans une ruelle sur la droite pour aller
visiter l'église catholique. Dans la ruelle, on aperçoit un peu plus loin dans la
ruelle l'entrée d'un collège catholique. Personne ne reste au carrefour pour l'orienter et
le panonceau signalant l'église est peu visible. L’église construite en 1927
témoigne du passé colonial de la ville en mêlant les styles architecturaux avec
une apparence extérieure. Ce sont d’anciens missionnaires français qui ont érigé le bâtiment
si l'on excepte une croix qui la surmonte. Ce sont d’anciens missionnaires
français qui ont érigé le bâtiment. L'intérieur de l'édifice tout peint en bleu
est très sobre. Quatre religieuses sont en prière. Un coup d'oeil au Missel,
tout en chinois, avec comme il se droit l'écriture en colonne de haut en bas et
de droite à gauche et donc un livre qui se lit "en commençant par la fin" en se
basant sur nos critères! Le presbytère et le logement des religieuses se trouvent
tout à côté de l'église.
La critique du Petit Futé à propos de cet hôtel est particulièrement élogieuse:
«Sans doute le plus bel hôtel de la vieille ville de Dali. Idéalement situé en plein centre mais donnant sur une rue calme, ce complexe de plusieurs bâtiments qui appartient à un propriétaire local est décoré avec goût. Prestations et confort excellents. Bon restaurant, café, bibliothèque (très réussie), espaces extérieurs : l’endroit idéal où se reposer quelques jours. Les prix sont très corrects pour le standing.»
![]() En attendant le
dîner, nous faisons un tour en ville en profitant du fait que l'affluence a
diminué, ce qui va de pair avec la fermeture de nombreuses échoppes. Nous
remontons la rue Huguo, autrement appelée rue des Etrangers en passant sous les
arches pareillement nommées avant de continuer l'exploration de cette rue et des
rues Renmin et Fuxing. Certaines activités continuent encore comme les batteurs
de "nougatine" (farine d'orge, cacahuètes et sésame). Exploration que nous poursuivrons le lendemain matin,
avant le départ des visites, et le soir, au retour.
En attendant le
dîner, nous faisons un tour en ville en profitant du fait que l'affluence a
diminué, ce qui va de pair avec la fermeture de nombreuses échoppes. Nous
remontons la rue Huguo, autrement appelée rue des Etrangers en passant sous les
arches pareillement nommées avant de continuer l'exploration de cette rue et des
rues Renmin et Fuxing. Certaines activités continuent encore comme les batteurs
de "nougatine" (farine d'orge, cacahuètes et sésame). Exploration que nous poursuivrons le lendemain matin,
avant le départ des visites, et le soir, au retour.
![]()
![]() Après
avoir laissé percevoir une critique sur le restaurant de l'hôtel Landscape ,
Delphine
finit
pourtant par nous y installer après avoir renoncé à nos emmener dîner en ville.
Grande salle d'assez belle apparence pour groupes de touristes et pourtant au
milieu du repas, certains ont la désagréable surprise de voir trois rats dodus
aller se réfugier sous l'une des nombreuses tables inoccupées dont les nappes
tombent jusqu'au sol... Et c'est un hôtel classé "luxe" mais ce genre
de scène a échappé aux testeurs du Petit Futé!
Après
avoir laissé percevoir une critique sur le restaurant de l'hôtel Landscape ,
Delphine
finit
pourtant par nous y installer après avoir renoncé à nos emmener dîner en ville.
Grande salle d'assez belle apparence pour groupes de touristes et pourtant au
milieu du repas, certains ont la désagréable surprise de voir trois rats dodus
aller se réfugier sous l'une des nombreuses tables inoccupées dont les nappes
tombent jusqu'au sol... Et c'est un hôtel classé "luxe" mais ce genre
de scène a échappé aux testeurs du Petit Futé!![]()
Jeudi 2 Avril
- aux environs de DALI
![]() Départ en autocar dès 8H car de nombreuses visites sont au programme. Le temps
est annoncé comme devant être changeant.
Départ en autocar dès 8H car de nombreuses visites sont au programme. Le temps
est annoncé comme devant être changeant.
Village de XIZHOU: le marché et la Résidence du Clan Yan
Xizhou se trouve à une quinzaine de
kilomètres de Dali. Dans cette bourgade de 30 000 habitants principalement
de l'ethnie Bai, on a peine à
imaginer que ce fut la capitale impériale du puissant royaume de Nanzhao. De son
prestigieux passé, elle a conservé une riche architecture, jusqu’à
présent bien préservée. Les étroites
rues pavées sont bordées de maisons anciennes en bois, aux murs extérieurs blancs et
aux portes imposantes notamment sur la rue principale, dans laquelle se tient le
marché. 200 maisons privées cotées datent de la dynastie des Qing. Cette
petite ville a servi de refuge à de nombreux intellectuels chinois lors de
l’invasion japonaise.
De retour sur la place centrale où
débute le marché, on peut voir un portail imposant qui est celui de la maison du
Clan ou de la Famille Yan construite autour des années 1920. Nous allons
consacrer trois petits quarts d'heure à sa visite.
Le Petit Futé résume bien cette visite en ces termes:
Il est 11H45 et des cochers avec leur
carriole nous attendent sur la place.
![]()
![]()

![]()
 Nous commençons par faire un tour dans le marché de Xizhou. Un marché vivant où
l'on trouve des produits alimentaires bruts, de la viande, des thés, du vin de
rose, de petits pains de sucre brun, des articles ménagers (balais)... mais où
l'on peut manger sur le pouce, des galettes garnies au choix en salé ou en
sucré. Les femmes Bai y circulent avec leur hotte. On peut aussi y voir de
grandes jarres contenant du "vin de roses". Les vins de fruits sont les boissons
alcoolisées fermentées faites à partir de fruits ou de végétaux autres que des
raisins comme les pétales de roses, ici au Yunnan. Il faut préciser que les
roses sont originaires de Chine et elles sont arrivées en Occident par la Perse
et par les échanges avec les Arabes.
Nous commençons par faire un tour dans le marché de Xizhou. Un marché vivant où
l'on trouve des produits alimentaires bruts, de la viande, des thés, du vin de
rose, de petits pains de sucre brun, des articles ménagers (balais)... mais où
l'on peut manger sur le pouce, des galettes garnies au choix en salé ou en
sucré. Les femmes Bai y circulent avec leur hotte. On peut aussi y voir de
grandes jarres contenant du "vin de roses". Les vins de fruits sont les boissons
alcoolisées fermentées faites à partir de fruits ou de végétaux autres que des
raisins comme les pétales de roses, ici au Yunnan. Il faut préciser que les
roses sont originaires de Chine et elles sont arrivées en Occident par la Perse
et par les échanges avec les Arabes.
Moins gai et néanmoins coloré, on peut voir des boutiques faisant le commerce
d'articles funéraires: couronnes, cercueils.
![]()
![]() Sous la conduite de
Delphine, nous gagnons un quartier plus calme où nous
rencontrons des jeunes
très décontractés qui ont cour de dessin sur le thème de l'architecture
traditionnelle se sont ici pour croquer le portail d'entrée d'une vieille
demeure. Il s'agit de l'atelier de broderie sur soie Linden Center
(autrefois Yang Pinxiang). Au XIXe s. un fils de la riche famille
Yan (dont nous allons perler plus loin) qui prospérait dans le commerce du thé avait
épousé une fille de ces
brodeurs. La maison est bien modeste par rapport à la résidence des Yan que nous
visiterons plus tard. Ici, on peut voir de curieux panneaux peints il y a un siècle
représentant les chemins de fer, un aéroplane ou une usine d'où s'échappe un
panache de fumée.
Sous la conduite de
Delphine, nous gagnons un quartier plus calme où nous
rencontrons des jeunes
très décontractés qui ont cour de dessin sur le thème de l'architecture
traditionnelle se sont ici pour croquer le portail d'entrée d'une vieille
demeure. Il s'agit de l'atelier de broderie sur soie Linden Center
(autrefois Yang Pinxiang). Au XIXe s. un fils de la riche famille
Yan (dont nous allons perler plus loin) qui prospérait dans le commerce du thé avait
épousé une fille de ces
brodeurs. La maison est bien modeste par rapport à la résidence des Yan que nous
visiterons plus tard. Ici, on peut voir de curieux panneaux peints il y a un siècle
représentant les chemins de fer, un aéroplane ou une usine d'où s'échappe un
panache de fumée.
![]() Le travail de broderie sur soie auquel se livrent de jeunes femmes penchées sur
leur ouvrage laisse toujours admiratif. Et que dire des extraordinaires
broderies double face. On croirait vraiment voir des tableaux peints tant les
point sont d'une grande finesse.
Ce qui en explique le prix: 400 Yuans pour un tout petit tableau simple face,
550 s'il est encadré...
Le travail de broderie sur soie auquel se livrent de jeunes femmes penchées sur
leur ouvrage laisse toujours admiratif. Et que dire des extraordinaires
broderies double face. On croirait vraiment voir des tableaux peints tant les
point sont d'une grande finesse.
Ce qui en explique le prix: 400 Yuans pour un tout petit tableau simple face,
550 s'il est encadré...
«Cette
grande bâtisse traditionnelle est composée d’une enfilade de quatre cours
richement décorées et ornées de bois sculptés. De la dernière cour, prenez le
passage au fond à gauche pour atteindre le "bâtiment occidental". Construit en
1936, il est un hommage du fils Yan à l’architecture européenne qu’il avait
découverte à Shanghai. La terrasse au dernier étage de ce bâtiment offre une
belle vue sur les toits de Xizhou, le lac Erhai et les monts Cang.[...].»
![]()
![]() En parcourant les différentes cours disposées sur une superficie d'un peu plus
de 3000 mètres carrés (0,76 acres), les pièces du bas ou de l'étage, on découvre
toujours quelque chose ou bien l'on voit les cours sous de nouveaux angles. Chacune
des cours est entourée de quatre maisons avec quatre petites pièces construites
entre chacune des maisons. Ce style architectural unique est appelé "wutianjing
Sihe".
En parcourant les différentes cours disposées sur une superficie d'un peu plus
de 3000 mètres carrés (0,76 acres), les pièces du bas ou de l'étage, on découvre
toujours quelque chose ou bien l'on voit les cours sous de nouveaux angles. Chacune
des cours est entourée de quatre maisons avec quatre petites pièces construites
entre chacune des maisons. Ce style architectural unique est appelé "wutianjing
Sihe".
Au début du parcours, la statue d'un petit cheval sellé portant des
sacoches de cuir rappelle que c'était ainsi que de caravanes transportaient le
thé vers le Tibet.
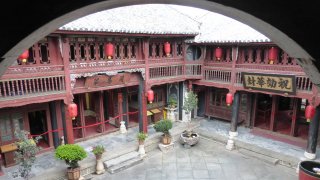
![]() En entrant, les yeux tomberont sur la maison principale avec son mur d'écran et
deux ailes. Selon la tradition de l'architecture de style Bai, le mur de l'écran
doit faire face à l'est afin de réfléchir la lumière du soleil dans les pièces intérieures
tôt le matin. En outre, le mur de l'écran,
orné de peintures et de calligraphie élaborée, est considéré comme un talisman
qui donne la chance.
En entrant, les yeux tomberont sur la maison principale avec son mur d'écran et
deux ailes. Selon la tradition de l'architecture de style Bai, le mur de l'écran
doit faire face à l'est afin de réfléchir la lumière du soleil dans les pièces intérieures
tôt le matin. En outre, le mur de l'écran,
orné de peintures et de calligraphie élaborée, est considéré comme un talisman
qui donne la chance.
La maison de style occidental que l'on peut voir en fin de parcours est celle
qu'un fils du clan a fait bâtir pour son épouse occidentale mais pour l'isoler
du monde, un mur écran plus haut que de coutume masque la vue depuis les
fenêtres orientées à l'est.
On n'aura pas le temps d'y voir la cérémonie du thé, Sandaocha. Selon la
tradition régionale on y goûte trois saveurs de thé. On commence par
présenter un thé amer pour la jeunesse qui va affronter les difficultés dans la
vie. Ensuite, un thé sucré au sésame et aux noix qui symbolise le bonheur de la
vie adulte. Enfin, un thé amer, sucré, épicé qui symbolique la vieillesse et
fait réfléchir vie.![]()
Village de SHACUN: la pêche au cormoran sur le Lac Erhai
![]()
![]() Au trot, en un quart d'heure, les petits chevaux nous
conduisent en carriole à l'embarcadère sur le rivage du Lac Erhai
distant de 3km, du côté du village de Shacun. C'est une jolie promenade pendant
laquelle nous croisons de jeunes mariés (mariée en robe blanche), nous repassons
devant l'atelier Linden Center puis les derniers faubourgs cèdent la place aux
champs.
Au trot, en un quart d'heure, les petits chevaux nous
conduisent en carriole à l'embarcadère sur le rivage du Lac Erhai
distant de 3km, du côté du village de Shacun. C'est une jolie promenade pendant
laquelle nous croisons de jeunes mariés (mariée en robe blanche), nous repassons
devant l'atelier Linden Center puis les derniers faubourgs cèdent la place aux
champs.
Nous arrivons à l'embarcadère où nous sommes accueillis en musique par de jeunes
Bai en costumes de fête.
![]()
Delphine nous décrit la coiffe traditionnelle des
femmes Bai de la région de Dali qui symbolise les quatre beautés de la
Nature (le vent, la fleur, la neige et la lune), une coiffe poétiquement
nommée "fleur dans le vent et lune de nuit neigeuse". Elles le nouent en forme
de croissant. La partie supérieure est blanche comme la neige, la partie avant
est ornée de broderies dont les motifs représentent des fleurs et le
reflet de la lune dans le lac. L’extrémité du foulard tombe sur les épaules sous
forme d'une queue blanche se balançant au gré du vent. Lorsque les femmes
sont mariées, cette queue est coupée au niveau du cou.
Quant à nous, munis de gilets de sauvetage et sous un
ciel très menaçant, nous embarquons pour une petite croisière sur le Lac Erhai,
magnifique plan d'eau de 250km² situé dans la vallée de Dali, au pied des
monts Cangshan (4092 mètres d'altitude) perdus dans les nuages gris sombre. Ce
lac est le deuxième plus grand lac du Yunnan après le lac Dian de Kunming
(300km²).
![]() Nous sommes répartis sur deux barques emmenant dix passagers et une rameuse pour
la nôtre, un rameur pour l'autre. Bientôt un bateau de pêcheur vient se placer
parallèlement à nous. Sur les bords de sa barque, une bonne douzaine de
cormorans sont prêts pour la démonstration de pêche aux cormorans, une technique
de pêche qui se pratique sur le lac Erhai dans la région de Dali depuis plus de
1000 ans. Seuls six pêcheurs du village sont autorisés à pratiquer cette pêche tout au
long de l'année, les autres ne pouvant la pratiquer que durant six mois.
Nous sommes répartis sur deux barques emmenant dix passagers et une rameuse pour
la nôtre, un rameur pour l'autre. Bientôt un bateau de pêcheur vient se placer
parallèlement à nous. Sur les bords de sa barque, une bonne douzaine de
cormorans sont prêts pour la démonstration de pêche aux cormorans, une technique
de pêche qui se pratique sur le lac Erhai dans la région de Dali depuis plus de
1000 ans. Seuls six pêcheurs du village sont autorisés à pratiquer cette pêche tout au
long de l'année, les autres ne pouvant la pratiquer que durant six mois.
![]() Les pêcheurs lancent bientôt les oiseaux qui ont vite fait de plonger. Certains
ont pris de gros poissons et en s'aidant d'une épuisette les pêcheurs récupèrent
ces bons éléments qui tiennent toujours leur proie mais ne peuvent pas la gober
car une cordelette passée autour de leur cou les empêchent de déglutir.
Les pêcheurs récupèrent les prises et récompensent l'oiseau. Puis les
cormorans prennent leur posture bien connue, ailes déployées afin de sécher leur
plumage qui n'est pas imperméable. Nous pourrions tenter de faire la même chose
car une partie de la démonstration s'est déroulée sous la pluie.
Les pêcheurs lancent bientôt les oiseaux qui ont vite fait de plonger. Certains
ont pris de gros poissons et en s'aidant d'une épuisette les pêcheurs récupèrent
ces bons éléments qui tiennent toujours leur proie mais ne peuvent pas la gober
car une cordelette passée autour de leur cou les empêchent de déglutir.
Les pêcheurs récupèrent les prises et récompensent l'oiseau. Puis les
cormorans prennent leur posture bien connue, ailes déployées afin de sécher leur
plumage qui n'est pas imperméable. Nous pourrions tenter de faire la même chose
car une partie de la démonstration s'est déroulée sous la pluie.

![]() Chemin inverse avec nos carrioles pour
revenir au centre de Xizhou afin de déjeuner "chez l'habitant" sur la grande
place, dans un tout petit restaurant ne disposant pas de toilettes. Bien avec,
outre le riz, seulement 8 plats dont des babas
("galettes joyeuses)", des galettes fourrées à la viande et
des galettes sucrées fourrée à la rose et aux haricots rouges. Tout cela arrosé
d'un vin de roses meiguilujiu ("la rosée de la rose"). Curieux...
Chemin inverse avec nos carrioles pour
revenir au centre de Xizhou afin de déjeuner "chez l'habitant" sur la grande
place, dans un tout petit restaurant ne disposant pas de toilettes. Bien avec,
outre le riz, seulement 8 plats dont des babas
("galettes joyeuses)", des galettes fourrées à la viande et
des galettes sucrées fourrée à la rose et aux haricots rouges. Tout cela arrosé
d'un vin de roses meiguilujiu ("la rosée de la rose"). Curieux...![]()
Le Petit Futé le décrit ainsi:
La technique du batik de Dali décrite par
le Petit Futé
semble quelque peu différer (toile de coton et feuille de plastique sont cousues ensemble):
Une voiturette électrique nous permet
d'arriver facilement au pavillon le plus haut de la série de temples construits
dans le joli parc, un parcours de plus de 2km mais montant avec des séries de
marches (356) pour les fidèles ou les touristes courageux. Evidemment, avec
cette façon de faire, il sera moins difficile pour nous de les descendre même si
l'on ne suit pas du tout la progression logique des fidèles.
Village de ZHOUCHENG: artisanat de batik![]() C'est en autocar
que nous nous rendons au village de Zhoucheng,
un endroit encore épargné par le tourisme de masse. Zhoucheng se situe
au-delà de Xizhou (à environ 8 km et donc à 23 km au nord de Dali). Avec
quelques 11 000 habitants (90% de Bai), c'est l’un des plus importants villages
Bai de la région.
C'est en autocar
que nous nous rendons au village de Zhoucheng,
un endroit encore épargné par le tourisme de masse. Zhoucheng se situe
au-delà de Xizhou (à environ 8 km et donc à 23 km au nord de Dali). Avec
quelques 11 000 habitants (90% de Bai), c'est l’un des plus importants villages
Bai de la région.
«Gardée par deux banians centenaires, la place principale possède un vieux décor
de théâtre traditionnel, où se tiennent quelques représentations en plein air.
Chaque jour, elle se remplit d’étals de fruits et légumes, de viandes et
d’artisanat local. Vous serez surpris de découvrir le stand d’un dentiste qui
s’occupe de vous soigner les dents au milieu des poules et des cochons. Remontez
dans le village vers la porte du temple de Longuan et vous verrez sur cette
seconde place, se retrouver tous les vieux du village qui discutent
tranquillement en attendant que le barbier s’occupe d’eux. Ce dernier installe
en fin de matinée sa chaise en bois et s’occupe de coiffer et tondre les
habitants du quartier. Les amateurs de batik pourront visiter quelques fabriques
disséminées un peu partout dans le village. Attention, on essayera bien
évidemment de vous faire partir avec de nombreux achats, donc n’oubliez pas de
négocier !»
![]() Pour notre part,
en ce milieu d'après-midi,
Delphine a choisi de nous conduire dans une
famille qui se livre à l'artisanat du batik. Nous allons y passer une bonne
demi-heure. Nous passons près de tombes Han dans un terrain voisin de
l'autoroute puis devant un champ où un groupe de paysans est afféré à la
récolte de l'ail.
Pour notre part,
en ce milieu d'après-midi,
Delphine a choisi de nous conduire dans une
famille qui se livre à l'artisanat du batik. Nous allons y passer une bonne
demi-heure. Nous passons près de tombes Han dans un terrain voisin de
l'autoroute puis devant un champ où un groupe de paysans est afféré à la
récolte de l'ail.
Pour les touristes, le souvenir typique de Dali c'est le batik, de
grandes étoles teintées en bleu sur tissu blanc.. Cette technique est
répandue dans toute l’Asie du Sud-Est et même en Asie du sud (Ceylan) mais
elle diffère par ses variantes pratiques.
Ici on n'emploie pas la cire pour masquer les parties qui ne doivent pas
prendre la teinture. Les motifs sont reportés sur une toile de coton grâce à
une feuille de plastique perforée. Comme une grand-mère septuagénaire le
fait à longueur de journée dans un coin de la cour, la toile est ensuite
cousue très serrée en fonction des motifs que l'on voudra préserver en
couleur claire. Après cela, ce bouchon de tissu apparemment informe est
plongé dans un bain de teinture d'indigo obtenue à partir des feuilles de
l'indigotier (Indigofera tinctoria), un arbuste des régions
chaudes de la famille des Fabacées dont le nom fait référence à l'Inde.
Après rinçage, dénouage et séchage, le tissu révèle ses jolis motifs
aux contours naturellement un peu flous.
![]()

![]() Les feuilles d'indigotier
contiennent seulement environ petite quantité du colorant (environ 2-4%). Un
grand nombre de plantes sont donc nécessaires pour produire une quantité
significative de colorant. Comme dans cet atelier artisanal, e procédé
traditionnel pour l'obtention du colorant passe par diverses étapes:
fermentation et hydrolyse, puis oxydation. La demande de l'indigo a
considérablement augmenté au cours de la Révolution Industrielle, en partie
en raison de la popularité de bleu jeans Levi Strauss et facilité par la
mise au point d'un procédé industriel de fabrication de l'indigo synthétique
dit bleu d'indanthrone découvert par Bayer en 1880 et commercialisé après
1900 par sa firme BASF.
Les feuilles d'indigotier
contiennent seulement environ petite quantité du colorant (environ 2-4%). Un
grand nombre de plantes sont donc nécessaires pour produire une quantité
significative de colorant. Comme dans cet atelier artisanal, e procédé
traditionnel pour l'obtention du colorant passe par diverses étapes:
fermentation et hydrolyse, puis oxydation. La demande de l'indigo a
considérablement augmenté au cours de la Révolution Industrielle, en partie
en raison de la popularité de bleu jeans Levi Strauss et facilité par la
mise au point d'un procédé industriel de fabrication de l'indigo synthétique
dit bleu d'indanthrone découvert par Bayer en 1880 et commercialisé après
1900 par sa firme BASF.
«A Dali, dans l’une de ses nombreuses
fabriques, les femmes prennent une toile de coton, puis elles cousent sur
celle-ci une toile en plastique qu’elles ont au préalable perforée afin que
l’encre passe et laisse des motifs. Une fois les deux toiles cousues, le tissu
est trempé dans un bain indigo. Le bain indigo est un colorant naturel obtenu
grâce aux feuilles de l’indigotier, un arbre que l’on trouve dans les régions
chaudes. Issu de la famille des fabacées, son nom provient du grec indikon qui
signifie "de l’Inde". Cultivé depuis des millénaires, lorsqu’il fut découvert
par les Européens, il fut très vite importé pour colorer des jeans par exemple.
L’arbre n’excède guère les 2 m de haut. Afin d’obtenir le bain indigo, il faut
au préalable laisser tremper les feuilles d’indigotier et attendre que le tout
fermente. Une fois la toile bien imprégnée de la teinture, elle est tendue sur
un fil afin de sécher. On retire délicatement la toile en plastique et le batik
si réputé de Dali apparaît ! Vous aurez le choix entre différents motifs.
Certains vendeurs proposent également des batiks d’autres couleurs, mais le bleu
indigo simple est celui typique de la région.
[...]
Les touristes se les arrachent ; attention, car certains vendeurs
annoncent des prix exorbitants. N’hésitez pas à diviser le prix par deux, voire
trois ! »![]()
Chongsheng Si ("le Temple de l'Admiration") et Santa si ("les Trois
Pagodes") ![]()
![]()
![]()
![]() A environ 20 kilomètres au sud de Zhoucheng, en revenant vers Dali, depuis
l'autoroute, malgré le temps maussade, l'attention est captée par les trois
pagodes qui émergent au pied de la montagne Cang Shan dont les 19 sommets
sont perdus dans de nuages sombres.
A environ 20 kilomètres au sud de Zhoucheng, en revenant vers Dali, depuis
l'autoroute, malgré le temps maussade, l'attention est captée par les trois
pagodes qui émergent au pied de la montagne Cang Shan dont les 19 sommets
sont perdus dans de nuages sombres. ![]()
![]()
![]() Ces
pagodes symbolisent la ville et
témoignent de l'art séculaire du travail du marbre blanc, couleur qui représente
aussi les Bai (bai signifie "blanc"). Elles ont été bâties lorsque les
souverains du Nanzhao adoptèrent le bouddhisme du Grand Véhicule (Mahayana).
Outre le marbre des sculptures, la structure utilise la brique recouverte d'un
enduit blanc. Elles comptent parmi les plus anciens édifices du sud-ouest
de la Chine.
Ces
pagodes symbolisent la ville et
témoignent de l'art séculaire du travail du marbre blanc, couleur qui représente
aussi les Bai (bai signifie "blanc"). Elles ont été bâties lorsque les
souverains du Nanzhao adoptèrent le bouddhisme du Grand Véhicule (Mahayana).
Outre le marbre des sculptures, la structure utilise la brique recouverte d'un
enduit blanc. Elles comptent parmi les plus anciens édifices du sud-ouest
de la Chine.
Qian Xun Ta, la plus haute pagode (70 m. ou 79 m.), à section carrée, avec 16 toits
et la plus ancienne (IXe s.) est un bel exemple de style Tang et rappelle l’art
des maîtres constructeurs de la grande pagode de l’Oie sauvage de Xi’an qui lui
est antérieure d'un siècle. Les deux autres, de part et d'autre de la grande,
sont moins hautes (42 m.) à section octogonale, avec 10 niveaux et ont été
construite au siècle suivant. La pagode la plus au sud penche vers le nord
depuis le tremblement de terre de 1997.
Contrairement à de nombreux autres sites religieux d'Asie (Vietnam, Japon,
Bali), elles se distinguent par leur nombre pair d'étages. Pour les croyants de
la religion bouddhiste dans le monde chinois, les pagodes sont des tours de
plusieurs étages circulaires, octogonales ou carrées, caractérisées par leur
toit évasé ou en épi transposant les stûpa ou zedi du monde indien.



Voici ce qu'en dit le Petit Futé:
«Les Trois Pagodes de Dali, les plus anciennes
structures du Yunnan, ayant résisté à plusieurs tremblements de terre, sont la
preuve tangible d’une brillante civilisation perdue. Ces trois tours à l’étrange
architecture, qui semble plus hindoue que chinoise, sont reconnaissables de
loin. Les Trois Pagodes ont été érigées sur l’emplacement de l’ancien temple Chongsheng, qui était le temple des familles royales durant la période du
royaume de Nanzhao et du royaume de Dali. La construction de la pagode
principale – la pagode des Mille Eveils – fut entreprise en 836, durant la
période Fengyou du royaume de Nanzhao, pour se terminer quarante ans plus tard.
A l’époque, elle comportait 11 400 statues en bronze du Bouddha. La pagode
principale se présente comme une tour de 16 étages de 69m. de haut. Son plan
carré est caractéristique du style de la dynastie des Tang, lors de laquelle le
bouddhisme venu d’Inde était à son apogée. Au milieu de la façade de chaque
étage s’ouvre une niche où est installée une statue de bouddha en marbre blanc.
Pendant la période du royaume de Dali, deux autres pagodes de dix étages furent
construites, l’une légèrement au nord de la principale, et l’autre au sud, afin
de former les trois points d’un triangle. Ces deux dernières pagodes mesurent
toutes deux 42m. de haut. Chaque étage est sculpté de niches, de bouddhas et de
fleurs de lotus. Au moment des travaux de restauration effectués en 1978-1980,
près de 700 reliques furent trouvées sous les pagodes et à l’intérieur des
sommets.»
![]() Une frustration: en principe les photos sont interdites à l'intérieur des
temples. Pour ma part, je considère qu'il est possible de ne pas trop nuire
à son karma en n'utilisant pas le flash et/ou en ne faisant des photos qu'en
l'absence de fidèles.
Une frustration: en principe les photos sont interdites à l'intérieur des
temples. Pour ma part, je considère qu'il est possible de ne pas trop nuire
à son karma en n'utilisant pas le flash et/ou en ne faisant des photos qu'en
l'absence de fidèles.
![]()
![]()
![]() Dans la partie haute, le Bouddha Gautama, "le parfait" est à
l'honneur, entouré de disciples devenus bodhisattvas. Plus bas, on rencontre le
Bouddha aux Mille Bras, Guanyin, la seule représentation féminine
vénérée dans le Bouddhisme. C'est un bodhisattva, c'est-à-dire qu'elle a obtenu
l'éveil mais elle n'a pas voulu accéder au rang de bouddha afin de
faire bénéficier de son enseignement les hommes. En Chine, même les taôistes la
considèrent comme la déesse de la miséricorde. En bas, les fidèles sont
accueillis par le jovial Maitreya , "le bouddha du futur" que les
Chinois nomme Milefo ou Bouddha de Mile. Tant le bouddhisme
Mahāyāna que
le Hīnayāna le considèrent comme le prochain bouddha. Les gardiens célestes ont
aussi une bonne place à ce niveau.
Dans la partie haute, le Bouddha Gautama, "le parfait" est à
l'honneur, entouré de disciples devenus bodhisattvas. Plus bas, on rencontre le
Bouddha aux Mille Bras, Guanyin, la seule représentation féminine
vénérée dans le Bouddhisme. C'est un bodhisattva, c'est-à-dire qu'elle a obtenu
l'éveil mais elle n'a pas voulu accéder au rang de bouddha afin de
faire bénéficier de son enseignement les hommes. En Chine, même les taôistes la
considèrent comme la déesse de la miséricorde. En bas, les fidèles sont
accueillis par le jovial Maitreya , "le bouddha du futur" que les
Chinois nomme Milefo ou Bouddha de Mile. Tant le bouddhisme
Mahāyāna que
le Hīnayāna le considèrent comme le prochain bouddha. Les gardiens célestes ont
aussi une bonne place à ce niveau.
![]()
Le chef des Gardiens Célestes, Vaisravana, veille sur le nord et l'hiver. Son
nom signifie "Celui qui sait". Il est le seigneur des Yakshas, des êtres divins
qui protègent et servent leur souverain. Le Gardien du sud, Virudhaka, "Le
puissant", combat l'ignorance et protège l'étincelle de bonté qui brille au
coeur des hommes et gouverne l'été. Au Tibet, il est souvent représenté avec un
heaume en forme de tête d'éléphant. Le Gardien de l'est, Dhritarashtra, "
Celui qui maintient le royaume de la Loi", règne sur le printemps et préserve
l'Etat. Enfin, le Gardien de l'ouest, Virupaksha, "Celui qui voit tout",
généralement représenté vêtu d'une armure et debout sur un rocher ou un tas de
démons, règne sur l'automne.
Après cela petite grimpette pour avoir une vue sur vue surplombant les pagodes
et pour finir, un petit tour au Juying Chi (étang de réflexion), l'étang
à la surface duquel se reflète l'image des Trois Pagodes.
| ||||
Vendredi 3 Avril
- trajet de DALI à LIJIANG
Plus loin, c'est l'hôpital
de Dali. Ici les hôpitaux se distinguent des nôtres par une croix blanche sur
fond rouge! A l'ouest, sur notre gauche la vue est bouchée par la chaîne
de montagnes aux crêtes perdues dans les nuages mais elles nous offrent un
magnifique arc-en-ciel. Au bout d'une heure de route, nous sommes à hauteur du
lac Zibi. Peu à peu le ciel se dégage sur les montagnes qui se font plus arides
et plus rougeâtres, avec de rares terrasse, et laissant le verts aux cultures
sur la plaine de fond de vallée.
Les grottes
bouddhiques du Shibao Shan,
la Montagne du Trésor de Pierre
Vers 10H20, nous quittons
l'autoroute à Niujiexiang pour partir vers les montagnes de l'ouest par une
route parfois sinueuse, pentue et escarpée. Près de 40 minutes de trajet avant
d'arriver à la zone d'accueil du site de ShibaoShan. La terre brune des terres
travaillée récemment semble fertile autour des hameaux où nous passons. La route
prend tout à fait un air de route de montagne ce qui rend délicat le dépassement
du poids lourd qui nous précède.
![]() Départ en autocar dès 8H15 car la route sera longue jusqu'à LIJIANG, avec un
détour non négligeable par la montagne de Shibao. Le temps
devrait être convenable.
Départ en autocar dès 8H15 car la route sera longue jusqu'à LIJIANG, avec un
détour non négligeable par la montagne de Shibao. Le temps
devrait être convenable.
Cap au nord par l'autoroute.
Sans déplaisir, nous repassons près des Trois Pagodes une nouvelle fois.![]()
![]()
![]() Arrivés à l'aire d'accueil, nous pouvoir voir deux norias et un rocher
sculpté de ce qui semble être des scènes de chasse et/ou de danse (par l'ethnie
Bai?). Nous devons laisser notre autocar (depuis cette année, ces véhicules ne sont plus autorisés à
circuler sur la route au-delà) pour emprunter des minibus navettes tout neufs et
pas encore immatriculés. C'est encore environ 20 minutes de trajet par une
route encore plus difficile d'où nous apercevons bientôt le temple suspendu du
Shibao Shan, la Montagne du Trésor de Pierre, située dans la région de Jiangchuan, vers les 2600 mètres d'altitude
Arrivés à l'aire d'accueil, nous pouvoir voir deux norias et un rocher
sculpté de ce qui semble être des scènes de chasse et/ou de danse (par l'ethnie
Bai?). Nous devons laisser notre autocar (depuis cette année, ces véhicules ne sont plus autorisés à
circuler sur la route au-delà) pour emprunter des minibus navettes tout neufs et
pas encore immatriculés. C'est encore environ 20 minutes de trajet par une
route encore plus difficile d'où nous apercevons bientôt le temple suspendu du
Shibao Shan, la Montagne du Trésor de Pierre, située dans la région de Jiangchuan, vers les 2600 mètres d'altitude
.
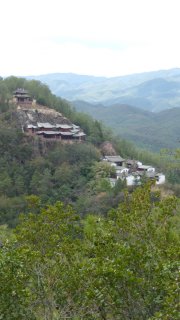
De nombreux autres parcours s'offrent aux vrais randonneurs comme le temple
Baoxiang que nous n'irons pas voir. Il date de la dynastie Yuan et a été
reconstruit en 1876. Ce temple accroché à la falaise est constitué de pavillons
suspendus qui renferment de jolies statues de bouddhas en couleur. Du site, on a
également une vue des aménagements existant sur l'autre versant.
![]()
![]() Nous commençons en descente
par un sentier et des marches dallées, un peu de trajet plat puis une remontée
et c'est l'arrivée aux grottes creusées dans une sorte de grès rouge-brun où il
fait frais (14°). La
montagne est parsemée de grottes et rochers dans lesquels les Bai ont gravé de
somptueuses et nombreuses sculptures qui pour certaines ont 1300 ans. Les
plus anciennes, d’époque Tang, illustrent la pénétration du bouddhisme mahayana
du Tibet en royaume Nanzhao. Certaines représentent les rois de la période
historique du royaume Nanzhao (scènes de vie, comme dans la grotte n°1 et
n°2 montrant les coutumes à la cours du roi) ainsi que des Bouddhas et autres
représentation bouddhistes (moines, les huit "Rois Célestes" de la grotte N°6
où l’on peut observer les influences tibéto-indiennes ou encore la bodhisattva Guanyin de la grotte N°7). Sur certaines statues, on peut voir des traces de
couleurs.
Delphine
nous précise que certaines statues ont été endommagées par
les Gardes Rouges lors de la Révolution Culturelle (1966-1969). Sans oublier en
fin de parcours, la grotte N°8 avec une sculpture unique au monde
représentant un sexe féminin, auquel la population rend un culte de la fécondité
et de la fertilité.
Nous commençons en descente
par un sentier et des marches dallées, un peu de trajet plat puis une remontée
et c'est l'arrivée aux grottes creusées dans une sorte de grès rouge-brun où il
fait frais (14°). La
montagne est parsemée de grottes et rochers dans lesquels les Bai ont gravé de
somptueuses et nombreuses sculptures qui pour certaines ont 1300 ans. Les
plus anciennes, d’époque Tang, illustrent la pénétration du bouddhisme mahayana
du Tibet en royaume Nanzhao. Certaines représentent les rois de la période
historique du royaume Nanzhao (scènes de vie, comme dans la grotte n°1 et
n°2 montrant les coutumes à la cours du roi) ainsi que des Bouddhas et autres
représentation bouddhistes (moines, les huit "Rois Célestes" de la grotte N°6
où l’on peut observer les influences tibéto-indiennes ou encore la bodhisattva Guanyin de la grotte N°7). Sur certaines statues, on peut voir des traces de
couleurs.
Delphine
nous précise que certaines statues ont été endommagées par
les Gardes Rouges lors de la Révolution Culturelle (1966-1969). Sans oublier en
fin de parcours, la grotte N°8 avec une sculpture unique au monde
représentant un sexe féminin, auquel la population rend un culte de la fécondité
et de la fertilité.
Delphine
évoque une coutume particulière des Bai. A la fin de l'année (selon le
calendrier lunaire), alors que
la tradition est que les mariages soient arrangés par les parents, une journée
de fête permet à d'anciens amoureux de se retrouver "en tout bien tout honneur".
Sauf si une femme n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari, alors, malgré la règle
de la monogamie, elle peut faire appel à son ancien amoureux qui devient
amant d'un jour pour suppléer à la déficience de l'époux.
![]() C'est le plus bel ensemble
de temples rupestres du Yunnan mais une fois de plus il est frustrant de se voir
interdire la prise de photos alors qu'il n'y a pas un chat sur ce site en dehors
de nous. Doublement frustrant puisque la petite boutique du site ne vend même
pas de cartes postales (mais une notice mal photocopiée en noir et blanc). J'ai
donc un peu resquillé comme à l'accoutumée et emprunté...
C'est le plus bel ensemble
de temples rupestres du Yunnan mais une fois de plus il est frustrant de se voir
interdire la prise de photos alors qu'il n'y a pas un chat sur ce site en dehors
de nous. Doublement frustrant puisque la petite boutique du site ne vend même
pas de cartes postales (mais une notice mal photocopiée en noir et blanc). J'ai
donc un peu resquillé comme à l'accoutumée et emprunté...
![]() Retour par le même chemin.
Donc cette fois, descente puis remontée... Nous croisons des muletiers avec
leurs animaux lourdement chargés de huit gros blocs de pierres de taille,
sans doute destinées à des restaurations ou à des aménagements. De retour sur le
parking, nous attendons une navette jusqu'à 13H30. Vingt minutes plus tard, nous
sommes au parking de notre autocar.
Retour par le même chemin.
Donc cette fois, descente puis remontée... Nous croisons des muletiers avec
leurs animaux lourdement chargés de huit gros blocs de pierres de taille,
sans doute destinées à des restaurations ou à des aménagements. De retour sur le
parking, nous attendons une navette jusqu'à 13H30. Vingt minutes plus tard, nous
sommes au parking de notre autocar.
![]() Delphine, compte tenu de l'heure tardive et
de l'endroit suggère que nous sautions carrément le déjeuner et en compensation,
un déjeuner serait pris en charge le dernier jour, en lieu et place du déjeuner
libre prévu au programme. Dans un pays où la démocratie n'a pas cours, elle
prend la décision scabreuse de renvoyer des décisions au groupe
en allant jusqu'à mettre aux
voix, par vote à main levée. Un super moyen de casser toute cohésion de groupe
naissante car, dans une telle situation, les plus timorés ou ceux qui
n'ont pas la parole facile se taisent, ce qui aboutit à un faux consensus...
Pas de déjeuner aujourd'hui!
Delphine, compte tenu de l'heure tardive et
de l'endroit suggère que nous sautions carrément le déjeuner et en compensation,
un déjeuner serait pris en charge le dernier jour, en lieu et place du déjeuner
libre prévu au programme. Dans un pays où la démocratie n'a pas cours, elle
prend la décision scabreuse de renvoyer des décisions au groupe
en allant jusqu'à mettre aux
voix, par vote à main levée. Un super moyen de casser toute cohésion de groupe
naissante car, dans une telle situation, les plus timorés ou ceux qui
n'ont pas la parole facile se taisent, ce qui aboutit à un faux consensus...
Pas de déjeuner aujourd'hui!
![]() On va donc gagné du temps. En un peu plus de deux heures, on sera à Lijiang, à
16H15, après avoir rejoint l'autoroute, longé le lac Jianhu et un arrêt dans une
aire de services ornées de statues de yaks du côté de Jianchuan.
On va donc gagné du temps. En un peu plus de deux heures, on sera à Lijiang, à
16H15, après avoir rejoint l'autoroute, longé le lac Jianhu et un arrêt dans une
aire de services ornées de statues de yaks du côté de Jianchuan.![]()
LIJIANG: premier aperçu de la vieille ville et visite du Palais de la Famille Mu
![]()
![]()
![]()
A Lijiang, il fait 28° mais l'atmosphère est bien venteuse. Nous avons pris de l'altitude
depuis Dali puisque Lijiang est à 2400 mètres.
La ville qui ne comportait ni boutiques de souvenirs ni restaurants touristiques
en 1995 doit sa renommée au classement UNESCO qu'elle a obtenu dès 1997, un an
après le tremblement de terre, comme une sorte d'encouragement à se relever...
Mais depuis, l'authenticité de la ville s'est bien perdue! Avec les quartiers
neufs, c'est une ville qui compte 250 000 habitants (155 000
selon Wikipedia en anglais). Le chemin de fer de Kunming à Lijiang a été mis en
service depuis 2010.
![]() Comme l'autocar ne peut pas enter dans la vielle ville, c'est une fois encore
avec des moyens de transports artisanaux,
sur la remorque de tricycles (sans moteur),
que nos valises arrivent à l'hôtel Wang Fu aussi appelé du nom plus
occidental de Lijiang Palace.
Comme l'autocar ne peut pas enter dans la vielle ville, c'est une fois encore
avec des moyens de transports artisanaux,
sur la remorque de tricycles (sans moteur),
que nos valises arrivent à l'hôtel Wang Fu aussi appelé du nom plus
occidental de Lijiang Palace.
Avec le temps qui a été gagné en sautant le déjeuner, Delphine décide d'anticiper la visite du Palais de la Famille Mu qui était au programme du lendemain. Comme l'hôtel est au nord de la vieille ville, il nous faut gagner le sud par la rue de l'est, la place carrée puis un labyrinthe de ruelles sans perdre de temps cat il presque 17H.
Le Petit Futé fait un dithyrambe sur la ville:
«La petite ville de Lijiang est située sur le plateau nord-ouest du Yunnan bordant le Tibet. Les paysages y sont époustouflants: Lijiang est ainsi cernée de montagnes verdoyantes dont les sommets de glaces éternelles dominent le site. Quand le temps n’est pas à la pluie et au brouillard, on a une belle vue sur les monts enneigés du Dragon de Jade (Yulong Xueshan) qui culminent à 5596 m, annonciateurs de l’Himalaya et du Tibet. C’est aussi dans cette région que se trouve le premier méandre du fleuve Yangtse. La préfecture de Lijiang dominait autrefois la principauté de Mexiezhao, et la région garde de son passé prestigieux un certain nombre de palais et de temples bouddhiques de périodes Ming et Qing.
La vieille ville de Lijiang, nommée Dayan, prit son aspect actuel 800 ans en arrière, durant la dynastie des Song du Sud. Elle fut construite autour de ruisseaux provenant de la source du Dragon noir (Heilongtan), au pied de la colline du Lion. Ces canaux à onde claire passent toujours devant le pas des portes. Les ruelles aux pavés inégaux sont bordées de maisons traditionnelles, faites d’une structure en bois et de murs en pisé. Recouvertes d’un toit cornu, elles sont en général spacieuses, avec des balcons qui protègent du soleil comme de la pluie. La cour carrée fermée par les différents corps de bâtiments est souvent agrémentée de fleurs et de petits arbres. Vue des collines alentour, la cité médiévale fait penser à une immense pierre d’encre, d’où son nom de Dayan, qui signifie "grand encrier". La population de Lijiang est composée pour un peu plus de 50% de minorités ethniques, dont les plus nombreux sont les Naxi. On recense aussi des Yi, Lisu, Pumi, Dai, Miao et Tibétains.
Les Naxi (ou Nakhi) sont des descendants de nomades tibétains. D’anciens écrits dongba rédigés il y a plus de 1000 ans font ainsi allusion au mont Kailash, au Tibet. Cette civilisation méconnue en Occident a été décrite par Joseph Rock dans "The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China", en 1947, et par l’écrivain russe Peter Goullart dans son livre de 1955, "Forgotten Kingdom". En 1913, Lijiang était encore loin d’être une destination touristique, mais le géographe austroaméricain Joseph Rock vint s’y installer pour 28 ans. Il quitta Lijiang en léguant ses magnifiques photos et sa passion pour les montagnes et les rivières à l’Occident – sans savoir qu’il éveillerait par là-même la curiosité de millions de personnes. Lijiang est aujourd’hui divisée en deux parties bien distinctes: la nouvelle et l’ancienne ville. La nouvelle ville ressemble à n’importe quelle bourgade sans intérêt du reste de la Chine.
La vieille ville vaut bien sûr le détour, mais il n’est pas nécessaire de s’y attarder de trop. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unescodepuis 1997 après avoir été rénovée suite à un lourd tremblement de terre en 1996, Lijiang est aujourd’hui inondée de touristes. Les Naxi, dont beaucoup sont obligés de quitter la vieille ville, tentent tant bien que mal d’y préserver leur langue et leurs traditions, et les touristes à la recherche d’authenticité et de quiétude risquent fort d’être un peu déçus. Cela dit, le lieu n’en demeure pas moins magique, et sa visite est indispensable si vous passez au Yunnan. »
![]() Nous allons donc faire la visite du Palais des Mu en suivant le fanion de Jenny, la
guide anglophone locale obligatoire mais inutile du fait de la présence de
Delphine.
Nous allons donc faire la visite du Palais des Mu en suivant le fanion de Jenny, la
guide anglophone locale obligatoire mais inutile du fait de la présence de
Delphine.
| ||||
![]() L'histoire de la ville de
Lijiang se confond avec celle de la Famille Mu.
L'histoire de la ville de
Lijiang se confond avec celle de la Famille Mu.
Cela remonte au XIIIe siècle, sous la dynastie des Song du Sud, lorsque les
ancêtres de la famille régnante Mu s'installent dans la nouvelle cité de
Dayechang, qui prendra ensuite le nom de Dayan.
De 1288 à 1730, Ljiang
fut la capitale du royaume de Mu fondé par les Naxi. Cette minorité se considère
comme intermédiaire entre les Tibétains et les Bai.
Au XIVe siècle, il avait fallu plus de 60
ans pour construire cet immense complexe de 100 bâtiments couvrant 6 hectares. Les édifices sont inspirés des différentes architectures Naxi, Bai,
Tibétaines et Han. La ville devient le siège d'une préfecture en 1382 lors
de la prise de contrôle par la dynastie Ming qui gardera la lignée héréditaire
des Mu comme préfets jusqu'en 1723. Pa la suite, le déclin de la famille Mu a entraîné l’abandon de la
résidence. Il fut en partie détruit en 1800 et peu à peu remplacé par des
habitations tandis que le tremblement de terre de 1996 acheva la destruction de
ce qui restait du palais. Avec une efficacité toute chinoise et grâce aux
subventions de la banque mondiale, le Palais a été reconstruit et ouvert au public en février 1999
mais n'est sans doute pas conforme à l’oeuvre originale que l'on comparait à la
Cité Interdite...
d'ailleurs la surface du parc a été réduite de moitié.
![]() Nous allons y passer une
heure et quart car le site mérite la visite et offre, depuis sa partie haute, de
belle vues sur la vieille ville. Passé l'entrée sur la place, nous voyons une
jeune fille habillée du costume de fête des Moso: tunique rouge et jupe blanche
à mille plis.
Nous allons y passer une
heure et quart car le site mérite la visite et offre, depuis sa partie haute, de
belle vues sur la vieille ville. Passé l'entrée sur la place, nous voyons une
jeune fille habillée du costume de fête des Moso: tunique rouge et jupe blanche
à mille plis.
![]() Delphine
nous livre quelques informations sur cette ethnie Moso qui est un
sous-groupe des Naxi, utilisant d'ailleurs une écriture dérivée du
dongba des Naxis. Ils vivent à la frontière des provinces du Yunnan et du
Sichuan, sur les contreforts de l'Himalaya. Environ 50 000 habitants se
rattachent à ce groupe. C’est un peuple matriarcal dont les coutumes sont
restées quasi intactes au point que les ethnologues le surnomment "le peuple
fossile". Jusqu’à récemment, les enfants ignoraient l’identité de leur père.
Vers l'âge de 14 ans, la mère révèle à sa fille le nom de son père afin d'éviter
non pas l'inceste mais une union consanguine avec des demi-frères.
Delphine
nous livre quelques informations sur cette ethnie Moso qui est un
sous-groupe des Naxi, utilisant d'ailleurs une écriture dérivée du
dongba des Naxis. Ils vivent à la frontière des provinces du Yunnan et du
Sichuan, sur les contreforts de l'Himalaya. Environ 50 000 habitants se
rattachent à ce groupe. C’est un peuple matriarcal dont les coutumes sont
restées quasi intactes au point que les ethnologues le surnomment "le peuple
fossile". Jusqu’à récemment, les enfants ignoraient l’identité de leur père.
Vers l'âge de 14 ans, la mère révèle à sa fille le nom de son père afin d'éviter
non pas l'inceste mais une union consanguine avec des demi-frères.
C'est une société matrilinéaire (les enfants sont rattachés au groupe parental
maternel, qui les élève, leur transmet le nom et l'héritage), matrilocale (les
femmes sont au centre de leur famille et ne la quittent pas pour rejoindre leur
conjoint après une union) et avunculaire (la paternité des enfants est exercée
par leur oncle maternel). Les Moso présentent également dans leurs traditions
certaines particularités, ce qui leur a valu l'intérêt de nombreux ethnologues: le
mariage n'existe pas et les amants ne résident pas ensemble. Ces spécificités
ont été bousculées sous la Révolution Culturelle quia tenté d'imposer le mariage
et la monogamie. Mais de nombreux Moso sont restés fidèles à leur modèle
traditionnel ou y sont retournés par la suite.
![]()
![]() Quelques pas plus loin, c'est une femme en costume Naxi.
Quelques pas plus loin, c'est une femme en costume Naxi.
La société Naxi étant
traditionnellement une société matriarcale, les hommes avaient tout loisir de
pratiquer la calligraphie et la musique, tandis que les femmes s’occupaient des
tâches quotidiennes à la maison et des travaux aux champs.
Delphine
précise que le costume porté
par les femmes résume bien leur condition: une
cape en peau de yack
avec des
bretelles croisées blanches sur la poitrine et le dos avec deux couleurs
symbolisant la force:
blanche pour symboliser le jour et noire avec les 7 étoiles de la grande ourse, pour signifier que
les femmes Naxi sont toujours à la tâche, le jour et même la nuit. Pendant ce
temps, leurs hommes s'adonnent aux arts (calligraphie, musique, peinture) ou
moins noblement aux échecs, au thé, à la pipe à eau ou à l'alcool!
Selon les
sources, l'effectif de la population de l'ethnie des Naxi varie ente 300 000 et
500 000
personnes dont plus de 250 000
dans la région de Lijiang.
| ||||
L’ensemble du palais actuel s’adosse à
une colline et se trouve au coeur de la vieille ville de Lijiang. Orienté
du côté est, il connaît l’ensoleillement le matin. Par la sortie arrière du
palais des Mu, il est possible de rejoindre l'entrée sud du parc de la colline
du Lion et, à proximité, la pagode Wangulou, haute de 33 mètres.
![]()
 Retour au centre ville à une
allure plus tranquille si l'on peut dire car nous sommes immergé dans la foule
qui grouille
de touristes chinois qui se
pressent dans les boutiques de souvenirs, de thé pu'erh... Passage Porte
Guangmen puis devant les comptoirs des restaurants de rue disposés en
enfilade et surmontés de décors des plus kitchs qui soient. Sur la pittoresque
Rue ou Place Carrée (Sifang Jie qui sert de place du marché), on peut
voir un montreur d'aigle pour la photo souvenir.
Retour au centre ville à une
allure plus tranquille si l'on peut dire car nous sommes immergé dans la foule
qui grouille
de touristes chinois qui se
pressent dans les boutiques de souvenirs, de thé pu'erh... Passage Porte
Guangmen puis devant les comptoirs des restaurants de rue disposés en
enfilade et surmontés de décors des plus kitchs qui soient. Sur la pittoresque
Rue ou Place Carrée (Sifang Jie qui sert de place du marché), on peut
voir un montreur d'aigle pour la photo souvenir.
Après la traversée du centre, nous voici tout au nord de la vieille ville, à son
entrée principale, au pied de la colline du Lion et près de l'étang du Dragon
Noir. Deux roues à aubes reconstituées ornent un côté de la grande place Yuhe.
Les jeunes filles la surnomment "la Place de Voeux" car elles viennent y faire
graver leurs souhaits Xuyuanpai. D'autres jeunes femmes en costume
d'apparat et munies d'une carte essaient de vous convaincre d'aller dîner dans
tel restaurant. Profitons des dernières lumières du jour qui éclairent les
sommets de la Yulong Xueshan, la Montagne du Dragon de Jade (5596 mètre) à
une trentaine de kilomètres plus au nord.
![]() Il est 18H45, pour dîner,
Delphine
jette son dévolu sur le Alequi Fish Restaurant. Rien de
remarquable: poisson, évidemment avec une telle enseigne, nouilles froides, pommes de terre pas cuites, légumes
insipides et même pas de riz!
Il est 18H45, pour dîner,
Delphine
jette son dévolu sur le Alequi Fish Restaurant. Rien de
remarquable: poisson, évidemment avec une telle enseigne, nouilles froides, pommes de terre pas cuites, légumes
insipides et même pas de riz!
En ressortant du restaurant,
c'est l'occasion de jeter un oeil à la concurrence beaucoup plus portée sur la
viande à en juger par les carcasses de porcelet laqué ou de chevreau. Il ya même
un MacDo sur la place Yuhe, toujours animée et dominée à l'est par une superbe
pleine lune.![]()
LIJIANG: Concert
de Musique Naxi ![]()
 A deux pas le là, nous
arrivons à la salle Na-Xi Concert Hall où l'on anticipe
d'une journée la soirée prévue pour assister à un concert de musique Naxi. Un
quart d'heure d'attente car le concert débute à 20H. Cette salle vieillotte,
haute de plafond et parcourue de courants d'air ne présage pas d'une grande
partie de plaisir. On peut noter qu'en dehors de notre groupe, il n'y
pratiquement pas d'autres spectateurs dans cette grande salle.
Delphine
nous a raconté l'origine de cet ensemble.
M.
Xuan Ke, son
directeur, a eu un passé peu banal. Né en 1930, dans les années 1970, il a été condamné à 20
ans de prison pour adultère avec la femme d'un militaire. A sa sortie de prison
à 65 ans, il a épousé une jeune femme de 25 ans. Il a fondé cet orchestre en
1981.
A deux pas le là, nous
arrivons à la salle Na-Xi Concert Hall où l'on anticipe
d'une journée la soirée prévue pour assister à un concert de musique Naxi. Un
quart d'heure d'attente car le concert débute à 20H. Cette salle vieillotte,
haute de plafond et parcourue de courants d'air ne présage pas d'une grande
partie de plaisir. On peut noter qu'en dehors de notre groupe, il n'y
pratiquement pas d'autres spectateurs dans cette grande salle.
Delphine
nous a raconté l'origine de cet ensemble.
M.
Xuan Ke, son
directeur, a eu un passé peu banal. Né en 1930, dans les années 1970, il a été condamné à 20
ans de prison pour adultère avec la femme d'un militaire. A sa sortie de prison
à 65 ans, il a épousé une jeune femme de 25 ans. Il a fondé cet orchestre en
1981.
|
|
|
L'hostilité des Chinois à l'égard des Japonais est bien
palpable.
Et les Chinois aiment bien faire sentir que le Japon est
quelque part redevable de beaucoup à la Chine alors qu'au début de l'ère
chrétienne il sortait tout juste du paléolithique.
Samedi 4 Avril
- aux environs de LIJIANG![]()
![]()
![]()
Départ en autocar 8H30 pour le village de Yuhu, à une quinzaine de kilomètres au
nord de Lijiang. Un peu frais encore: 14°.
![]() A
propos de l'hostilité
es Chinois à l'égard des Japonais
A
propos de l'hostilité
es Chinois à l'égard des Japonais
La notion de Seconde Guerre Mondiale telle que nous la situons
chronologiquement, 1939-1945, n'a pas de plein sens pour eux qui
prennent en considération le début de l'invasion japonaise en Mandchourie se
situe en 1931, suivie à partir de l'été 1937, par l'invasion massive de la
partie orientale de la Chine (seconde guerre sino-japonaise) suivie du Massacre
de Nankin (de 40 000 à 300 000 victimes selon les sources, japonaises ou
chinoises). A ce propos, Delphine
emploie systématiquement l'expression "la Guerre Antijaponaise".
De son côté, Linda, notre guide locale tibétaine en fin de circuit nous a montré
clairement qu'elle exécrait les Japonais.
Nous avons pu voir un bar de Lijiang qui n'hésite pas à placarder un avis
indiquant que l'établissement est "interdit aux Japonais". 
De la Chine, lui sont parvenues des techniques nouvelles, des arts, l'écriture,
une philosophie (confucianisme) et une religion (bouddhisme). Une histoire ou une
légende illustrent ce dernier aspect des choses.
A ce sujet,
Delphine
a évoqué des faits anciens, mi-légendaires, mi-historiques...
Plusieurs souverains de l'antiquité chinoise ont tenté d'obtenir une
"panacée de jeunesse et de longue vie", sous forme d’élixir ou de pilule.
Pendant la dynastie Qin, le célèbre Empereur Qin Shi Huang (auquel on doit la
fabuleuse Armée Enterrée de Terre Cuite de Xi'an) parcourut les côtes de Chine
orientale afin de trouver ces remèdes et il envoya vers l'Orient et ses
mythiques "îles des immortels" une vaste expédition menée par Xu Fu accompagné
de 3000 (1000 selon d'autre sources) filles et garçons vierges, de gardes et de
vivres, à la recherche de l'élixir de vie éternelle.
Mais l'envoyé ne revint jamais ni aucun membre de l'expédition. Disparurent-ils
en Mer Jaune, au-delà de la péninsule du Shandong ou, comme on le raconte,
parvinrent-ils à Shingu au Japon mais n'y ayant pas trouvé l'élixir, y restèrent
et y firent souche? Au lieu de rentrer en Chine, Xu Fu aurait passé le restant
de sa vie à Kumano, auprès de Tokugawa Yorinobu, seigneur de Kishu, transmettant
culture et technologie chinoises, notamment dans les domaines des travaux
publics et de l'agriculture.
A défaut d'avoir trouvé le fameux élixir, les recherches de la médecine chinoise
et du taoïsme de cette époque croyaient qu'ingérer des matériaux précieux connus
pour ne pas s'abîmer, comme l'or, le jade, le cinabre (sulfure de mercure) ou
l'hématite pouvaient conférer la longévité. L'Empereur Qin Shi Huang Di mourut
d'une intoxication au cinabre en 210 av. J.-C.
En quittant Lijiang, on peut voir un marché aux légumes sur le trottoir avec
nombreuses femmes Naxi en costume traditionnel, si l'on fait exception de leur
casquette mao, mais après tout elle fait désormais partie de la tradition. Nous
passons devant la statue d'un énorme lion, sans doute une évocation de la
Colline du Lion proche. Sur notre gauche (ouest), magnifique panorama sur la
Montagne de Dragon de Jade éclairée par le soleil du matin qui fait étinceler
ses glaciers. Nous traversons une zone parfaitement plate qui avait été utilisée
par l'escadrille des 137 avions américains des Tigres Volants venus d'Inde et de
Birmanie en 1941 pour appuyer les forces chinoises lors de la "guerre anti-japonaise" comme on dit ici pour évoquer la Seconde Guerre Mondiale.
![]() En 1939, les Alliés avaient établis le la Route de Birmanie qui reliait
Yangoon à Kunming, la capitale du Yunnan. C'était la bouée de sauvetage de la
Chine. En effet, les Britanniques transportaient des fournitures pour aider le
gouvernement de Chiang Kai Tchek dans sa contre-attaque contre le Japon. Mais en
1942, les forces japonaises avaient repris la Birmanie et donc coupé la Route de
Birmanie et le lien avec les Britanniques repliés en Inde. Pour les Alliés, il
n'y avait d'autre solution que d'établir un pont aérien de l'Assam en
l'Inde britannique au Yunnan. Des aérodromes militaires avaient donc été
construits dans la province du Yunnan occidental, notamment à Yunnanyi,
Tengchong et Baoshan. L'escadrille d'aviateurs américains qui devaient
survoler l'Himalaya pour éviter l'espace aérien birmane contrôlé par le Japon
ont été surnommés les "Tigres Volants".
En 1939, les Alliés avaient établis le la Route de Birmanie qui reliait
Yangoon à Kunming, la capitale du Yunnan. C'était la bouée de sauvetage de la
Chine. En effet, les Britanniques transportaient des fournitures pour aider le
gouvernement de Chiang Kai Tchek dans sa contre-attaque contre le Japon. Mais en
1942, les forces japonaises avaient repris la Birmanie et donc coupé la Route de
Birmanie et le lien avec les Britanniques repliés en Inde. Pour les Alliés, il
n'y avait d'autre solution que d'établir un pont aérien de l'Assam en
l'Inde britannique au Yunnan. Des aérodromes militaires avaient donc été
construits dans la province du Yunnan occidental, notamment à Yunnanyi,
Tengchong et Baoshan. L'escadrille d'aviateurs américains qui devaient
survoler l'Himalaya pour éviter l'espace aérien birmane contrôlé par le Japon
ont été surnommés les "Tigres Volants".
Nous quittons la plaine pour monter vers le village en passant près d'une sorte
de campement où sont érigés des mâts auxquels sont accrochées des cordelettes
munies de drapeaux de prières.![]()
Village de YUHU et maison du Dr J. Rock
Nous arrivons au village naxi de Yuhu, trois quarts d'heures après avoir quitté l'hôtel. La guide locale Jenny est toujours là, pour le décor...
Yuhu est le dernier
village de la vallée de Lijiang, situé au pied de la Montagne du Dragon de Jade.
Les maisons sont faites avec des pierres appelées "tête de singe" dont
l'apparence est intermédiaire entre celle d'une pierre grossière et celle de la
terre séchée. Le village a conservé l'aspect qu'il avait au début du XXème
siècle lorsque Joseph Rock choisit cet endroit comme lieu de résidence.
![]()
![]() La place poussiéreuse à l'entrée du village est l'occasion de voir des Naxi,
hommes comme femmes, portant la casquette Mao bleue. Certaines femmes plus jeunes
la remplacent par une casquette de base-ball. Le point de vue sur la montagne
serait superbe s'il ne fallait pas s'ingénier pour trouver des angles sans les
fils électriques. La pipe à eau est toujours appréciée des hommes du village.
La place poussiéreuse à l'entrée du village est l'occasion de voir des Naxi,
hommes comme femmes, portant la casquette Mao bleue. Certaines femmes plus jeunes
la remplacent par une casquette de base-ball. Le point de vue sur la montagne
serait superbe s'il ne fallait pas s'ingénier pour trouver des angles sans les
fils électriques. La pipe à eau est toujours appréciée des hommes du village.
Nous allons visiter la maison du géographe américain Joseph Rock, d'origine
autrichienne, tandis que des ouvriers révisent la toiture de tuiles rondes. La
maison, plus exactement la résidence disposée autour d'une traditionnelle cour
carrée, est transformée en une sorte de musée miteux.
Botanise de métier, le Dr.
Rock venu ici en mission pour étudier les plantes de la Montagne du Dragon de
Jade, tomba amoureux de la région, de ses habitants et de sa culture, et décida
de s’y établir. Il habitera au village de Yuhu pendant 27 ans. A partir de 1922,
il commença un énorme travail de recherche sur la minorité Naxi locale, pris de
nombreuses photos et rédigeât des articles pour le magazine National
Geographic et que l'on peut voir exposées ici. Il a écrit à ses amis, juste
avant sa mort en 1962 qu'il préférait mourir dans les fleurs de la Montagne du
Dragon de Jade plutôt sur un lit de malade à Hawaï. Plus loin, on
évoquera son nom au sujet du mythe de Shangri-La.
Retour pour un tour dans le village. C'est l'heure où des Chinois peu courageux
mais argentés s'en vont en caravane vers la montagne à dos de mulets. Rien ne
doit se perdre aussi une femme récupère le crottin lâché par les montures.
|
![]() Après trois quarts d'heure de visite au village de Yuhu, nous reprenons
l'autocar pour un très court trajet de moins de 10 minutes pour nous rendre dans
le village voisin. La température a bien grimpé: 27° à 10H30!
Après trois quarts d'heure de visite au village de Yuhu, nous reprenons
l'autocar pour un très court trajet de moins de 10 minutes pour nous rendre dans
le village voisin. La température a bien grimpé: 27° à 10H30!
![]()
Village de BAISHA: monastère Yufeng
|
|
![]() L'évolution
du bouddhisme a donné lieu à trois grandes écoles:
l'Hinayana,
le
Mahayana
et enfin le
Vajrayana
(yâna
"véhicule" et
vajra
diamant")
ou Bouddhisme tantrique. Le tantrisme consiste en une discipline regroupant un
ensemble de techniques visant à canaliser l'énergie du pratiquant afin de lui
permettre de progresser plus rapidement sur la voie de l'illumination. Le but
est de devenir un bodhisattva qui signifie "être promis à l'Éveil". Ayant
atteint l'éveil, le bodhisattva n'entre pas en
nirvāna
mais reste dans le
samsara,
afin d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance, dans une
démarche de libération collective.
L'évolution
du bouddhisme a donné lieu à trois grandes écoles:
l'Hinayana,
le
Mahayana
et enfin le
Vajrayana
(yâna
"véhicule" et
vajra
diamant")
ou Bouddhisme tantrique. Le tantrisme consiste en une discipline regroupant un
ensemble de techniques visant à canaliser l'énergie du pratiquant afin de lui
permettre de progresser plus rapidement sur la voie de l'illumination. Le but
est de devenir un bodhisattva qui signifie "être promis à l'Éveil". Ayant
atteint l'éveil, le bodhisattva n'entre pas en
nirvāna
mais reste dans le
samsara,
afin d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance, dans une
démarche de libération collective.
Attardons nous un peu sur l'école du bouddhisme lamaïste tibétain.
Vers 750, Padmasambhava, aussi appelé Guru Rimpoche, chercha à unifier la doctrine
Vajrayana
et les anciens cultes tibétains
bonpos,
ce qui donna naissance à une nouvelle forme de bouddhisme: le bouddhisme
tibétain ou lamaïsme.
Le grand maître du bouddhisme tibétain fonda
l'ordre
Nyingmapa,
"la Lignée des Anciens", et ses moines prirent la robe et la coiffe rouges pour
se distinguer des prêtres bonpos.
Pour lutter contre la domination de la religion bon,
d'autres ordres virent le jour au cours des siècles suivants, tous désignés par
la dénomination de "Bonnets
rouges".
Vers le XVe siècle, le réformateur
Tsongkhapa rassembla en un canon unique les éléments essentiels de tous les
enseignements bouddhiques et fonda l'ordre des Gelugpas, "la
Lignée des hommes vertueux", dont les moines prirent la coiffe jaune et
devinrent dans le langage populaire, les "Bonnets jaunes". Le guide de
ce dernier ordre devint le chef spirituel et temporel du Tibet. Le
troisième guide reçut d'un roi mongol, le titre de Dalaï-Lama (du mongol
dalaï "océan" et lama "maître
insurpassable", parfois traduit par "Océan de sagesse"), titre qui
fut attribué rétroactivement à ses prédécesseurs. Chaque Dalaï-Lama fut dès lors
considéré comme la réincarnation de son prédécesseur.
Dans la tradition, le Dalaï-Lama est le dirigeant spirituel et politique du
Tibet.
Issu également de l'ordre
des Bonnets jaunes,
l'abbé du monastère de Tashilhunpo,
dans la région
de Shigatsé,
le Panchen-Lama (du sanskrit pandita "érudit", du tibétain
chenpo "grand" et lama) est le deuxième plus haut chef spirituel
du bouddhisme tibétain, juste après
le dalaï-lama.
|
![]() Nous descendons vers
le complexe monastique et le temple situés un peu en contrebas.
Nous descendons vers
le complexe monastique et le temple situés un peu en contrebas.
Quelques fidèles viennent y brûler de l'encens et faire tourner les moulins à
prières puisque l'on est ici dans un univers lamaïste. Des fresques
modernes comme la Roue de la Vie présentent des scènes hyper réalistes.![]()
BAISHA: le Palais Dabaoji et visite du village![]()
![]() Très court trajet pour
descendre au village de Baisha proprement dit, pour voir les fresques du Palais
Dabaoji.
Il y avait
jadis beaucoup de fresques autour de Lijiang. Malheureusement, la plupart furent
détériorées ou détruites durant la Révolution Culturelle.
Très court trajet pour
descendre au village de Baisha proprement dit, pour voir les fresques du Palais
Dabaoji.
Il y avait
jadis beaucoup de fresques autour de Lijiang. Malheureusement, la plupart furent
détériorées ou détruites durant la Révolution Culturelle.
La vieille de Baisha est le premier établissement du peuple Naxi et le berceau du clan Mu puisque c'est le lieu de naissance de "Tusi", le chef du clan. Au début de la dynastie des Tang, pendant le Royaume Nanzhao, les ancêtres des Mu clan ont commencé à construire Baisha et ses temples. Pendant la dynastie des Song, la petite ville prospère est devenue le centre économique, politique et culturelle de Lijiang. Pendant les dynasties Ming et Qing la famille Mu s'est progressivement déplacée vers la ville de Dayan. Le quartier central de la ville est caractérisé par un groupe de temples appelé "Mudu" dans un grand carré qui symbolise les droits politiques de la famille Mu.
La couleur blanche du sable est à l'origine du nom de la ville. Dans la langue Naxi, le sable blanc est appelé "bengshi" qui a évolué en "Baisha".
|
|
|
|
![]() Nous déjeunons d'ailleurs
dans l'une de ces rues, au restaurant Yingxiang, un endroit très
sympa, avec des plats très variés principalement de légumes.
Nous déjeunons d'ailleurs
dans l'une de ces rues, au restaurant Yingxiang, un endroit très
sympa, avec des plats très variés principalement de légumes.
Coup d'oeil intéressant dans
ce village.
De ce côté-ci des femmes portent une coiffe de deuil.
De l'autre on peu voir une femme qui cuisine sur la rue d'étranges blocs qui
font penser à du tofu (dòu huā ou dòufu huā en chinois).
- Ce pourrait être du tofu puisqu'il y en a de différentes sortes, avec des
textures et couleurs (comme le jaune aux oeufs) diverses. Peut-être s'agit-il de
tofu grisâtre fait à partir de grains de soja noir (Glycine max
Tambaguro). Le tôfu noir est un type de tôfu soyeux fait à partir de de
graines de soja noires entières. La texture du tôfu de grains noirs est
légèrement plus gélatineuse que celle du tôfu habituel et la couleur a des tons
plus grisâtres. Ce type de tôfu est "apprécié" pour son goût terreux.
- Ce pourrait être
du "móyù dòufu" qui
se mange plutôt dans la province du Sichuan (mais le Sichuan et le Yunnan sont
voisins...).
On le désigne aussi sous le nom de "konjac tofu" ou "konjac neige" (ou
konnyaku pour les Japonais). C'est une gelée pâteuse, pouvant être noire ou
blanche, faite d'une farine obtenue à partir du rhizome tubéreux sphérique du
konjac (Amorphophallus konjac), une plante de la famille des arums (Araceae).
DU SOJA AU TOFU
Le soja (Glycine max) ou soya, celui dont on fait du "lait" et du tôfu, appelé aussi pois chinois ou haricot oléagineux, est une espèce de plante annuelle de la famille des légumineuses, originaire d'Asie orientale dont il existe plusieurs variétés: à port grimpant ou rampant, à graines jaunes, noires ouvertes... Son nom savant est trompeur car le soja n'a qu'une très lointaine parenté (au niveau de leur sous-famille) avec ce que dans nos jardins d'agrément on nomme "glycine "(Wisteria). Bien peu de parenté (même famille des Fabaceae) également avec le haricot mungo (Vigna radiata), légumineuse originaire du sous-continent indien bien connue sous la forme germée erronément appelée "pousses de soja".
Le tôfu (dòu huā ou dòufu huā en chinois) est une base de l'alimentation asiatique originaire de la Chine. Il est obtenu à partir de graines ("haricots") de soja (Glycine max) et ses techniques de production ont été introduites en Corée puis au Japon durant la période Nara. Elles se sont aussi répandues dans d’autres parties de l’Asie de l’Est. La diffusion du tôfu coïncide avec celle du Bouddhisme compte tenu qu’il est une source importante de protéines dans les régimes végétariens religieux.
Le tôfu est produit en coagulant du lait de soja bouilli et en pressant le lait caillé résultant. Deux types de coagulants sont utilisés. Il s'agit soit de sels (du sulfate de calcium autrement dit du gypse, du chlorure de magnésium ou du chlorure de calcium) ou d'un acide organique, le glucono delta-lactone, également utilisé dans la fabrication de fromages. Selon la texture désirée, les fabricants peuvent utiliser l'un ou l'autre des coagulants ou le mélanger.
Il existe une grande variété de tôfu: frais, séché (dòu gān), fermenté (dòufu rǔ ou chòu dòufu), frit (dòupào), parfumé aux fruits (par exemple xìngrén dòufu), aux oeufs (dàn dòufu), glacé. Le tofu frais peut être tendre et soyeux (nèn dòufu), ferme (lǎo dòufu). Le tôfu peut être verdâtre, c'est le tôfu obtenu à partir de grains de soja frais et donc vert. Il en existe existe aussi du grisâtre ou "noir" fait à partir des grains de soja noir (Glycine max Tambaguro). Le tôfu noir est un type de tôfu soyeux fait à partir de de graines de soja noires entières. La texture du tôfu de grains noirs est légèrement plus gélatineuse que celle du tôfu habituel et la couleur a des tons plus grisâtres. Ce type de tôfu est "apprécié" pour son goût terreux.
N'oublions pas la peau de soja, le film complexe composé de protéines de soja et de lipides qui se forme en surface lorsque le lait de soja bouillonne. Comme cette "peau" a une texture élastique douce, elle peut être plié et mise en forme de diverses façons comme en rouleaux.
Le tôfu peut être consommé cru, cuisiné frit, être utilisé dans des soupes, en sautés, cuit à l’étuvé ou dans une sauce.
![]()
LIJIANG: le
Parc de l'Etang du
Dragon Noir et le Musée Dongba![]()
![]()
![]()
![]() Il est un peu plus de 13H40 lorsque nous repartons avec l'autocar en direction
de Lijiang, pour une balade dans le Parc de l'Etang du Dragon Noir, situé
immédiatement au nord de la ville,
au bout de la Xin Dajie.
Son nom est dû au fait que ses eaux paraissent noires à cause des herbes
aquatiques qui poussent au fond.
Il est un peu plus de 13H40 lorsque nous repartons avec l'autocar en direction
de Lijiang, pour une balade dans le Parc de l'Etang du Dragon Noir, situé
immédiatement au nord de la ville,
au bout de la Xin Dajie.
Son nom est dû au fait que ses eaux paraissent noires à cause des herbes
aquatiques qui poussent au fond.
| ||||
|
|
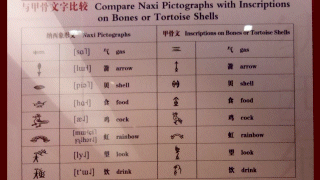
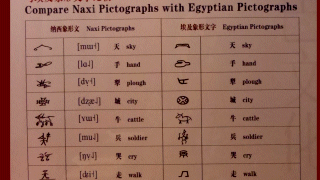
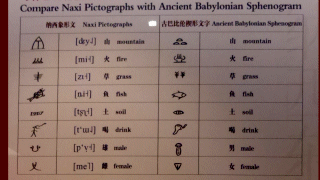
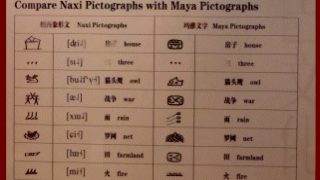
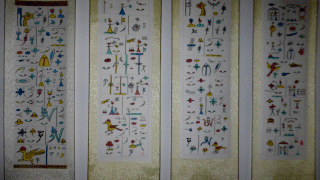
Ce que précise Wikipédia à
propos de l'écriture chinois qui
«[...]
initialement, est formée à partir de pictogrammes, c'est-à-dire de dessins où le
graphique primitif est une représentation directe de quelque chose.
[...] 文, le dessin d'origine montre un homme vu de face (le petit
trait du haut forme la tête, la barre horizontale marque les bras, et les deux
diagonales forment les jambes.
[...]Mais la simple représentation d'objet ne forme pas un système
d'écriture. De tels dessins sont insuffisants pour représenter tous les éléments
d'une langue. Un niveau d'abstraction supplémentaire est nécessaire. Le principe
qui permet de passer à un système d'écriture est que le dessin ne s'interprète
plus nécessairement de manière isolée.
[...] Ce principe étant acquis, il évolue très rapidement vers un système
cohérent et signifiant : les dessins se simplifient et s'uniformisent, et les
compositions se figent...»
Dans ce musée, on trouve aussi des témoignages de leur artisanat: calligraphies, masques, paravents. A l'aide d'une maquette du nord du Yunnan, Delphine nous montre l'itinéraire du lendemain et nous localise notamment la première courbe du Yangtse, entre les monts Yulong et Haba.
![]()
![]() Retour en ville, en passant
devant la seule statue monumentale de Mao conservée dans le pays, érigée au
centre de la Place du Peuple. De retour au nord de la vieille ville,
Chantal me signale un bar dont l'accès est interdit aux Japonais (Ah! cette
sacrée guerre anti-japonaise a laissé des traces).
Retour en ville, en passant
devant la seule statue monumentale de Mao conservée dans le pays, érigée au
centre de la Place du Peuple. De retour au nord de la vieille ville,
Chantal me signale un bar dont l'accès est interdit aux Japonais (Ah! cette
sacrée guerre anti-japonaise a laissé des traces).
Comme il n'est que 16H, nous en profitons pour aller refaire un tour au
centre de la vieille ville. On en profite pur s'écarter parfois un peu des
axes les plus animés. Parfois, entre les boutiques spacieuses, de petites
échoppes guère plus larges d'un mètre ont comme réussi à s'infiltrer, sans doute
dans un ancien passage entre des maisons. Sur la place, le marché s'achève.
![]() De retour à l'hôtel, nous
prenons l'autocar qui doit effectuer un détour par le nord de la ville, près de
la Place Yuhe (entre le KFC et la muraille Dongba en travaux) et de la Place du
Peuple (statue de Mao). Non loin de la rue Xianghe, dans un quartier moderne mais sans
charme où des dizaines d'autocars sont garés, s'alignent des
restaurants-usines à touristes.
De retour à l'hôtel, nous
prenons l'autocar qui doit effectuer un détour par le nord de la ville, près de
la Place Yuhe (entre le KFC et la muraille Dongba en travaux) et de la Place du
Peuple (statue de Mao). Non loin de la rue Xianghe, dans un quartier moderne mais sans
charme où des dizaines d'autocars sont garés, s'alignent des
restaurants-usines à touristes.
![]() Nous dînons dans le restaurant Mishixiang:
A nouveau,
comme ce midi,
des pousses de soja et, en dessert, des gâteaux déjà
appréciés au début de notre circuit
(du côté de Jianshui) à base de farine de haricot vert, avec fourrage est à base
de tarot et tranche parsemée de graines de sésame. A lieu de thé, on nous sert
une infusion de graines de sarrasin...
Nous dînons dans le restaurant Mishixiang:
A nouveau,
comme ce midi,
des pousses de soja et, en dessert, des gâteaux déjà
appréciés au début de notre circuit
(du côté de Jianshui) à base de farine de haricot vert, avec fourrage est à base
de tarot et tranche parsemée de graines de sésame. A lieu de thé, on nous sert
une infusion de graines de sarrasin...
![]() Retour à
l'hôtel Lijiang Palace.
Retour à
l'hôtel Lijiang Palace.![]()
3
-
Le Yangtsé, ZHONGDIAN
(Shangila) et ses environs
![]()
![]()
![]()
Dimanche 5 Avril
- trajet de LIJIANG à ZHONGDIAN
![]() Départ en autocar à 8H30 car la route est longue (près de 200 km) et surtout on
va devoir grimper 1200 mètres pour passer un col à 3600 mètres d'altitude avant
d'arriver à Zhongdian.
Delphine
nous donne les prévisions de températures à
destination: de 1° le matin à 10°...
Départ en autocar à 8H30 car la route est longue (près de 200 km) et surtout on
va devoir grimper 1200 mètres pour passer un col à 3600 mètres d'altitude avant
d'arriver à Zhongdian.
Delphine
nous donne les prévisions de températures à
destination: de 1° le matin à 10°...
Ce matin, en quittant Lijiang, on a de superbes vues sur les glaciers de la
Montagne du Dragon de Jade coiffée d'un nuage en "bonnet d'âne", montagne en
direction de laquelle nous allons rouler. Sur notre droite, nous laissons le
grand plan d'eau Lashihai et des zones de maraîchage et de cultures intensives.
La première courbe du Yang-Tse
![]()
![]() et le village de Shigu
et le village de Shigu
Nous quittons l'autoroute pour une route de montagne sinueuse passant près de
jolis hameaux, avec des cultures de blé, colza, pommes de terre, ail, fèves et
fraises. Puis le trajet devient descendant et permet bientôt d'apercevoir à
nouveau les cimes enneigées.
![]()
![]() Cette première partie de notre itinéraire, une cinquantaine de kilomètres, va
nous amener sur la rive droite du Yangtsé
Cette première partie de notre itinéraire, une cinquantaine de kilomètres, va
nous amener sur la rive droite du Yangtsé
| ||||
![]() Comme il n'a pas plu,
Delphine
propose
aux plus téméraires ou aux plus sportifs de grimper par un mauvais sentier sur
le versant raide de la vallée jusqu'à atteindre des points de vue plus larges
sur la courbe. Une demi-heure pour un panorama qui vaut la peine. Nous
sommes dans la région des Trois Fleuves Parallèles, région qui a fait l'objet
d'un classement au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO
Comme il n'a pas plu,
Delphine
propose
aux plus téméraires ou aux plus sportifs de grimper par un mauvais sentier sur
le versant raide de la vallée jusqu'à atteindre des points de vue plus larges
sur la courbe. Une demi-heure pour un panorama qui vaut la peine. Nous
sommes dans la région des Trois Fleuves Parallèles, région qui a fait l'objet
d'un classement au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO![]() en 2003. Le Parc national des trois fleuves parallèles, dans le nord-ouest
montagneux de la province du Yunnan, est un site de 1,7 million d’hectares qui comprend
des secteurs du cours supérieur de trois des grands fleuves d’Asie: le Jinsha
(Yangtze), Lancang (Mékong) et Nu Jiang (Salouen au Tibet
et Thanlwin Myit en Birmanie où s'effectue la seconde moitié de
son cours).
en 2003. Le Parc national des trois fleuves parallèles, dans le nord-ouest
montagneux de la province du Yunnan, est un site de 1,7 million d’hectares qui comprend
des secteurs du cours supérieur de trois des grands fleuves d’Asie: le Jinsha
(Yangtze), Lancang (Mékong) et Nu Jiang (Salouen au Tibet
et Thanlwin Myit en Birmanie où s'effectue la seconde moitié de
son cours).
|
Le Tibet historique incluait trois provinces ou régions
traditionnelles: l'Ü-Tsang ("le Pays du dharma"), formant les parties
centrale et occidentale, l'Amdo ("le Pays des chevaux") au nord-est et le
Kham ("le Pays du peuple"), au sud-est. - L'Amdo est situé au nord-est du Ü-Tsang et englobe la majeure partie de la province du Qinghai, ainsi que des régions plus petites, mais culturellement importantes, dans les provinces du Gansu et du Sichuan. Ce serait la région d'origine du peuple tibétain. Les habitants se désignent sous la dénomination d'Amdowa ou parfois comme Böpa (Tibétains). Le royaume Tuyuhun qui était établi en Amdo fut renversé et complètement annexé par l’empire du Tibet en 663, sous le règne de Songtsen Gampo (629-650). Au IXe siècle, la fragmentation du Tibet permit à la dynastie chinoise des Tang de restaurer la route de la soie, et de récupérer une bonne partie de cette région jusqu'au règne du 5e dalaï-lama, Lozang Gyatso, au XVIIe siècle, qui eut pour résultat l'unification du Tibet. Au cours de la République de Chine (1911-1949), l'Amdo est conquise par la République de Chine en 1928. - Le Kham est situé au sud-est du Ü-Tsang. La plus grande partie de la région du Kham recouvre l'est de l'actuelle région autonome du Tibet et l'ouest de la province du Sichuan, avec des parties plus petites dans les provinces du Qinghai et du Yunnan (préfecture autonome tibétaine de Dêqên). Le Kham était divisé en cinq royaumes principaux dirigés par des gyelpo ou gyalpo et comportait aussi cinq États secondaires horpa ainsi que quelques autres petits territoires. Les habitants sont appelés Khampas. Au XVIIe siècle, l’armée mongole aida le 5e dalaï-lama, Lozang Gyatso (1617-1682), à unifier le Tibet, en particulier en convertissant les royaumes du Kham à la tradition Gelugpa et en plaçant sous l’autorité du dalaï-lama la région de Kartzé (au Sichuan). Les habitants de la région du Kham sont appelés Khampas. Au cours de la République de Chine (1911-1949), la plupart de la région faisait alors administrativement partie de Xikang. (qui a eu le statut de "région administrative spéciale" jusqu'en 1939, quand il est devenu pour un temps une province chinoise ).
Au VIIe siècle, l'unificateur du Tibet, Songtsen Gampo
(629-650), pour consolider ses alliances politiques, prend pour épouses la
princesse népalaise Bhrikuti, fille du roi Amsuvarma, et la princesse chinoise
Wencheng Gongzhu, nièce de l'empereur Tang Taizong. Les Tibétains attribuent
l’introduction du bouddhisme à ces deux reines. |
![]() Tout près de là, nous allons visiter
le petit village de SHIGU
(qui
signifie "Tambour de Pierre") aux environs de 200 mètres d'altitude. Durant la
dynastie des Han (206 av. J.-C. à 220), Shigu était un point stratégique sur la
Route de la soie.
Tout près de là, nous allons visiter
le petit village de SHIGU
(qui
signifie "Tambour de Pierre") aux environs de 200 mètres d'altitude. Durant la
dynastie des Han (206 av. J.-C. à 220), Shigu était un point stratégique sur la
Route de la soie.
Justement, nous commençons par le monument du Tambour de Pierre abrité par un
pavillon. Cela n'a rien d'un tambour, autre que d'apparence, car c'est une stèle
ronde de
marbre
blanc de 1,50m de diamètre datant de la dynastie des Ming (1368- 1644) sur les
deux faces de laquelle sont gravés des idéogrammes relatant les exploits du clan
des Mu, l'aristocratique des Naxi. Bien plus tard, Kubilay Khan et son
armée traversèrent ici le Yangtse avec l'aide des villageois. En effet, la
troupe se présenta lorsque le Yangtsé était en crue et c'est avec des peaux
d'animaux cousues et gonflées fournies par les villageois que ce prestigieuxe guerrier
parvint à faire franchir l'obstacle à ses chevaux et à ses hommes. Les Mongols
établirent un bureau administratif à Shigu. Au cours de l’histoire récente, la
seconde et la sixième Armée rouge traversèrent aussi la rivière ici durant leur
Longue Marche vers le nord pour combattre l’envahisseur japonais. Un monument
aux martyrs de la guerre a été érigé sur une colline dans la ville.
Au pied de la colline coiffée d'une pagode qui domine la bourgade, la visite se poursuit par le petit Pont Suspendu avec ses petits pavillons aux extrémités. Dans le village, une paysanne en costume Naxi vend des légumes. Comme on le verra par la suite, la population est vraiment multiethnique.

![]() Après quoi, ne pouvant utiliser le
sentier menant à la pagode, nous grimpons dan le vieux village par une rue
pentue et parfois transformée en escalier, dont le ciment du pavage refait par
endroit est encore tout frais. Nous arrivons devant le Monument commémorant le
passage de l'Armée Rouge lors de la Longue Marche en 1936. Il montre les soldats
sur des barques que les Naxi, hommes et femmes, aident à franchir le fleuve.
Près du monument, une dame pipi très âgée semble plongée dans un profond sommeil
sous l'ardeur du soleil de fin de matinée. Peut-être ne dort-elle finalement que
d'un oeil?
Après quoi, ne pouvant utiliser le
sentier menant à la pagode, nous grimpons dan le vieux village par une rue
pentue et parfois transformée en escalier, dont le ciment du pavage refait par
endroit est encore tout frais. Nous arrivons devant le Monument commémorant le
passage de l'Armée Rouge lors de la Longue Marche en 1936. Il montre les soldats
sur des barques que les Naxi, hommes et femmes, aident à franchir le fleuve.
Près du monument, une dame pipi très âgée semble plongée dans un profond sommeil
sous l'ardeur du soleil de fin de matinée. Peut-être ne dort-elle finalement que
d'un oeil?
Lorsque nous sommes à nouveau au bas du village, dans la partie récente, il est bientôt midi et Delphine qui, comme à l'habitude, ne s'est pas soucier d'un endroit pour le déjeuner se met en quête. Mais en ce dimanche 5 avril, jour de Pâques chez nous, c'est ici le jour de la Fête des Morts, fixée au 15e jour du 7e mois lunaire. Donc de nombreux habitants Han, y compris ceux qui tiennent un restaurant, sont partis honorer leurs ancêtres sur les tombes dans la montagne. Souvent, ils vont sacrifier un poulet et pique-niquer en famille près de la tombe et y déposer des billets de fausse monnaie qu'ils n'ont plus le droit de brûler à cause du risque d'incendie.
![]() Tout espoir n'est pas perdu
pour cette fois. Le restaurant Laojunshan qui semblait fermé ouvre pour nous et aussi pour une tablée de Chinois. Face à cette aubaine, la
grand-mère en costume tibétain se met à astiquer les tables fébrilement.
Certains curieux qui jettent un oeil dans la cuisine trouvent que celle-ci
mériterait quant à elle plus qu'un brin de ménage. Comme il n'y a pas de toilettes pour les
convives, un petit tour aux toilettes publiques, propres, du grand parking.
C'est l'occasion de voir quel parc automobile on trouve dans cet endroit perdu.
Eh bien ! Des berlines récentes aux vitres teintées et même une Peugeot 307 et
une Peugeot 408 de
fabrication chinoise (PSA est bien implanté en Chine, ce qui n'est pas le cas de
Renault). Et ? Une Porsche Cayenne noire, un bijou fort prisé des
Chinois riches. En Europe, selon les modèles et les équipements, le prix varie
entre 60 000 et 170 000€,
un prix qu'il faut doubler ici puisque c'est un véhicule d'importation
lourdement taxé comme l'indique
Delphine. Plus communes sont les petites
berlines Volkswagen des taxis chinois, modèle Santana surtout
introduit en 1981 et produit jusqu'en 2013 et modèle Jetta
introduit 10 ans plus tard.
Tout espoir n'est pas perdu
pour cette fois. Le restaurant Laojunshan qui semblait fermé ouvre pour nous et aussi pour une tablée de Chinois. Face à cette aubaine, la
grand-mère en costume tibétain se met à astiquer les tables fébrilement.
Certains curieux qui jettent un oeil dans la cuisine trouvent que celle-ci
mériterait quant à elle plus qu'un brin de ménage. Comme il n'y a pas de toilettes pour les
convives, un petit tour aux toilettes publiques, propres, du grand parking.
C'est l'occasion de voir quel parc automobile on trouve dans cet endroit perdu.
Eh bien ! Des berlines récentes aux vitres teintées et même une Peugeot 307 et
une Peugeot 408 de
fabrication chinoise (PSA est bien implanté en Chine, ce qui n'est pas le cas de
Renault). Et ? Une Porsche Cayenne noire, un bijou fort prisé des
Chinois riches. En Europe, selon les modèles et les équipements, le prix varie
entre 60 000 et 170 000€,
un prix qu'il faut doubler ici puisque c'est un véhicule d'importation
lourdement taxé comme l'indique
Delphine. Plus communes sont les petites
berlines Volkswagen des taxis chinois, modèle Santana surtout
introduit en 1981 et produit jusqu'en 2013 et modèle Jetta
introduit 10 ans plus tard.
Dans le petit marché en bord de rue, on peut voir une femme Yi noire (ou
Lolo, les Yi noirs étaient puissants, au sommet d'une société organisée
en castes, possédant propriétés et esclaves) en costume avec sa grande coiffe noire carrée
fixée à l'arrière de la tête, des rubans de couleurs vives agrémentant celles
des jeunes femmes célibataires. Une autre femme vue de dos en costume bleu clair
et grenat appartient à une ethnie que je n'ai pas pu identifier.
Un déjeuner simple et très bien servit par la grand-mère en costume tandis qu'en
cuisine
la fille ne le porte plus. La grand-mère fume en laissant voir ses avant-bras
tatoués de cercles foncés.
![]()
Les Gorges du Saut du Tigre![]()
![]()
![]() En quittant le village,
Delphine
nous
indique que non loin de Shigu, dans une vallée
affluente du Yangtsé, un village connaît trois aurores, le soleil passant devant
des pics.
En quittant le village,
Delphine
nous
indique que non loin de Shigu, dans une vallée
affluente du Yangtsé, un village connaît trois aurores, le soleil passant devant
des pics.
Sur une soixantaine de kilomètres, par moment la route coupe en montagne avec
des ponts et viaducs. Du bus, nous apercevons des tombeaux Han sur lesquels ont été
déposées de offrandes; d'ailleurs les files de belles voitures arrêtées sur le
bord de la route au milieu de nulle part sont un indice de la visite des familles
à leurs défunts.
![]() Nous ne pouvons pas résister devant les paniers de belles
fraises que les paysans vendent au bord de la route. En guise de Chantilly pour
les accompagner, nous avons la vue sur les glaciers et les neiges des montagnes
qui sont maintenant face à nous. Bientôt celle-ci longer le fleuve Yang-tse que
nous descendons en rive gauche dans une vallée qui prend l'allure d'un canyon.
Nous ne pouvons pas résister devant les paniers de belles
fraises que les paysans vendent au bord de la route. En guise de Chantilly pour
les accompagner, nous avons la vue sur les glaciers et les neiges des montagnes
qui sont maintenant face à nous. Bientôt celle-ci longer le fleuve Yang-tse que
nous descendons en rive gauche dans une vallée qui prend l'allure d'un canyon.
Quelque temps
avant la billetterie
du site aménagé
Hutiào Xiá,
le Saut du Tigre,
des statues kitchs de yaks géants nous signalent que nous sommes dans un
environnement tibétain. A la billetterie, nous embarquons Linda, une guide
locale tibétaine que nous aurons ici et à Zhongdian d'où elle est originaire.
Après nous avoir salués d'un "tashi delek", elle s'exprime en anglais mais est beaucoup plus volubile que sa collègue de Lijiang, et drôle de surcroît!
Tandis que la route prend de la hauteur au-dessus des gorges, Linda nous redit
en anglais l'origine de la mythique Shangri-La.
Tout part de l'explorateur et géographie Joseph Rock
évoquant dans ses
récits ces régions orientales pré-himalayennes
de l’ancien Kham tibétain, récits qu'il publiait dans le
National Geographic. Cela mêlé au mythe indo-bouddhiste de de
Shambhala ("lieux du bonheur paisible") a été à l'origine de
l'inspiration de l'écrivain britannique James Hilton pour son roman Lost
Horizon ("Les Horizons Perdus") publié en 1933 où il évoque l'histoire de
rescapés d'un accident d'avion qui réussissent à atteindre une lamaserie nommée
Shangri-La, aux confins de l’Himalaya et du Tibet.
Il n'en faut pas plus pour créer un engouement touristique et de nombreuses
villes et régions tentent de s'accaparer le nom mythique. La ville de Zhongdian
vers laquelle nous allons n'y échappe pas
puisque c’est de ce nom que fut rebaptisé le comté de Zhongdian
en 2001. Un groupe d'hôtels de luxe
singapourien s'en est même emparé en 1971 et a prospéré depuis puisque maintenant
présent un peu partout dans le monde avec 90 établissements de prestige et de
nombreux autres projets.
Ici, sur
une bonne quinzaine de kilomètres, les gorges livrent passage au fleuve
entre les deux sommets de la Yulong Xue Shan (5596m) et de la Haba Xue Shan (5396m), par une
série de rapides
sur un dénivelé de
près de 200
mètres
au pied d'escarpements abrupts de 2000
mètres de hauteur, et prétendent au titre du canyon le plus profond au monde.
Delphine
évoque la légende à l'origine du nom: un tigre pourchassé était parvenu
à franchir le fleuve à cet endroit où il est impossible de nager mais où il est
étroit (tout de même large de 25 à 30m.) et un gros rocher se trouve
judicieusement tombé au milieu du lit du fleuve. Bien sûr, on n'a pas manqué
d'ériger d'évocatrices mais superflues statues du tigre mimant ce saut.
![]()


Route de haute montagne pour
ZHONGDIAN (Shangri-la)![]()
![]()
![]() Il reste une bonne centaine de kilomètres pour arriver à Zhongdian. Sur un
peu moins de 10km, nous revenons jusqu'à la confluence du fleuve avec une
rivière affluente sur sa rive droite au niveau de Dong Huan
puis nous prenons une route de montagne (nationale 214) qui suit cette rivière. Le paysage
est assez austère, la vallée étroite et par moment des barrages ont été
construits pour la production hydro-électrique. La route est éprouvante
pour les moteurs comme on le voit avec un camion immobilisé et signalé par des
blocs de pierre. Quelques traversées de tunnels, quelques maigres hameaux en
contrebas, puis sur notre droite (Est), de nouveaux aperçus sur les glaciers de sommets
de la montagne
Haba Xue culminant
à plus de 5000 mètres. Par endroit, le boisement en pins des montagnes cède la place à des
cultures en terrasses mais les cultures n'ont pas encore poussé car du fait de
l'altitude, l'hiver se prolonge longuement ici. L'orge est la seule céréale à
pousser car elle se sème au printemps. Le sarrasin qui est une culture d'été
pour terres pauvres, convient aussi mais et sa culture est surtout pratiquée par les Han.
Il reste une bonne centaine de kilomètres pour arriver à Zhongdian. Sur un
peu moins de 10km, nous revenons jusqu'à la confluence du fleuve avec une
rivière affluente sur sa rive droite au niveau de Dong Huan
puis nous prenons une route de montagne (nationale 214) qui suit cette rivière. Le paysage
est assez austère, la vallée étroite et par moment des barrages ont été
construits pour la production hydro-électrique. La route est éprouvante
pour les moteurs comme on le voit avec un camion immobilisé et signalé par des
blocs de pierre. Quelques traversées de tunnels, quelques maigres hameaux en
contrebas, puis sur notre droite (Est), de nouveaux aperçus sur les glaciers de sommets
de la montagne
Haba Xue culminant
à plus de 5000 mètres. Par endroit, le boisement en pins des montagnes cède la place à des
cultures en terrasses mais les cultures n'ont pas encore poussé car du fait de
l'altitude, l'hiver se prolonge longuement ici. L'orge est la seule céréale à
pousser car elle se sème au printemps. Le sarrasin qui est une culture d'été
pour terres pauvres, convient aussi mais et sa culture est surtout pratiquée par les Han.
![]() Un peu avant le haut col que nous allons bientôt franchir,
un vaste panorama s'offre à nous, l'occasion d'une agréable pause puisqu'il y a une heure que
nous avons repris la route. 17H, un moment favorable pour la lumière puisque le
paysage se trouve à l'est.
Un peu avant le haut col que nous allons bientôt franchir,
un vaste panorama s'offre à nous, l'occasion d'une agréable pause puisqu'il y a une heure que
nous avons repris la route. 17H, un moment favorable pour la lumière puisque le
paysage se trouve à l'est.
Un superbe paysage de haute montagne,
sans que nous ayons eu le moindre effort à faire pour y accéder. Un belvédère en bois est
installé ici, sans doute par le marchand de produits régionaux typiques qui y tient
boutique: champignons, une sorte de noix,
des sortes de navets confits,
de la viande séchée de yak, des pénis
séchés de......
| |||||
Delphine
nous livre quelques autres
informations sur les Tibétains.
1 -
On dit que traditionnellement les Tibétains ne se lavaient (ou n'étaient
lavés) que 3 fois au cours de leur existence: quand ils naissent,
quand ils se marient, quand ils sont morts. Ils ne sont pas familiers de
l'eau en raison moins
sans doute
de sa rareté que de leur vie nomade et de la rigueur du climat.
L'extrait suivant d'une publication de 1898 est édifiant:
«[...]Ils conservent fort longtemps leurs vêtements sans les changer, les brosser, ni les secouer, les gardant même la nuit, s'en servant comme de torchons et d'essuie-mains, ne les quittant que lorsqu'ils s'en vont d'eux-mêmes. Ils ne se lavent jamais le corps, et ce n'est que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qu'ils se lavent le visage et les mains. Toutefois, pour se préserver des morsures du vent ils s'enduisent tout le corps de beurre, rance autant que possible, préférant manger l'autre.[...]»
extrait de "Le TIBET et ses habitants" de Jean GRENARD (édit. www.chineancienne.fr Août 2011)
Le gouvernement a tenté de remédier au manque d'hygiène en faisant la promotion de capteurs solaires dans ces contrées où le soleil ne manque pas. Cet équipement devait permettre de produire de l'eau chaude à bon compte. La première tentative a été un fiasco car sitôt la subvention versée elle a été bue (de l'eau-de-vie). La seconde a été tout autant un échec car sitôt installés les équipements ont été revendus. Il a fallu un long travail de sensibilisation et d'éducation pour que la population intègre ce progrès lors d'une troisième campagne.
2 -
Les coutumes matrimoniales et patrimoniales tibétaines sont encore très
particulières, du moins dans les campagnes.
En général, l'aîné(e), fille ou garçon? reste avec ses parents et héritera
de leur maison. Il ou elle ne peut donc pas épouser un(e) aîné(e) d'une
autre famille.
Parfois, si la famille est pauvre, elle peut placer sa ou ses fille(s)
dans une ou l'autre forme d'union polygame
afin
de recevoir une plus grosse dot (4ou 5 yaks au lieu de 3):
polygynie si 2 soeurs épousent un même garçon ou, à l'opposé,
polyandrie si une
fille épouse deux frères. Dans ce dernier cas, la situation est délicate
car pendant l'été, le mari part nomadiser avec les troupeaux or il y a deux
maris. La solution consiste à ce que l'un des maris parte avec le troupeau
une année sur deux, l'autre restant auprès de l'épouse...
3 -
Les coutumes funéraires
qui
vont vous sembler particulièrement macabres,
sont différenciées selon la qualité des personnes et les
circonstances du décès:
- "Funérailles de la Pagode" avec incinération pour les moines (le bois est rare
à ces altitudes).
- "Funérailles du Ciel" (Tiang Zan ou Jhator) pour les gens
ordinaires: le corps est découpé en 8 morceaux qui sont enduits de beurre de yak
et déposés au sommet d'une montagne pour être dévorés par les vautours et les
corbeaux. Les os sont ensuite broyés pour faciliter le travail des charognards.
Cette
pratique n'est pas très éloignées des rites funéraires des zoroastriens ou
parsis de Perse, d'Ouzbékistan ou d'Inde, avec les "Tours du silence" sur
lesquels les cadavres sont déposés afin que les oiseaux charognards le
décharnent. Dans les années 1960 et 197070, les
autorités chinoises ont tenté a été d'interdite
une
pratique
considérée comme barbare. Cependant, sous la pression populaire, elle est de
nouveau autorisée depuis les années 1980.
- "Funérailles de l'Eau" pour les personnes mortes pendant qu'elles font le
pèlerinage à Lhassa,
les
jeunes enfants,
les
mendiants, les veufs et veuves sans enfant. Le corps est démembré puis jeté dans
un fleuve. Ces funérailles sont un peu équivalentes aux précédentes car les
poissons sont également des créatures divines. Cette pratique est
maintenant formellement interdite.
- "Funérailles de la Terre" pour les criminels et les personnes décédées
de maladies contagieuses ou d'accident (mauvais karma). Leur âme ira en Enfer.
|
|
|
![]() L'hôtel Shangrila
Old Town est également bien venu. Il est récent, très fonctionnel et on
est bien chauffé par le sol car n'oublions pas qu'il va geler cette nuit.
L'hôtel Shangrila
Old Town est également bien venu. Il est récent, très fonctionnel et on
est bien chauffé par le sol car n'oublions pas qu'il va geler cette nuit.![]()
Lundi 6 Avril
- découverte de ZHONGDIAN
![]() Départ en autocar à 9H seulement car les distances seront courtes
aujourd'hui. Au petit matin, il faisait -1° et les montagnes voisines sont
saupoudrées de neige fraîche. Médiocres prévisions pour la journée, avec au
mieux à peine 10° (sous abri) et risque de pluie.
Départ en autocar à 9H seulement car les distances seront courtes
aujourd'hui. Au petit matin, il faisait -1° et les montagnes voisines sont
saupoudrées de neige fraîche. Médiocres prévisions pour la journée, avec au
mieux à peine 10° (sous abri) et risque de pluie.
La montagne de Meili dite "Prince de la Montagne des Neiges" que nous avons vue sur de grandes affiches à l'entrée de la ville hier soir se situe loin d'ici (à 200 km de Zhongdian par route et à 10 km à vol d'oiseau au nord-ouest de Deqin) entre la rivière Nujiang et le Mékong, aux portes de la province du Sichuan. Cette montagne enneigée est la plus imposante et mystérieuse du Yunnan avec ses 13 sommets qui culminent à 6000 m. d’altitude en moyenne et sont surnommés "les 13 sommets du Prince". Le plus haut d’entre eux, Kawagebo, atteint 6740 m. et se trouve être la plus haute montagne de la province du Yunnan.
![]() En
traversant des quartiers neufs et tranquilles, nous partons en direction du
nord. Encore peu de Tibétains dans les rues, quelques femmes en costume et un
homme aux cheveux longs conduisant un yak blanc. On reverra celui-ci... On
s'arrête à un grand parking près d'un imposant bâtiment où se trouve une
billetterie et une maquette de la zone touristique du monastère. De là, il faut
utiliser les navettes locales qui conduisent au pied du monastère. En tout, il y
a environ 6km depuis le centre de la vieille ville.
En
traversant des quartiers neufs et tranquilles, nous partons en direction du
nord. Encore peu de Tibétains dans les rues, quelques femmes en costume et un
homme aux cheveux longs conduisant un yak blanc. On reverra celui-ci... On
s'arrête à un grand parking près d'un imposant bâtiment où se trouve une
billetterie et une maquette de la zone touristique du monastère. De là, il faut
utiliser les navettes locales qui conduisent au pied du monastère. En tout, il y
a environ 6km depuis le centre de la vieille ville.
Le Monastère Sumtseling
(XVIIe s.)![]()
![]()
![]()
![]() Le Monastère Sumtseling (ou Dongzhulin ou encore Songzanlin) a été construit
en 1667 (1679 selon quelques sources) par le 5e Dalaï-lama Sonam Gyatso (1617-1682) qui fut le premier des dalaï-lamas à exercer
un pouvoir théocratique intervenant dans le domaine temporel en sus des affaires religieuses, dans un système de
gouvernement appelé Gaden Phodrang que l'ancien système impérial chinois
admettait dans le cadre d'une relation nommé de Chö-yon. Ce traité qui
existait avec les Mongols depuis 1247 définissait une répartition des rôles sans
prévalence d’une autorité sur l’autre. Il s'est poursuivit avec certains
empereurs de la dynastie Ming, puis avec la dynastie mandchoue des Qing jusqu'en
1910, date à laquelle ils envahirent le Tibet. Cependant pendant la Révolution
nationaliste puis la Guerre Civile qui ont suivi la fin de l'Empire, le Tibet
réussit à conserver une indépendance de fait jusqu'à l'invasion de son
territoire par l'Armée de Libération Nationale chinoise en 1950. Le régime
communiste ne reconnaît pas le Dalaï-lama qui vit en exil en Inde. La succession
du Xe Panchen-lama en 1995 a été également conflictuelle. Gedhun Choekyi Nyima,
né en 1989, l'enfant reconnu par le Dalaï-lama comme XIe Panchen-lama a été
emprisonné (il serait libre au Tibet) et le Parti Communiste dans une parodie
d'investiture a choisi un autre enfant, Gyancain Norbu, né en 1990, fils d’un
membre du Parti Communiste Chinois...
Le Monastère Sumtseling (ou Dongzhulin ou encore Songzanlin) a été construit
en 1667 (1679 selon quelques sources) par le 5e Dalaï-lama Sonam Gyatso (1617-1682) qui fut le premier des dalaï-lamas à exercer
un pouvoir théocratique intervenant dans le domaine temporel en sus des affaires religieuses, dans un système de
gouvernement appelé Gaden Phodrang que l'ancien système impérial chinois
admettait dans le cadre d'une relation nommé de Chö-yon. Ce traité qui
existait avec les Mongols depuis 1247 définissait une répartition des rôles sans
prévalence d’une autorité sur l’autre. Il s'est poursuivit avec certains
empereurs de la dynastie Ming, puis avec la dynastie mandchoue des Qing jusqu'en
1910, date à laquelle ils envahirent le Tibet. Cependant pendant la Révolution
nationaliste puis la Guerre Civile qui ont suivi la fin de l'Empire, le Tibet
réussit à conserver une indépendance de fait jusqu'à l'invasion de son
territoire par l'Armée de Libération Nationale chinoise en 1950. Le régime
communiste ne reconnaît pas le Dalaï-lama qui vit en exil en Inde. La succession
du Xe Panchen-lama en 1995 a été également conflictuelle. Gedhun Choekyi Nyima,
né en 1989, l'enfant reconnu par le Dalaï-lama comme XIe Panchen-lama a été
emprisonné (il serait libre au Tibet) et le Parti Communiste dans une parodie
d'investiture a choisi un autre enfant, Gyancain Norbu, né en 1990, fils d’un
membre du Parti Communiste Chinois...
Jusqu'au XVIIe siècle, le monastère de cet endroit était
nommé Chongchonggang qui, en tibétain, signifie "un temple au bord du
lac avec des grues". Au début, Chongchonggang était un temple de la secte
Kagyupa (Bonnets blancs) et avait seulement 16 lamas. Plus tard, à la suite de
conflits avec la secte Gulugpa (Bonnets Jaunes)
ou Gelupa ,
fondée par
Tsongkhapa, il a donc été converti et
a fusionné en 1667 avec 7 autres
petits temples comme il vient d'être dit. A la fin de la dynastie Qing, il y avait plus de 700 lamas et 10
bouddhas vivants dans le monastère. Déjà reconstruite une première fois en 1982,
la structure n’était pas assez solide et menaçait de s’écrouler, c'est pourquoi
en 1985 une rénovation à grande échelle a commencé et a duré 7 ans.
Delphine
précise que le pavillon central n'est rouvert que depuis 6 mois. En
1986, le 10e Panchen Lama-Chosgyi Gyantsen est passé au monastère lors
d'une tournée d'inspection et a parrainé sa rénovation.
Situé à une altitude de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au pied de la
montagne enneigée Baimang, c'est le plus grand
monastère tibétain du Yunnan et il héberge 500 ou 600 moines (le chiffre varie
selon les sources).
![]() A
l'approche du monastère, la vue est saisissante, avec un petit lac
au pied
de la colline où est érigé le monastère.
L'ensemble, reflété dans ce lac, serait encore plus extraordinaire sous un grand
ciel bleu.
A
l'approche du monastère, la vue est saisissante, avec un petit lac
au pied
de la colline où est érigé le monastère.
L'ensemble, reflété dans ce lac, serait encore plus extraordinaire sous un grand
ciel bleu.
Un grand escalier central mène jusqu’au temple principal, le temple Dratsang.
Delphine
a la hantise que nous fassions un malaise par l'effet combiné de
l'altitude et de l'effort. Elle connaît un de ces collègues guides qui a été
confronté au décès d'un de ses clients. Le risque est-il grand? En voyant
certains Chinois munis de petites bouteilles à oxygène, on pourrait le croire...
A fur et à mesure de notre ascension, nous découvrons une quinzaine de temples.
Nous
allons d'édifice en édifice, descendant et remontant de petits
escaliers dans cet ensemble complexe d'édifices enchevêtrés. Nous croisons très
peu de Chinois.
| ||||
Deux chose frustrantes à signaler:
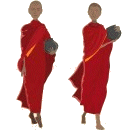
- interdiction de faire des photos intérieures, même sans flash. Un panneau
ajoute d'autres prohibitions moins gênantes lorsque l'on est dans les édifices :
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, pas de lunette de soleil, pas
de couvre-chef et ne pas faire de bruit...
- au moment de notre visite, entre 9H30 et 10H30 (il faudrait pour bien faire y
consacre au moins le double), où pouvaient être passés les 600 moines (400 ou
500 selon certaines sources)? Pas vus en
salle d'études ou de prières...
Etaient-ils dans d'autres salles ou bien dans leurs chambres? J'en ai tout juste
vu une dizaine, de 1 à 5, en quatre endroits du site... et quelques uns au
marché un peu plus tard.
| ||||
Ici
de petits moulins à prières en laiton, ailleurs un gros moulin.
![]()
![]() Plus en s'élève
et plus la vue s'élargit, sur le lac et ses stupas ainsi que sur le
village voisin et les montagnes enneigées et ennuagées. Les toits dorés sont
ornés de pinacles et ornements de faitages également dorés et sur les
côtés de makaras dorés, sortes de gargouilles chimériques monstrueuse. Il faut
ajouter, les lions dorés sur leurs quatre pattes ou dressés, gueule
ouverte... Sans oublier au-dessus de l'entrée des édifices un ensemble doré:
le cerf symbolisant l'expérience de la grande félicité, la biche
symbolisant la réalisation de la vacuité, ils sont de part et d'autre de la roue
du dharma qu'ils regardent et qui, elle, symbolise l’union des deux. On les
retrouve peints en blanc sur les grandes tentures, genre catafalques, qui
habillent les entrées.
Plus en s'élève
et plus la vue s'élargit, sur le lac et ses stupas ainsi que sur le
village voisin et les montagnes enneigées et ennuagées. Les toits dorés sont
ornés de pinacles et ornements de faitages également dorés et sur les
côtés de makaras dorés, sortes de gargouilles chimériques monstrueuse. Il faut
ajouter, les lions dorés sur leurs quatre pattes ou dressés, gueule
ouverte... Sans oublier au-dessus de l'entrée des édifices un ensemble doré:
le cerf symbolisant l'expérience de la grande félicité, la biche
symbolisant la réalisation de la vacuité, ils sont de part et d'autre de la roue
du dharma qu'ils regardent et qui, elle, symbolise l’union des deux. On les
retrouve peints en blanc sur les grandes tentures, genre catafalques, qui
habillent les entrées.
Un mot au sujet des cuisines avec à l'entrée un avertissement d'interdiction
d'accès aux femmes (et accessoirement aux fumeurs)!
| ||||
Peu
à peu le ciel se dégage et devient plus lumineux. Dans
le monastère ou au pied, on croise beaucoup de Tibétains avec un masque sur la
bouche. On ne peut pas parler de pollution par ici. Alors, pour protéger les
voies respiratoires de l'air froid ou de maladies que l'on ne veut pas attraper
ou transmettre?
![]()
Le village tibétain voisin du monastère et l'accueil par une famille![]()
Après que nous soyons redescendus, nouveaux regards tournés vers la colline coiffée du monastère.
![]() La piété se pratique aussi en dehors des sanctuaires: ici, une femme égrène son mâlâ, le chapelet bouddhique aux 108 grains (somme
numérologique =9, nombre bénéfique!) utilisé pour la récitation des mantras et,
là, un camion dont la calandre est ornée de ruban or et vert et le pare-choc de deux croix
gammées ou svastikas dextrogyres (bras supérieur tourné vers la droite)
symbolisant la renonciation et la course visuelle du soleil chez les
bouddhistes tibétains de la secte des Bonnets Jaunes.
Non loin de là, on peut voir des "cochons-yaks" noirs à longs poils qui en toute
liberté fouinent dans les gravats des bâtiments en démolition.
La piété se pratique aussi en dehors des sanctuaires: ici, une femme égrène son mâlâ, le chapelet bouddhique aux 108 grains (somme
numérologique =9, nombre bénéfique!) utilisé pour la récitation des mantras et,
là, un camion dont la calandre est ornée de ruban or et vert et le pare-choc de deux croix
gammées ou svastikas dextrogyres (bras supérieur tourné vers la droite)
symbolisant la renonciation et la course visuelle du soleil chez les
bouddhistes tibétains de la secte des Bonnets Jaunes.
Non loin de là, on peut voir des "cochons-yaks" noirs à longs poils qui en toute
liberté fouinent dans les gravats des bâtiments en démolition.
| ||||
![]() Derniers regards vers le monastère dont
les ors scintillent avec la dissipation des nuages tandis que nous marchons dans
les ruelles poussiéreuses du petit village de Conggulong installé au pied du monastère. Le
haut des murs de pignons des grosses maisons tibétaines est orné de peintures
figuratives (yaks, personnages, symboles religieux).
Derniers regards vers le monastère dont
les ors scintillent avec la dissipation des nuages tandis que nous marchons dans
les ruelles poussiéreuses du petit village de Conggulong installé au pied du monastère. Le
haut des murs de pignons des grosses maisons tibétaines est orné de peintures
figuratives (yaks, personnages, symboles religieux).
Manifestement, on ne connaît ni plan d'urbanisme, ni contraintes
architecturales. Les maisons neuves poussent parmi les anciennes, les toits en
tôle voisinent avec les toits couverts de dalles de schiste, genre lauzes.
Les belles maisons à deux niveaux
sont pourvues d'une terrasse en rez-de-chaussée, et d'un balcon équivalent à l'étage, ce qui
laisse apparaître en façade une structure avec quatre gros piliers faits de troncs
d'arbres. En face d'une maison pourvue de trois drapeaux tibétains et du drapeau
rouge chinois, nous arrivons chez une famille où l'on doit goûter au thé au
beurre de yak. C'est manifestement une famille d'agriculteurs aisés et la
maîtresse de maison a trouvé un job avec l'accueil des touristes et ainsi elle
peut "mettre du beurre de yak dans
son thé".
Nous ne visitons pas l'étable qui traditionnellement se trouve au
rez-de-chaussée des maisons à étage, comme dans les vieux chalets de nos
montagnes. Même type d'interrogation qu'au monastère, non pas à propos de moines
mais de yaks. Dans cette ferme, où sont donc ces animaux? L'hiver étant passé,
les troupeaux nomadisent sur les pâturages dans la montagne.
|
|
|
![]() Le moment
de
la dégustation du thé
au beurre de yak, tant redouté par les uns, attendu par les autres, arrive. Les uns, dont je fais
partie, ont eu de redoutable expériences antérieures où la "rancitude" du
beurre restait en bouche aussi longtemps que la brûlure des pires piments. Mais,
on voit que sur la table sont disposés également des pâtisseries (beignets,
gâteau fourré à la rose, croquette de riz soufflé) permettant de contourner
l'obstacle ou d'aider à faire passer. Le moment de l'épreuve est venu:
dans une sorte de petit bol, on verse un thé au lait qui aurait plutôt l'aspect
d'un lait au thé et du beurre de yak y aurait été ajouté. Après un temps
d'hésitation je goûte et ne trouve aucun goût rance au breuvage. Je suppose
qu'il y a une formule spéciale pour touristes, au beurre frais... Il faut garder
un peu de thé au fond de bol et ajouter une cuillérée de farine d'orge que l'on
délaye pour faire une pâte qui n'est pas du tout mauvaise ma foi. Séance photo
avec nos hôtesses que nous quittons à midi et demi.
Le moment
de
la dégustation du thé
au beurre de yak, tant redouté par les uns, attendu par les autres, arrive. Les uns, dont je fais
partie, ont eu de redoutable expériences antérieures où la "rancitude" du
beurre restait en bouche aussi longtemps que la brûlure des pires piments. Mais,
on voit que sur la table sont disposés également des pâtisseries (beignets,
gâteau fourré à la rose, croquette de riz soufflé) permettant de contourner
l'obstacle ou d'aider à faire passer. Le moment de l'épreuve est venu:
dans une sorte de petit bol, on verse un thé au lait qui aurait plutôt l'aspect
d'un lait au thé et du beurre de yak y aurait été ajouté. Après un temps
d'hésitation je goûte et ne trouve aucun goût rance au breuvage. Je suppose
qu'il y a une formule spéciale pour touristes, au beurre frais... Il faut garder
un peu de thé au fond de bol et ajouter une cuillérée de farine d'orge que l'on
délaye pour faire une pâte qui n'est pas du tout mauvaise ma foi. Séance photo
avec nos hôtesses que nous quittons à midi et demi.
![]()
![]() Pour rejoindre la route bitumée et
attraper une navette, nous continuons notre traversée du village. Encore de
"cochons-yaks", un vaste terrain avec d'énormes troncs d'arbres destinés à
servir de piliers de maisons et des séchoirs à gerbes de céréales. Près de là, une famille
est en
train de labourer avec une araire tirée par deux yaks. Enfin, une dernière vue sur
le monastère qui scintille au soleil enfin apparu.
Pour rejoindre la route bitumée et
attraper une navette, nous continuons notre traversée du village. Encore de
"cochons-yaks", un vaste terrain avec d'énormes troncs d'arbres destinés à
servir de piliers de maisons et des séchoirs à gerbes de céréales. Près de là, une famille
est en
train de labourer avec une araire tirée par deux yaks. Enfin, une dernière vue sur
le monastère qui scintille au soleil enfin apparu.
Il est 13H15 lorsque nous sommes revenus en ville, après avoir traversé des
quartiers modernes au nord de la ville, afin de faire un tour au
marché.![]()
Zhongdian: un tour au marché![]()
Les
Tibétaines pourtant habituées au froid de leurs montagnes ont l'air
frigorifiées, engoncées dans leurs vestes matelassée, les écharpes rabattues sur
le visage, les cheveux couverts de leur coiffe-turban traditionnelle ou d'une
caquette.
Delphine
nous signale que beaucoup de boutiques et une bonne partie du marché
sont tenus par des Bai venus de Dali où ils retournent habiter pendant l'hiver.
| ||||
|
|
|
![]()
![]() L'autocar nous conduit un
autre quartier moderne pour déjeuner au restaurant de l'hôtel Zhaxidele
("Bonjour"). Nous nous sentons un peu perdus dans une grande salle de
spectacle décorée kitschement à la chinoise. Pendant le repas, un couple installé
à un bureau devant une série d'estampes tente de nous convaincre d'en acheter.
L'autocar nous conduit un
autre quartier moderne pour déjeuner au restaurant de l'hôtel Zhaxidele
("Bonjour"). Nous nous sentons un peu perdus dans une grande salle de
spectacle décorée kitschement à la chinoise. Pendant le repas, un couple installé
à un bureau devant une série d'estampes tente de nous convaincre d'en acheter.
Des plats assez originaux : légumes emmaillotés dans une tranche de poitrine
fumée, omelette aux herbes, petits galettes aux gruaux d'orge, des frites, une
soupe aux herbes, et en dessert une salade de fruits avec un curieux
nappage. Le tout accompagné d'une infusion de sarrasin.![]()
Zhongdian: colline Daguishan![]()
![]() :
Guishan si et Zhuangjing Tong (le moulin à prières géant)
:
Guishan si et Zhuangjing Tong (le moulin à prières géant)![]() Après le déjeuner, l'autocar nous
reconduit dans la vieille ville. Nous devions visiter
le Baiji Si ("le Temple du Coq
Blanc" ou "aux Cent Poulets")
mais au lieu de cela, on nous
conduit au pied de la colline Daguishan sous
un ciel redevenu bien gris. Sur la pente et au sommet se dressent les pavillons
du Guishan Si, un temple reconstruit en 2002, et le
Zhuangjing Tong, un gigantesque moulin à
prières tout doré mis en service en juin 2005. Entre le parking et la place,
on emprunte un pont arqué pour franchir un petit canal. Au centre de la place,
yak blanc est là pour les photos-souvenirs.
Après le déjeuner, l'autocar nous
reconduit dans la vieille ville. Nous devions visiter
le Baiji Si ("le Temple du Coq
Blanc" ou "aux Cent Poulets")
mais au lieu de cela, on nous
conduit au pied de la colline Daguishan sous
un ciel redevenu bien gris. Sur la pente et au sommet se dressent les pavillons
du Guishan Si, un temple reconstruit en 2002, et le
Zhuangjing Tong, un gigantesque moulin à
prières tout doré mis en service en juin 2005. Entre le parking et la place,
on emprunte un pont arqué pour franchir un petit canal. Au centre de la place,
yak blanc est là pour les photos-souvenirs.
![]()

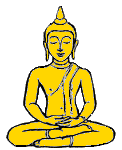 Nous commençons à gravir la pente en
direction du temple. Un premier temple est taoïste donc photographiable, ce qui
n'est pas le cas avec le temple bouddhiste suivant. Sur la gauche, un grand
temple au toit complexe n'est pas accessible car en travaux. En
revanche, sur la droite il y a pas mal de Chinois attirés par l'attraction qu'est
le moulin à prière géant, haut de 20 mètres (de 21 à 32 selon certaines sources) et
pesant 60 tonnes. Il contient 100 000 petits moulins à prières selon Lonely Planet. En bois, il est revêtu d'un parement doré sur lequel
différentes figures ont été martelées. Dans la partie basse, au-dessus de
bandeaux de svastikas et de symboles divers, les différentes ethnies sont
représentées. Plus haut, c'est la place du Bouddha, au-dessus de montagnes...
Pour le mettre en mouvement sur son axe, il faut au moins être une
demi-douzaine de personnes costaudes et motivées.
Nous commençons à gravir la pente en
direction du temple. Un premier temple est taoïste donc photographiable, ce qui
n'est pas le cas avec le temple bouddhiste suivant. Sur la gauche, un grand
temple au toit complexe n'est pas accessible car en travaux. En
revanche, sur la droite il y a pas mal de Chinois attirés par l'attraction qu'est
le moulin à prière géant, haut de 20 mètres (de 21 à 32 selon certaines sources) et
pesant 60 tonnes. Il contient 100 000 petits moulins à prières selon Lonely Planet. En bois, il est revêtu d'un parement doré sur lequel
différentes figures ont été martelées. Dans la partie basse, au-dessus de
bandeaux de svastikas et de symboles divers, les différentes ethnies sont
représentées. Plus haut, c'est la place du Bouddha, au-dessus de montagnes...
Pour le mettre en mouvement sur son axe, il faut au moins être une
demi-douzaine de personnes costaudes et motivées.
![]() L'autre intérêt du site est le panorama qu'il offre sur la vieille ville dont
une partie a échappé à l'incendie survenu il n'y a guère plus d'un an (11
janvier 2014) tandis que pour le reste, les maisons incendiées sont en phase
d'être remplacées par de nouvelles constructions.
L'autre intérêt du site est le panorama qu'il offre sur la vieille ville dont
une partie a échappé à l'incendie survenu il n'y a guère plus d'un an (11
janvier 2014) tandis que pour le reste, les maisons incendiées sont en phase
d'être remplacées par de nouvelles constructions.
|
Nous
redescendons sur la place. Près
du musée
révolutionnaire, petit coup d'oeil
dans le temple voisin dédié au
Bhodisattva
androgyne Avalokiteçvara ou, si l'on préfère Guanyin (déesse de la Miséricorde) dit aussi "Bouddha aux Mille Bras".
Quant au Musée Révolutionnaire de la Longue Marche, il n'aurait pas été
inintéressant de disposer de temps pour en faire une visite sérieuse. On y voit
Mao jeune et les troupes de l'Armée Populaire de Libération.
![]() Depuis 1925, une guerre civile a
éclaté entre les nationalistes du Kuomintang dont Tchang Kaï-chek vient de
prendre la tête après la mort de Sun Yat-sen, et les communistes à la tête
desquels va peu à peu s'imposer Mao Zedong. Ces derniers profitent de l'invasion
japonaise en Mandchourie survenue fin 1931 pour s'emparer de plusieurs régions.
Avec un million d'hommes, l'armée nationaliste va harceler les bastions
communistes, en particulier au Jiangxi, principal territoire de la "République
soviétique chinoise".
Depuis 1925, une guerre civile a
éclaté entre les nationalistes du Kuomintang dont Tchang Kaï-chek vient de
prendre la tête après la mort de Sun Yat-sen, et les communistes à la tête
desquels va peu à peu s'imposer Mao Zedong. Ces derniers profitent de l'invasion
japonaise en Mandchourie survenue fin 1931 pour s'emparer de plusieurs régions.
Avec un million d'hommes, l'armée nationaliste va harceler les bastions
communistes, en particulier au Jiangxi, principal territoire de la "République
soviétique chinoise".
En 1934, environ 130 000 hommes de l'Armée Rouge parviennent à fuir et, poursuivis, entament un périple de 12 500km
dans le sud-ouest de la Chine (où des Hui et Tibétains soutiennent les
nationalistes) pendant un peu plus d'un an. Ils ne sont plus qu'une vingtaine de
milles au début de 1935. En décembre 1936, les nationalistes et les communistes
finissent par conclure une alliance (temporaire) pour lutter contre les
envahisseurs japonais. Une alliance brisée dès septembre 1945, après la
capitulation japonaise, et les communistes qui remportent victoire sur victoire
en 1949, avec notamment la conquête du sud (le 21 avril, l'Armée populaire de
libération franchit le Yangtsé). Les dirigeants nationalistes et deux millions
de leurs sympathisants "s'exilent" sur l'île de Taïwan. Les combats cessent en
août 1950.
![]()
 Sous un ciel de plus en plus gris, nous
traversons à pied la vieille ville pour regagner notre hôtel. Cette
vieille ville nommée Dukezong ("village de la Lune" en tibétain) s'étendant sur
16km², a été construite il y a 1300 ans, ville-étape sur la Route de la Soie et
sur la Route du Thé et des Chevaux..
Sous un ciel de plus en plus gris, nous
traversons à pied la vieille ville pour regagner notre hôtel. Cette
vieille ville nommée Dukezong ("village de la Lune" en tibétain) s'étendant sur
16km², a été construite il y a 1300 ans, ville-étape sur la Route de la Soie et
sur la Route du Thé et des Chevaux..
Le samedi 11 janvier 2014, à 1h27, ici un incendie d'origine accidentelle
a détruit 340 maisons (sur 700), des thangkas tibétains précieux et d'autres
objets d'art tibétains mais n'a fait aucune victime. 2 600 personnes
ont été évacuées. Le précédent incendie de Shangri-La remontait au XVIIIe
siècle, sous l’empereur Qianlong.
En reconstruction, la vieille ville prend donc un sérieux coup de jeune.
Dans les ruelles pavées bordées de maisons en
bois traditionnelles on verra de plus en plus de pubs enfumés et d'échoppes d’artisanat
bouddhique. On ne s'y bouscule pas encore mais il faut s'attendre à de grands
changements avec un
tourisme de masse
quand la ligne de chemin de fer qui
relie Kunming à Lijiang depuis 2010 sera prolongée jusqu'ici.
Non loin d'un stupa sur une place, outre des maisons en bois, on peut voir
quelques très vieilles maisons aux murs fait de bloc de brique crue (adobe) à
l'enduit plus ou moins dégradé. Deux jeunes hommes chinois déambulent en se
tenant familièrement par dessus les épaules. Attitude surprenante en Chine où il
mal vu pour un couple de se tenir par la main (ou pire de s'embraser en public).
Puis ce sont des vitrines de souvenirs pour touristes. Seriez-vous tenté par un
couteau tibétain? à moins que vous sachiez lire les annonces placardées sur
les murs, avec des numéros de téléphone bien en évidence... Plus loin nous
passons près d'une brasserie artisanale où une femme est justement en train de
travailler le malt dans une grande cuve en bois. La pluie se met à tomber
sérieusement et nous devons presser le pas sous la pluie très froide. Nous
sommes bien au chaud dans nos chambres à 18H.![]() A 19H,
nous partons dîner dans un restaurant au pied de la colline
Daguishan où nous avions
passé l'après-midi. Un restaurant voisin de la place où l'on nous sert, en
dehors de quelques sautés et potage aux herbes, une sorte d'omelette
provençale et un plat en sauce avec des os de yak à peine recouverts de lambeaux
de viande...
A 19H,
nous partons dîner dans un restaurant au pied de la colline
Daguishan où nous avions
passé l'après-midi. Un restaurant voisin de la place où l'on nous sert, en
dehors de quelques sautés et potage aux herbes, une sorte d'omelette
provençale et un plat en sauce avec des os de yak à peine recouverts de lambeaux
de viande...![]() Il est
un peu plus de 20H quand nous quittons le restaurant et il fait bien froid sur la place. Seuls
les temples
et le moulin à prières géant donnent un peu de chaleur par la couleur
dorée qui les illuminent. En revanche, les villageois assemblés sur la place ont
la bonne recette pour se réchauffer, en pratiquant une danse
gymnique dans une belle ronde... Mais les regarder pendant une dizaine de minutes
nous suffit pour être
frigorifiés.
Il est
un peu plus de 20H quand nous quittons le restaurant et il fait bien froid sur la place. Seuls
les temples
et le moulin à prières géant donnent un peu de chaleur par la couleur
dorée qui les illuminent. En revanche, les villageois assemblés sur la place ont
la bonne recette pour se réchauffer, en pratiquant une danse
gymnique dans une belle ronde... Mais les regarder pendant une dizaine de minutes
nous suffit pour être
frigorifiés.
Les visites effectuées le
7 avril pendant l'escale à Kunming sont
traitées dans le premier volet de ce récit.![]() La
chambre bien chauffée que nous retrouvons à l'hôtel Shangrila est appréciée.
La
chambre bien chauffée que nous retrouvons à l'hôtel Shangrila est appréciée.
Mardi 7 Avril
- sur le trajet de retour: vol de ZHONGDIAN à
KUNMING
![]() Départ
en autocar à 7H15 seulement alors que nous avons pourtant un avion qui décolle à
8H40. Mais l'aéroport est tout proche, à moins de 6km, et il ne s'agit que d'un
vol intérieur.
Départ
en autocar à 7H15 seulement alors que nous avons pourtant un avion qui décolle à
8H40. Mais l'aéroport est tout proche, à moins de 6km, et il ne s'agit que d'un
vol intérieur. ![]() Décollage
effectif vers 9H et un vol de cinquante minutes sur un Airbus 319/320 de la
compagnie chinoise Lucky Air qui nous ramène pour quelques heures dans la Ville
de l'Eternel Printemps, après un survol du Lac Erhai et de Dali vers les 9H25...
Décollage
effectif vers 9H et un vol de cinquante minutes sur un Airbus 319/320 de la
compagnie chinoise Lucky Air qui nous ramène pour quelques heures dans la Ville
de l'Eternel Printemps, après un survol du Lac Erhai et de Dali vers les 9H25...