Une bonne nuit à bien
requinqué après nos deux jours à Nikko.
9H, ciel gris et menaçant une fois de plus. De l'hôtel on a une
vue sur la tour Skytree. Nous descendons au salon où est servi le petit-déjeuner
en utilisant un ascenseur très moderne, qui ne fonctionne que si l'on a une
carte magnétique idoine.
11H05, les retrouvailles.
Armel, que nous n'avions pas revue en chair et en os depuis plus d'un an, arrive
à la réception par l'escalator accompagnée de Shige, son mari japonais que nous
n'avions jusqu'à présent rencontré qu'en deux brèves occasions. Ils sont frais
et dispos alors qu'ils se sont envolés de Hong Kong au milieu de la nuit.
Privilège de la jeunesse!
Nous laissons
nos valises à la garde de la réception jusqu'à cet après-midi. Armel et Shige
ont laissé les leurs dans une consigne de gare.
A partir de maintenant, on va se la couler douce. On nous guide et on est
complètement pris en charge: déplacements, visites, restaurants...
Quartier
d'Asakusa: temple Senso-ji

 Cette redite sur Tokyo va en
pratique se limiter à une demi-journée et à deux visites.
Cette redite sur Tokyo va en
pratique se limiter à une demi-journée et à deux visites.
La première visite ne nécessite pas un long déplacement puisqu'il s'agit du
Temple Senso-ji que nous
avions visité avec le circuit en groupe il y a trois jours.
 Petit moment amusant avec les bâtons de divination,
O-Mi-Kuji, "bâtons chanceux"
ou "honorable loterie des dieux". Cette méthode divinatoire d'origine chinoise
s'est répandue depuis le début du XXe siècle. Elle est pratiquée dans
les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto et on l'utilise
traditionnellement durant les premiers jours de janvier, à l'occasion du Nouvel
An.
Petit moment amusant avec les bâtons de divination,
O-Mi-Kuji, "bâtons chanceux"
ou "honorable loterie des dieux". Cette méthode divinatoire d'origine chinoise
s'est répandue depuis le début du XXe siècle. Elle est pratiquée dans
les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto et on l'utilise
traditionnellement durant les premiers jours de janvier, à l'occasion du Nouvel
An.
Après avoir mis une offrande, il faut agiter la boîte contenant les bâtonnets
puis la retourner en espérant qu'il en sortira un bon. Le bâtonnet renvoi à un
numéro de casier où se trouve le textes de la prédiction. A ce stade, il faut
savoir lire le japonais pour savoir quelle fortune le sort vous réserve. Si la
prédiction est bonne, tout va bien. Si elle est néfaste, elle peut être contrée
par un voeu si l'on noue le papier sur un fil du support voisin destiné à cet
usage...
 Après la visite du temple,
nous passons devant le petit sanctuaire shintô Asakusa-jinja appelé
populairement Sanja Sama (les Trois sanctuaires) et situé sur la droite Hondo.
Il fut construit par ordre du troisième Shogun Tokugawa à la mémoire des trois
pêcheurs à l'origine du temple de Sensoji. C'est le point de départ de la grande
fête de Sanja Matsuri, qui se déroule à partir du troisième vendredi de mai et
pour trois jours et attire près de 2 millions de personnes dans les rues.
Après la visite du temple,
nous passons devant le petit sanctuaire shintô Asakusa-jinja appelé
populairement Sanja Sama (les Trois sanctuaires) et situé sur la droite Hondo.
Il fut construit par ordre du troisième Shogun Tokugawa à la mémoire des trois
pêcheurs à l'origine du temple de Sensoji. C'est le point de départ de la grande
fête de Sanja Matsuri, qui se déroule à partir du troisième vendredi de mai et
pour trois jours et attire près de 2 millions de personnes dans les rues.
Shige nous précise que c'est ici que sa soeur s'est mariée.


 Il est déjà midi.
Nous
partons à pied pour 20 petites minutes de marche, en passant par le pont sur la
Sumida et près du siège de la brasserie Asahi pour nous rendre dans un bon
restaurant Sugimoto, réputé pour ses sukiyaki, la
fondue japonaise (nabemono), péché mignon d'Armel. Pour consommer ce plat, il suffit
de cuire sur un réchaud de fines de tranches de boeuf et des légumes dans
un bouillon en ébullition. D'autres mois gourmets ou moins gourmands se
contenterons de udon, des nouilles rondes et larges, assez élastique, et
à base de farine de blé.
Il est déjà midi.
Nous
partons à pied pour 20 petites minutes de marche, en passant par le pont sur la
Sumida et près du siège de la brasserie Asahi pour nous rendre dans un bon
restaurant Sugimoto, réputé pour ses sukiyaki, la
fondue japonaise (nabemono), péché mignon d'Armel. Pour consommer ce plat, il suffit
de cuire sur un réchaud de fines de tranches de boeuf et des légumes dans
un bouillon en ébullition. D'autres mois gourmets ou moins gourmands se
contenterons de udon, des nouilles rondes et larges, assez élastique, et
à base de farine de blé.
Musée
Edo Hakubustukan 
 Après cela nous revenons
vers la rivière Sumida avec aperçu de la tour Skytree, bateaux sur la rivière.
Le stationnement doit être parfois problématique comme on peut l'imaginer en
voyant une boutique d'articles de literie occupée aux trois quarts par le
monospace du commerçant.
Après cela nous revenons
vers la rivière Sumida avec aperçu de la tour Skytree, bateaux sur la rivière.
Le stationnement doit être parfois problématique comme on peut l'imaginer en
voyant une boutique d'articles de literie occupée aux trois quarts par le
monospace du commerçant.
 A
quelques centaines de mètres et en quelques minutes, nous voici à 14H au
Musée Edo
Tokyo Hakubustukan (tarif 600 ¥), voisin du Ryōgoku Kokugikan, stade
où se situe l'arène (dohyo) des
combats de sumos.
C'est le musée de la ville de Tokyo, ville dont l'ancien nom est, rappelons-le,
Edo jusqu’en 1869. Dans un bâtiment original dû à l'architecte Kiyonori Kikutake,
on peut voir la réplique grandeur nature du Nihonbashi, le pont construit en
1603 qui servait traditionnellement de point de départ de toutes les routes du
Japon en sortant d'Edo, le théâtre kabuki Nakamuraza, le siège d'un journal, la
tour d'Asakusa Ryounkaku qui faisait 60 mètres de haut et était équipée d'un
ascenseur jusqu'à son effondrement lors du grand séisme de 1923, des maquettes
de la ville et de bâtiments des ères Edo, Meiji et Shōwa, la généalogie des
shogun Tokugawa, des chronologies des catastrophes (incendies, inondations,
tremblements de terre, famines et épidémies) ayant affecté Edo, des gravures
(pompiers en action), des maquettes de cortèges et chars de festivals (matsuri),
un livre illustré des bonnes manières pour jeunes filles... On y voit aussi des
costumes, armures de samouraïs, palanquins...
A
quelques centaines de mètres et en quelques minutes, nous voici à 14H au
Musée Edo
Tokyo Hakubustukan (tarif 600 ¥), voisin du Ryōgoku Kokugikan, stade
où se situe l'arène (dohyo) des
combats de sumos.
C'est le musée de la ville de Tokyo, ville dont l'ancien nom est, rappelons-le,
Edo jusqu’en 1869. Dans un bâtiment original dû à l'architecte Kiyonori Kikutake,
on peut voir la réplique grandeur nature du Nihonbashi, le pont construit en
1603 qui servait traditionnellement de point de départ de toutes les routes du
Japon en sortant d'Edo, le théâtre kabuki Nakamuraza, le siège d'un journal, la
tour d'Asakusa Ryounkaku qui faisait 60 mètres de haut et était équipée d'un
ascenseur jusqu'à son effondrement lors du grand séisme de 1923, des maquettes
de la ville et de bâtiments des ères Edo, Meiji et Shōwa, la généalogie des
shogun Tokugawa, des chronologies des catastrophes (incendies, inondations,
tremblements de terre, famines et épidémies) ayant affecté Edo, des gravures
(pompiers en action), des maquettes de cortèges et chars de festivals (matsuri),
un livre illustré des bonnes manières pour jeunes filles... On y voit aussi des
costumes, armures de samouraïs, palanquins...
On apprend qu'alors que les seigneurs (daimyos) devaient entretenir à Edo une
résidence, y demeurer une année sur deux (ou six mois par an) et y laisser en
otage leur famille et des vassaux, les guerriers et vassaux en poste à Edo
devaient quant à eux y résider seuls, laissant leur famille en province.
Des reconstitutions d'habitats sont présentées, des plus simples maisons
d'autrefois à l'arrivée de la modernité avec l'intrusion dans l'habitat de la
télé, du réfrigérateur, et de la machine à laver, "les trois nouveaux trésors
sacrés" des Japonais. A cela s'ajoute l'automobile, Ford A modèle 1929, et
la petite japonaise Subaru 360 née en 1958.
 15H45, nous avons consacré une
heure trois quarts au musée sans voir le temps passer et sans s'attarder.
Si nous voulons arriver à Nagoya à une heure raisonnable, il ne faut pas trop
traîner. Il faut déjà repasser à l'hôtel récupérer nos bagages puis, pour gagner
du temps, on prend un taxi pour aller à la gare centrale et récupérer les
valises des "jeunes" dans leur consigne.
Et il nous faut encore valider nos
Japan Railpass
(valable 7 jours sur la plupart des services JR).
15H45, nous avons consacré une
heure trois quarts au musée sans voir le temps passer et sans s'attarder.
Si nous voulons arriver à Nagoya à une heure raisonnable, il ne faut pas trop
traîner. Il faut déjà repasser à l'hôtel récupérer nos bagages puis, pour gagner
du temps, on prend un taxi pour aller à la gare centrale et récupérer les
valises des "jeunes" dans leur consigne.
Et il nous faut encore valider nos
Japan Railpass
(valable 7 jours sur la plupart des services JR).

Nagoya est la troisième
ville du Japon par sa superficie et la quatrième par la population (2,3 millions
d'habitants), derrière Tokyo, Yokohama et Osaka. Quant à l'agglomération
qui compte environ 9 millions d'habitants, c'est la troisième du pays.
Nous voici à Nagoya vers
19H15 après une heure quarante en Shinkansen. Avec plus de 400 000 m²
de superficie, incluant les bureaux de la compagnie JR Central et les "twin
towers", deux tours cylindriques d’une cinquantaine d’étages, la gare de Nagoya
est la plus vaste station ferroviaire au monde. Elle voit passer plus d'un
million de passagers par jour.
Près de la gare, sur l'artère principale à Nagoya, la tour spiralée de
l'Ecole de mode et de design Mode Gakuen de l'architecte Nikken Sekkei
est un gratte-ciel de bureaux de 170 mètres de hauteur et d'une surface de
plancher de 49 000 m²
mis en service en 2008.
 La ville a vu naître
trois
personnages importants dans l'histoire du Japon shogunal:
La ville a vu naître
trois
personnages importants dans l'histoire du Japon shogunal:
- Minamoto no Yoritomo, fondateur et premier shogun du shogunat de Kamakura
au Japon (règne de 1192 à 1199).
- Oda Nobunaga, seigneur de guerre qui a conquis une grande partie du Japon
avant de se donner la mort en 1582, suite à une trahison. C'est le premier des
"Trois héros" de l'unification.
- Toyotomi Hideyoshi, neveu d'Oda par alliance et adjoint, sera le second héros.
Il vengea Oda et poursuivit l'unification en s'emparant notamment des îles
Shikoku et Kyushu et du nord de Honshu. Il échoua par contre à deux reprises
dans sa conquête de la Corée. Il est connu aussi en Occident du fait qu'il persécuta les chrétiens (notamment de
Nagasaki). Après sa mort, profitant de rivalités entre les vassaux du clan Toyotomi, Tokugawa Ieyasu, l'un des
régents remportera la victoire et se fera
nommer shogun en 1603, parachevant l'unification.
 Le
samouraï ou bushi est un membre de la classe guerrière qui a
dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans. Auparavant, on désignait les
guerriers plutôt par les termes mono no fu (jusqu'au VIIIe siècle)
que l'on peut traduire "homme d'armes". À l'origine, bushi
désigne les guerriers japonais soumis au bushidō (code de l'honneur
du bushi). Le terme apparaît pour la première fois dans le
livre d'histoire japonaise, Shoku Nihongi écrit sous l'ère Heian vers l'an 800.
Il provient du chinois wushi.
Le
samouraï ou bushi est un membre de la classe guerrière qui a
dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans. Auparavant, on désignait les
guerriers plutôt par les termes mono no fu (jusqu'au VIIIe siècle)
que l'on peut traduire "homme d'armes". À l'origine, bushi
désigne les guerriers japonais soumis au bushidō (code de l'honneur
du bushi). Le terme apparaît pour la première fois dans le
livre d'histoire japonaise, Shoku Nihongi écrit sous l'ère Heian vers l'an 800.
Il provient du chinois wushi.
Le terme samouraï, mentionné pour la première fois dans un texte
du Xe siècle, vient du verbe saburau qui signifie "servir". L'appellation
est largement utilisée dans son sens actuel depuis le début de la période Edo,
vers 1600. À partir de la période Edo, les termes bushi et samouraï ne sont pas
tout à fait synonymes, il existe une différence subtile et ils sont souvent
confondus mais ils correspondent à des périodes et des fonctions différentes.
Concernant la noblesse, on trouve aussi parfois le terme buke qui
désigne la noblesse militaire attachée au bakufu (gouvernement militaire), par
opposition aux kuge, la noblesse de cour attachée à l'empereur. Les buke sont
apparus durant l'ère Kamakura (1185–1333).
 Vers 20H15, dîner au
restaurant Rakuzo avec edamame (fèves de soja), omelette (tamagoyaki)
sucrée-salée et roulée, sashimi de saumon et de thon, filet de poulet et
korokke (boulettes ou croquettes de purée de pommes de terre). Et u une heure plus tard, arrivée à l'hôtel Sanco Inn 3*
(à un kilomètre de la gare), chambres petites et sentant la vieille fumée de
cigarette. Manifestement, c'est une adresse connue des employés de bureaux et
hommes d'affaires en déplacement.
Vers 20H15, dîner au
restaurant Rakuzo avec edamame (fèves de soja), omelette (tamagoyaki)
sucrée-salée et roulée, sashimi de saumon et de thon, filet de poulet et
korokke (boulettes ou croquettes de purée de pommes de terre). Et u une heure plus tard, arrivée à l'hôtel Sanco Inn 3*
(à un kilomètre de la gare), chambres petites et sentant la vieille fumée de
cigarette. Manifestement, c'est une adresse connue des employés de bureaux et
hommes d'affaires en déplacement.
Dans notre chambre, moment plus intime où l'on remet à nos hôtes de tout petits cadeaux ramenés de notre
Bretagne. Il est déjà 21H30 donc pas question de les retenir davantage alors
qu'ils ont pratiquement passer une nuit blanche la veille.
Vendredi 2 octobre
Rencontre avec une famille
japoanise


Aujourd'hui est un jour
important.
Nous allons faire la connaissance de la belle-famille de notre fille
Armel puisqu'elle s'est mariée dans la plus stricte intimité il y a un an et
demi, nous n'avions pas
encore eu l'occasion de les rencontrer.
Départ de l'hôtel à 9H.
Quelle chance, aujourd'hui grand soleil. Parmi les allées et venue des
gens dans cette gare, on a l'occasion de voir deux hommes d'affaires se saluer
au moment de leur rencontre ou au moment de se séparer,
manifestement de deux rangs hiérarchiques différents en fonction de leur
inclinaison. Prenons-en de la graine car nous aussi, nous devrons l'étiquette tout à l'heure...
 Le salut (o-jigi)
est probablement l'attribut de l'étiquette japonaise qui est le plus connu.
Il s'effectue le buste incliné vers l'avant à partir de la taille, le dos droit
et les mains sur les côtés (pour les hommes) ou plaquées sur les genoux (pour
les femmes), tête en avant et regard baissé. Plus il est long et bas, plus
l'émotion et le respect exprimés sont grands, avec une graduation en fonction de
l'angle d'inclinaison: 15°, 30° voire 45° ou plus...
Le salut (o-jigi)
est probablement l'attribut de l'étiquette japonaise qui est le plus connu.
Il s'effectue le buste incliné vers l'avant à partir de la taille, le dos droit
et les mains sur les côtés (pour les hommes) ou plaquées sur les genoux (pour
les femmes), tête en avant et regard baissé. Plus il est long et bas, plus
l'émotion et le respect exprimés sont grands, avec une graduation en fonction de
l'angle d'inclinaison: 15°, 30° voire 45° ou plus...
 Un petit bout en métro
suivi d'une marche de quarante minutes, sans nos valises il est vrai mais avec quelques paquets.
Dans le quartier de Tsuruma ou Tsurumai (" Danse de la grue"),
nous traversons un petit et joli parc puis c'est encore de la marche dans
le quartier Gokiso. Nous passons devant le petit sanctuaire shinto Biyo, tout
près du domicile des parents de Shige. Il est 11H10.
Un petit bout en métro
suivi d'une marche de quarante minutes, sans nos valises il est vrai mais avec quelques paquets.
Dans le quartier de Tsuruma ou Tsurumai (" Danse de la grue"),
nous traversons un petit et joli parc puis c'est encore de la marche dans
le quartier Gokiso. Nous passons devant le petit sanctuaire shinto Biyo, tout
près du domicile des parents de Shige. Il est 11H10.
Justement, son père nous
attend au bas de leur petit immeuble pour nous conduire vers leur appartement en
attique.
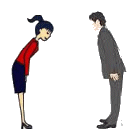


Nous considérons comme
un privilège d'être invités à déjeuner dans la
famille, ce qui n'est pas coutume au Japon, même lorsque la taille du
logement le permet, comme c'est le cas ici. Dans l'esprit des Japonais, le
domicile est un rare espace de liberté et d'intimité auquel seuls les très
proches ont accès alors que les amis sont reçus à l'extérieur.
Arrivés à l'appartement, après avoir échangé nos chaussures contre des
pantoufles comme il se doit, nous rencontrons
la mère et la grand-mère.
Les modes de salutation s'entremêlent un peu, poignées
de mains et courbettes. Le dialogue va être difficile car la famille parle très
peu anglais, encore moins que nous, ce n'est as peu dire. Notre fille parle
assez couramment japonais et anglais, tout comme son mari lequel assurera quand
même parfois un relais du japonais à l'anglais lorsque les discussions iront sur
des sujets difficiles ou complexes.
Puis c'est l
a remise des cadeaux, reçus avec les
deux mains, ce qui est une marque de politesse. Après cela, petit conciliabule
car traditionnellement le cadeau ne sera pas ouvert sauf si le donateur invite
le destinataire. Nous invitons donc nos hôtes à de procéder à l'occidentale,
c'est-à-dire de les ouvrir devant les invités. Ainsi nous saurons si notre
service à thé en faïence est bien arrivé entier, si les bouteilles de vins ne se
sont pas
brisées. On délivre nos conseils à propos de ce breuvage: laisser reposer
plusieurs semaines, température de service... On n'ira pas jusqu'à voir en
quel état sont les biscuits dans leurs boîtes métalliques...

 Pour ce déjeuner, nous ne souffrirons pas car
la salle à manger où nous sommes reçus dispose d'une table et de chaises
occidentales. Sur un chemin de table brodé au fil rose de motifs folkloriques
européens, deux grand plateaux de sushis d'une
dizaine de variétés nous attendent comprenant 44 pièces chacun (nous sommes 8
convives). Il s'agit plus précisément de nigirizushi
(littéralement "sushi tenu") constitués d'une boule de riz vinaigré (shari)
sur laquelle est posée un neta une tranche de poisson cru (de
diverses espèces), mais aussi une crevette, des oeufs de poissons... Ils
pourraient aussi être garnis de tranche de poisson cuit, d'oursin, de crabe,
d'omelette, de légumes. Souvent en Occident, on connaît davantage l'autre
variété de sushi, le makizushi obtenu en prenant une feuille
d'algue séchée (nori) sur laquelle est étalée une couche de riz et
un morceau de poisson et en enroulant le tout.
Pour ce déjeuner, nous ne souffrirons pas car
la salle à manger où nous sommes reçus dispose d'une table et de chaises
occidentales. Sur un chemin de table brodé au fil rose de motifs folkloriques
européens, deux grand plateaux de sushis d'une
dizaine de variétés nous attendent comprenant 44 pièces chacun (nous sommes 8
convives). Il s'agit plus précisément de nigirizushi
(littéralement "sushi tenu") constitués d'une boule de riz vinaigré (shari)
sur laquelle est posée un neta une tranche de poisson cru (de
diverses espèces), mais aussi une crevette, des oeufs de poissons... Ils
pourraient aussi être garnis de tranche de poisson cuit, d'oursin, de crabe,
d'omelette, de légumes. Souvent en Occident, on connaît davantage l'autre
variété de sushi, le makizushi obtenu en prenant une feuille
d'algue séchée (nori) sur laquelle est étalée une couche de riz et
un morceau de poisson et en enroulant le tout.
Ces plateaux sont fournis par traiteur Gin no sara ("Plat
d'argent") en formule livré à domicile (demae zushi). Après un peu de
saké, le repas est accompagné de bière pour ceux qui dédaignent l'eau. Un repas
délicieux dont nous ne parviendrons pas tout à fait à bout tant il était
copieux.
Arrive la fin du repas et c'est le moment pour nous de recevoir des jolis
paquets de friandises japonaises superbement emballés comme seuls les Japonais
savent si bien le faire. A ce moment là nous ignorions que peu après notre
retour, nous recevrions d'autres présents...
Le père de Shige qui est aussi un artiste à
ses heures, nous remet une douzaine de copies de ses reproductions au fusain
de portraits d'acteurs de films célèbres (Clint Eastwood dans "L'inspecteur Harry", Peter
O'Tool et Omar Sharif dans "Lawrence d'Arabie"...). Les parents de
Shige sont des retraités de l'enseignement qui ont autrefois exercé à l'étranger
et qui ont beaucoup voyagé en autonomie, avec voitures de location, comme le
montre la carte manuscrite des itinéraires déjà empruntés en Europe. En retraite, ils ont des activités bénévoles et
aiment encore voyager, aussi avons-nous espoir de les voir en Bretagne dans
un proche avenir. Ils sont aussi collectionneurs et amateurs d'art.
Ainsi on peut voir une belle sculpture en bois représentant un
tanuki ou chien
viverin (Nyctereutes
procyonoides), une sous espèce de canidés, animal de la mythologie
japonaise, l'un des yōkai (esprits) de la forêt, symbole de chance et de
prospérité auquel les Japonais attribuent des pouvoirs magiques.
Avant de partir se balader,
depuis l'attique, coup d'oeil depuis la vaste terrasse de l'appartement d'où l'on jouit d'une vue exceptionnelle sur le centre de Nagoya.
A l'initiative du père de
Shige, nous en venons sur un terrain inattendu avec un échange sur nos
sentiments réciproques concernant la relation qui s'est établie entre nos
enfants et les a conduits à se marier, évènement qui a semblé ravir cette
famille japonaise. Malgré les barrages linguistiques contournés par nos
"traducteurs-interprètes", il s'est produit là une émouvante incursion dans le
domaine de l'inter culturalité, des sentiments et de l'intime. Aussi
bien Français que Japonais, nous
avons tous été profondément remués...

 A 14H30, en taxis, nous nous rendons tous, y
compris la grand-mère, au château de Nagoya (tarif 500 ¥) qui se trouve dans
le quartier Honmaru, en plein centre.
A 14H30, en taxis, nous nous rendons tous, y
compris la grand-mère, au château de Nagoya (tarif 500 ¥) qui se trouve dans
le quartier Honmaru, en plein centre.
Visite du château de
Nagoya 

 Un premier château avait été construit en 1525
(en 1532, le clan Oda s’en empara mais l’abandonna par la suite), remplacé en 1612 à l'initiative
du shogun Tokugawa Ieyasu pour devenir le siège de la branche Owari du puissant
clan Tokugawa. Durant l’époque Edo, sous le règne d’une branche cadette de la
famille shogunale des Tokugawa, la ville de Nagoya devint un des principaux
centres économiques du pays grâce à sa position à l’intersection des routes
Tokaido et Nakasendo qui reliaient Edo (l’ancien nom de Tokyo) à Kyoto.
Un premier château avait été construit en 1525
(en 1532, le clan Oda s’en empara mais l’abandonna par la suite), remplacé en 1612 à l'initiative
du shogun Tokugawa Ieyasu pour devenir le siège de la branche Owari du puissant
clan Tokugawa. Durant l’époque Edo, sous le règne d’une branche cadette de la
famille shogunale des Tokugawa, la ville de Nagoya devint un des principaux
centres économiques du pays grâce à sa position à l’intersection des routes
Tokaido et Nakasendo qui reliaient Edo (l’ancien nom de Tokyo) à Kyoto.
La profondeur des douves entourant le donjon Honmaru et les
fortes portes attestent de l’étendue du pouvoir de la famille Tokugawa.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château était utilisé
comme quartier général de l'armée et comme camp de prisonniers de guerre. Au
cours des bombardements américains en mai 1945, le château a été incendié et la
plupart des décorations du château ont été détruites. La reconstruction du
donjon en béton (avec climatisation et ascenseur) a été terminée en 1959.
Au sommet du donjon, haut de 48 mètres, se trouvent des dauphins à tête de tigre en or, appelés
kinshachi ou shachihoko utilisés comme talismans pour la prévention des
incendies, une pratique issue de la mythologie chinoise ( Chiwen, l'un des neuf
fils du dragon). Ils symbolisent l'autorité du seigneur féodal.
 Depuis 2009, un projet de grande envergure a vu le jour, en utilisant les plans
d'archives, la ville reconstruit le Palais Honmaru jouxtant le château, au
sud du donjon, avec les
techniques et les matériaux d'autrefois. Avec le Palais Ninomaru du Palais de
Nijo à Kyoto, le Palais Hommaru a été considéré comme le meilleur chef-d'œuvre
de l'architecture du château de l'architecture Shoin de palais de style
samouraï au Japon. Les murs et cloisons à panneaux coulissants de l'ancien
palais avaient été peints par des maîtres tels que Kano Sadanobu et Kano Tanyu
de l'école Kano, la plus grande école de peinture dans l'histoire de la peinture
de style japonais. Depuis 1992, des artistes s'emploient à restaurer et à
reproduire ces magnifiques décors de bambous, tigres et léopards sur fond doré.
Depuis 2009, un projet de grande envergure a vu le jour, en utilisant les plans
d'archives, la ville reconstruit le Palais Honmaru jouxtant le château, au
sud du donjon, avec les
techniques et les matériaux d'autrefois. Avec le Palais Ninomaru du Palais de
Nijo à Kyoto, le Palais Hommaru a été considéré comme le meilleur chef-d'œuvre
de l'architecture du château de l'architecture Shoin de palais de style
samouraï au Japon. Les murs et cloisons à panneaux coulissants de l'ancien
palais avaient été peints par des maîtres tels que Kano Sadanobu et Kano Tanyu
de l'école Kano, la plus grande école de peinture dans l'histoire de la peinture
de style japonais. Depuis 1992, des artistes s'emploient à restaurer et à
reproduire ces magnifiques décors de bambous, tigres et léopards sur fond doré.
Si la fin de cette restauration est
prévue pour 2018, une partie du palais est d'ors et déjà accessible aux
visiteurs. On peut admirer les magnifiques peintures sur les fusuma
(portes
coulissantes) des différents halls (Nakanokuchibeya, Genkan) et du grand
corridor (Oroka) du palais.
Nous poursuivons la visite par celle du donjon reconverti en musée. Il renferme
de précieuses pièces (tableaux, sabres, fusils) autour de l’histoire du clan
Tokugawa et du Nagoya-jô. Du septième et dernier étage, on a une vue
saisissante sur la ville.
Au pied du donjon, on peut
admirer le travail de maçonnerie cyclopéenne, certains blocs portent la marque
distinctive de tel ou tel ou ouvrier. Dans le petit parc attenant, on peut voir
des pierres, vestiges des tours détruites en 1945 et un énorme et étrange abri
monolithique au sujet duquel je n'ai pas trouvé d'explication (s'agirait-il de
la chambre funéraire d'un ancien tumulus aujourd'hui disparu?).
Nous quittons le château à
l'heure de la fermeture, 17H, au son de la mélodie du standard "Ce n'est
qu'un au revoir" (Auld Lang Syne de son titre original en gaélique
écossais). Dans d'autres sites et sur d'autres airs, les Japonais ont ainsi
coutume de prendre congé de leurs visiteurs.

Dîner gastronomique 




 Un saut en taxi jusqu'au
restaurant gastronomique Kisoji Nishiki, une chaîne présente dans sept villes du pays,
où Shige nous offre un dîner impérial. De charmantes hôtesses en kimono
nous accueillent et nous conduisent à l'étage où une salle nous est réservée.
Des tables basses nous attendent mais heureusement pour nous ce sont des tables
normales car il nous aurait été difficile de tenir pendant plus de deux
heures assis à des tables basses...
Un saut en taxi jusqu'au
restaurant gastronomique Kisoji Nishiki, une chaîne présente dans sept villes du pays,
où Shige nous offre un dîner impérial. De charmantes hôtesses en kimono
nous accueillent et nous conduisent à l'étage où une salle nous est réservée.
Des tables basses nous attendent mais heureusement pour nous ce sont des tables
normales car il nous aurait été difficile de tenir pendant plus de deux
heures assis à des tables basses...
Deux heures de banquet jusqu'à 19H30, avec un défilé de plats plus délicieux les
uns que les autres, amuse-gueule de légumes marinés et vinaigrés, entrée de petits roulés fourrés, sashimis
de thon, de seiche, de buri (poisson Seriola lalandi) avec feuille
d'algue, fondue shabu-shabu
au boeuf très persillé et légumes variés (champignons enoki (longs et
blancs du genre collybie), eringi du genre pleurote, fameux shiitake joliment ciselés),
potiron, chou, yuba (rouleaux de peau de tofu),
tiges de poireau genre oignon, légumes-feuilles servis avec deux sauces l'une
dense de couleur jaune était au sésame, l'autre était du ponzu ,à base de
shoyu (autrement dit de sauce de soja) et d'agrumes. Sans oublier les kishimen (nouilles
udon plates, en forme de tagliatelles), le tofu et le riz, évidemment.
Les différents ingrédients sont plongés dans le bouillon de boeuf et de légumes
porté à ébullition dans une marmite (nabe) posée sur un réchaud puis,
avant d'être dégustés, ils sont trempés dans une sauce, l'une ponzu, à
base de sauce soja et de yuzu (sorte de citron) et l'autre gomadare
à base de sauce soja et de sésame, sans oublier le wasabi. Lorsque le plat
de viande et les légumes sont terminés, dans le reste de bouillon, on fait cuire
les udons. Boule de glace au thé macha pour terminer le repas.
 Shabu
shabu et sukiyaki" sont toutes les deux sont des fondues où l'on
plonge des morceaux de boeuf et des légumes. La plus grosse différence c'est que
le bouillon du sukiyaki est à base de sauce de soja sucré (très
reconnaissable au goût) et souvent on trempe ensuite les morceaux dans de
l'oeuf cru.
Shabu
shabu et sukiyaki" sont toutes les deux sont des fondues où l'on
plonge des morceaux de boeuf et des légumes. La plus grosse différence c'est que
le bouillon du sukiyaki est à base de sauce de soja sucré (très
reconnaissable au goût) et souvent on trempe ensuite les morceaux dans de
l'oeuf cru.
Le shabu-shabu serait une variante de
la fondue sukiyaki, un plat traditionnel japonais pendant l'ère Meiji et
proposé en 1862 dans restaurant de Yokohama. Le shabu-shabu serait
d'origine mongole. Cette recette de fondue pékinoise de l’époque de la dynastie
Yuan s'appelait shuan yangrou ("viande de mouton trempée dans l'eau
bouillante"), utilisant des tranches fines de mouton. En 1952, un restaurant
d’Osaka, le Suehiro, importa ce plat en l'adaptant au goût japonais. Le mouton
n’étant pas très courant au Japon, il a donc été remplacé par le bœuf. Le nom de
cette fondue proviendrait de l’onomatopée japonaise correspondant au bruit de la
viande plongée dans le bouillon chaud... et l'humour français ose un assez nul "Ça boue! Ça boue!"
La famille nous quitte un peu après 19H30 et regagne son domicile en taxi.

 De
notre côté, pour faire la digestion, petite balade dans le quartier
animé de Sakae, avec ses enseignes lumineuses, lolitas, restaurants,
karaokés et surtout son immanquable centre commercial Oasis 21, oeuvre de
Hideki Casai d'Obayashi Corporation, un immense toit en verre flottant
dans l'air, en forme de vaisseau spatial aquatique ("Spaceship Aqua") qui ne
passe pas inaperçu. Cet équipement a été ouvert au public en 2002.
De
notre côté, pour faire la digestion, petite balade dans le quartier
animé de Sakae, avec ses enseignes lumineuses, lolitas, restaurants,
karaokés et surtout son immanquable centre commercial Oasis 21, oeuvre de
Hideki Casai d'Obayashi Corporation, un immense toit en verre flottant
dans l'air, en forme de vaisseau spatial aquatique ("Spaceship Aqua") qui ne
passe pas inaperçu. Cet équipement a été ouvert au public en 2002.
 Sur plusieurs étages, il héberge également la gare routière d'où partent la
plupart des bus de la ville, des salles accueillant des expositions et des
concerts, des commerces et restaurants, une patinoire sans glace, un marché bio
le samedi. Nous accédons à la terrasse à 14 mètres du sol. Son plancher de verre
supporte au centre un bassin à débordement d'un mince voile de l'eau coulant sur
la surface du verre en formant d'innombrables ondulations de lumière réfractée
depuis les espaces publics situés en dessous tandis que les édifices des
alentours s'y reflètent, notamment la grande roue ou la tour TV.
Sur plusieurs étages, il héberge également la gare routière d'où partent la
plupart des bus de la ville, des salles accueillant des expositions et des
concerts, des commerces et restaurants, une patinoire sans glace, un marché bio
le samedi. Nous accédons à la terrasse à 14 mètres du sol. Son plancher de verre
supporte au centre un bassin à débordement d'un mince voile de l'eau coulant sur
la surface du verre en formant d'innombrables ondulations de lumière réfractée
depuis les espaces publics situés en dessous tandis que les édifices des
alentours s'y reflètent, notamment la grande roue ou la tour TV.
La Nagoya TV Tower est une tour de 180 mètres de haut dont la forme
rappelle vaguement celles de la Tour de Tokyo ou notre Tour Eiffel. Elle date de
1954 et elle est d'ailleurs la première du genre édifiée au Japon. On peut
accéder à deux plates-formes d'observation installées à 90 et 100 mètres de
hauteur.
Dans le centre commercial, on peut s'amuser des noms d'enseignes utilisant plus
ou moins heureusement notre langue: "Vie de France", "Fontaine couture", "Boncoin",
"Quatre chaussures", "Epi-Ciel, soyez un gourmet dans votre vie"...
 21H, une heure raisonnable
pour regagner l'hôtel Sanco Inn.
21H, une heure raisonnable
pour regagner l'hôtel Sanco Inn.