|
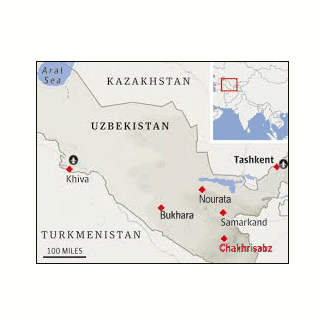
| ||||
| |||||
Vendredi 12 septembre
Petit rappel: ce retour en arrière dans le calendrier s'explique par le fait que l'excursion à Chakhrisabz s'intercale entre les deux jours consacrés à la visite de Samarcande (le 11 et le 13).
![]() Départ pas trop matinal à 9H
et température encore agréable (14°). Destination Chakhrisabz, ville natale (à
préciser) de
Tamerlan.
Départ pas trop matinal à 9H
et température encore agréable (14°). Destination Chakhrisabz, ville natale (à
préciser) de
Tamerlan.
Aller-retour dans la journée... soit environ 650 km en raison d'un
immense détour alors que par la
route directe passant par la montagne ,l'aller-retour est quatre fois moins long
(160 km) mais cette route est interdite aux autocars en raison de sa dangerosité.
1 - Trajet de Samarcande
à Chakhrisabz
(320 km)
Chakhrisabz est toute proche maintenant.
2 - CHAKHRISABZ: Ak Saraï, "le Palais Blanc" (1380-1404)
Chakhrisabz ("la
ville verte") est souvent
citée comme étant la ville natale de Tamerlan mais en réalité il est né en
1336 dans une simple
maison de berger dans un hameau situé à 14 km de Chakhrisabz comme nous le
précise Lora.
A l'époque où Tamerlan est
né, la ville s'appelait Kesh ou Kash mais elle existait bien avant,
puisque fondée vers 2700 ans avant J-C. Par la suite, elle fit partie de
l'empire perse achéménide (VIe au IVe siècle avant J-C) jusqu'à sa conquête par
Alexandre le Grand qui y rencontra Roxane, son épouse. En 710, la ville a été
conquise par les Arabes.
Chakhrisabz, est le nom que Tamerlan donna à l'ancienne Kash. Pendant le règne de la dynastie timouride
,elle fut
progressivement supplantée par Samarcande. C'est aujourd'hui une ville
modeste de 60 000 habitants, située à 650 mètres d'altitude.
Sur notre gauche, en périphérie de la ville, nous passons près de grands silos à céréales d'une meunerie qui témoignent de la riche activité agricole de la région. A peine 5 minutes plus tard, toujours sur la gauche, nous pensons à nouveau voir de grands silos... En réalité, ce sont les imposants vestiges du Palais Ak-Saraï ("le Palais Blanc") que nous allons justement visiter dans quelques instants.
Il est midi et c'est sous 30° à l'ombre
(mais il se trouve qu'il n'y en a pas
beaucoup par ici) que nous allons faire cette visite... A 300 mètres au sud du
palais, se dresse la grande statue moderne de Tamerlan, debout.
La visite ne s'effectue pas
dans des conditions idéales car tout l'environnement du site est en chantier en
vue de l'aménagement d'un parc qui devrait être achevé en fin d'année. On
est loin de cette issue...
Dans ce climat
aride, qui dit chantier dit poussière. Il faut donc approcher le palais plus
poussiéreux que blanc car sur quelques centaines
de mètres nous marchons dans une couche de poussière de plusieurs centimètres d'épaisseur.
Certes, ne nous plaignons pas car ce ne serait pas mieux s'il s'agissait de boue...
Ak Saraî ou Aq Saray, ("le palais blanc") est un imposant palais réalisé
selon la volonté de Tamerlan par des
artisans esclaves du Khorezm et d'Azerbaïdjan au
début de la période timouride, entre 1380 et 1404. On y voit une inscription disant «Que celui qui doute de notre
puissance regarde nos œuvres». A Samarcande, la construction de la mosquée Bibi-Khanoum
réalisée (1399-1404) lorsque ce palais était en voie d'achèvement s'est
inspirée de ce palais par le gigantisme.
![]() Les ruines sont les restes d'un immense portail, initialement haut de 71 mètres,
flanqué de deux tours cylindriques reposant sur des bases octogonales et
mesurant 44 mètres. La voûte effondrée, large de 22 mètres, était la plus grande
d'Asie centrale. Derrière le portail se trouvait une cour
revêtue de dalles blanches, d'environ 100 mètres de côté, ceinturée d'arcades
richement décorées et avec un bassin. Le portail était recouvert de carreaux de céramiques
dans les bleu, vert et or, dont une partie subsiste. Certaines portent les noms
d'Allah et de Mahomet en écriture coufique.
Les ruines sont les restes d'un immense portail, initialement haut de 71 mètres,
flanqué de deux tours cylindriques reposant sur des bases octogonales et
mesurant 44 mètres. La voûte effondrée, large de 22 mètres, était la plus grande
d'Asie centrale. Derrière le portail se trouvait une cour
revêtue de dalles blanches, d'environ 100 mètres de côté, ceinturée d'arcades
richement décorées et avec un bassin. Le portail était recouvert de carreaux de céramiques
dans les bleu, vert et or, dont une partie subsiste. Certaines portent les noms
d'Allah et de Mahomet en écriture coufique.
Ce portail marquait-il l'entrée du
palais ou bien s'agissait-il de l'iwan où Tamerlan tenait ses audiences ?
Le rêve de Tamerlan n'était que vanité puisque son palais fut détruit moins de
deux siècles plus tard, à la fin du XVIe, par l'émir de Boukhara Abdullah Khan II,
khan de la dynastie turco-mongole des Chaybanides d'Ouzbékistan de 1583 à 1598,
conquérant de Boukhara, dont il fit sa capitale.
Après la visite, on arrive par l'arrière du portail, où l'on recherche la
courte ombre zénithale au pied des tours, puis nous passons dans le petit musée
tout
proche où l'on peut admirer des vestiges de superbes mosaïques qui recouvraient
le sol.
| ||||
![]() Malgré le bain de poussière auquel nous sommes astreints, nous allons jusqu'à
la
statue de Tamerlan qui tourne le dos au Palais et regarde vers le sud l'étendue
de ses conquêtes (actuels Tadjikistan, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak , nord de l'inde... et j'en passe).
Malgré le bain de poussière auquel nous sommes astreints, nous allons jusqu'à
la
statue de Tamerlan qui tourne le dos au Palais et regarde vers le sud l'étendue
de ses conquêtes (actuels Tadjikistan, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak , nord de l'inde... et j'en passe).
![]() 12H45, il est temps de
songer à déjeuner. Quelques minutes de minibus et nous voici au restaurant
Kish Mish.
12H45, il est temps de
songer à déjeuner. Quelques minutes de minibus et nous voici au restaurant
Kish Mish.
| ||||
3 - CHAKHRISABZ: mausolées du complexe Dorous Siadat (1375-91), mosquée Kok Gumbaz (1434-36) et mausolées du complexe Dourout Tivolat (1373-1438)
![]() Restaurés, à 14H10 nous
reprenons le véhicule pour un très court trajet vers le sud de la ville.
Restaurés, à 14H10 nous
reprenons le véhicule pour un très court trajet vers le sud de la ville.
![]() Nous
passons près de la mosquée Kok Gumbaz ("Dôme bleu") que nous visiterons
tout à l'heure et poursuivons notre marche de quelques minutes en nous dirigeant
vers l'est, vers le complexe Dorous Siadat ("le siège de la souveraineté").
C'est un ensemble aujourd'hui partiellement détruit. Le bâtiment principal était
de grandes dimensions (70x90 mètres) et son portail était flanqué de deux
mausolées. Subsiste celui de gauche qui abrite le mausolée de Jahangir, fils aîné et fils préféré
de Tamerlan, mort accidentellement en 1375. Celui de droite, qui a été détruit,
aurait abrité le tombeau d'Omar Cheikh, le deuxième fils de Tamerlan, mort en
1391 (ou 1394).
Nous
passons près de la mosquée Kok Gumbaz ("Dôme bleu") que nous visiterons
tout à l'heure et poursuivons notre marche de quelques minutes en nous dirigeant
vers l'est, vers le complexe Dorous Siadat ("le siège de la souveraineté").
C'est un ensemble aujourd'hui partiellement détruit. Le bâtiment principal était
de grandes dimensions (70x90 mètres) et son portail était flanqué de deux
mausolées. Subsiste celui de gauche qui abrite le mausolée de Jahangir, fils aîné et fils préféré
de Tamerlan, mort accidentellement en 1375. Celui de droite, qui a été détruit,
aurait abrité le tombeau d'Omar Cheikh, le deuxième fils de Tamerlan, mort en
1391 (ou 1394).
![]() Au même moment, Tamerlan se fit construire près de là une crypte qui n'a été
découverte par des archéologues soviétiques qu'en 1943. La salle dépouillée du
caveau (soundouk) abrite un sarcophage de marbre où apparaît le nom
de Tamerlan (Timur en langue turque). La pierre tombale en marbre de 11 cm
d'épaisseur qui le recouvre comporte cinq anneaux fixés aux angles et au milieu.
En fait, Tamerlan n'a jamais occupé ce sarcophage puisque son mausolée est au
Gour Emir que l'on a visité, à Samarcande...
Au même moment, Tamerlan se fit construire près de là une crypte qui n'a été
découverte par des archéologues soviétiques qu'en 1943. La salle dépouillée du
caveau (soundouk) abrite un sarcophage de marbre où apparaît le nom
de Tamerlan (Timur en langue turque). La pierre tombale en marbre de 11 cm
d'épaisseur qui le recouvre comporte cinq anneaux fixés aux angles et au milieu.
En fait, Tamerlan n'a jamais occupé ce sarcophage puisque son mausolée est au
Gour Emir que l'on a visité, à Samarcande...
On poursuit en jetant un coup d'œil à la mosquée Hazrat-i Imam, adjacente au
mausolée de Jahangir, et communicante avec la mosquée Jahangir.
 Retour vers la mosquée Kok Gumbaz construite en 1434-1436 par Ouloug Beg, petit-fils de
Tamerlan, pour rendre hommage à son père, Shah Rukh. Elle était destinée à
servir de mosquée principale (ou mosquée du vendredi), à proximité de la
madrassa Dorout Tilovat. Le bâtiment principal est constitué d'une salle carrée
d'environ 12 mètres de côté, qui soutient le dôme immense, recouvert de carreaux
de céramique bleue. En 1994, à l'occasion du 600e anniversaire d'Ouloug
Beg, le monument a été rafraîchi mai on peut remarquer que des travaux sontrncore en
cours actuellement à l'extérieur, au niveau du dôme.
Retour vers la mosquée Kok Gumbaz construite en 1434-1436 par Ouloug Beg, petit-fils de
Tamerlan, pour rendre hommage à son père, Shah Rukh. Elle était destinée à
servir de mosquée principale (ou mosquée du vendredi), à proximité de la
madrassa Dorout Tilovat. Le bâtiment principal est constitué d'une salle carrée
d'environ 12 mètres de côté, qui soutient le dôme immense, recouvert de carreaux
de céramique bleue. En 1994, à l'occasion du 600e anniversaire d'Ouloug
Beg, le monument a été rafraîchi mai on peut remarquer que des travaux sontrncore en
cours actuellement à l'extérieur, au niveau du dôme.
![]() Maintenant, à l'ouest, nous nous intéressons aux
deux mausolées jumeaux du
cimetière des Barlas, formant le complexe Dorous Tilovat.
Maintenant, à l'ouest, nous nous intéressons aux
deux mausolées jumeaux du
cimetière des Barlas, formant le complexe Dorous Tilovat.
A gauche, Tamerlan a fait bâtir un mausolée pour le Cheikh Chamseddin Koulyal
(construction en 1373-74), soufi, conseiller de son père, Taraghay. A droite,
c'est le mausolée Goumbaz-Sayyidan (1437-38) construit par Ouloug Beg pour des
membres de sa famille.
| ||||
4 - Sur le chemin du retour
vers Samarcande
![]() 15H30, il est temps de
prendre le chemin du retour vers Samarcande car un trajet de 3 heures nous
attend.
15H30, il est temps de
prendre le chemin du retour vers Samarcande car un trajet de 3 heures nous
attend.
Nous faisons donc le chemin inverse de l'aller. Paysage de culture (maïs) et de
verts pâturages, briqueterie et maisons en construction, canaux d'irrigation,
alignement de mûriers. Une curiosité que l'on voit mieux à cette heure-ci qu'à
l'aller, ce sont les bouses étalées à sécher puis empilées en meules d'un mètre
de haut pour être utilisées comme combustible. Le paysage devient plus sec.
Curieusement, tout à coup une statue de travailleur dans le style "art
soviétique" se dresse, pic brandi.
Très couleur locale, une dame au teint bien basané en raison de son travail au
grand air rentre de ses champs à dos d'âne. Les terrasses et les toits à très
faible pente témoignent de l'aridité du climat.
![]() Il y a une heure que nous
roulons et une pause d'une demi-heure est l'occasion de s'arrêter au pied d'une
petite colline sur le flanc de laquelle un petit hameau s'est
développé.
Nous allons y rencontrer une famille installée dans des maisons traditionnelles.
Près des maisons en terre, la yourte du grand-père est toujours en place (sans
doute pour nous, les touristes). C'est l'occasion de visiter les alentours:
meules de bouse sèche, puits, étables, cuisines avec les fours tandyr où une
femme est en train de cuire des pains. Petite démonstration du berceau
traditionnel avec un baigneur que l'on équipe de l'attirail traditionnel: petit moment de rigolade.
Il y a une heure que nous
roulons et une pause d'une demi-heure est l'occasion de s'arrêter au pied d'une
petite colline sur le flanc de laquelle un petit hameau s'est
développé.
Nous allons y rencontrer une famille installée dans des maisons traditionnelles.
Près des maisons en terre, la yourte du grand-père est toujours en place (sans
doute pour nous, les touristes). C'est l'occasion de visiter les alentours:
meules de bouse sèche, puits, étables, cuisines avec les fours tandyr où une
femme est en train de cuire des pains. Petite démonstration du berceau
traditionnel avec un baigneur que l'on équipe de l'attirail traditionnel: petit moment de rigolade.
Visite aux tisseuses de
tapis de laine assises au pied de leur métier vertical dans leur
atelier-boutique. Coup d'oeil dans les pièces d'habitations où l'on voit que la
modernité est arrivée jusqu'ici (lits, TV...).
On nous sert un thé et il faut repartir.
![]() Encore une heure et demie de
route. La route à deux chaussées qui remonte vers Samarcande permet d'améliorer
la vitesse moyenne.
Encore une heure et demie de
route. La route à deux chaussées qui remonte vers Samarcande permet d'améliorer
la vitesse moyenne.
Paysage très aride où l'on peut voir un vieux tracteur soviétique à chenilles en
train de labourer ce qui ressemble à un désert en cette saison. Dans la steppe,
ici une tente et là des ballots de fourrage obtenus à partir de la maigre
végétation spontanée et aussi d'immenses troupeaux de centaines de moutons noirs. Les
montagnes sur notre droite sont superbement éclairées par le soleil qui baisse à
l'horizon.
18H20, enfin de retour à
Samarcande. Encore 10 minutes pour traverser la ville et retrouver notre hôtel.
![]()
![]() A 19H30 départ à pied pour
aller dîner au restaurant Arbat à 400 mètres de l'hôtel sur la
rue Mirzo Ulugbek (n°19), facilement repérable avec sa statue de femme au
parapluie ouvert (!) plantée au pied de l'escalier qui y conduit. Un resto chic
sur deux niveaux où l'on sert de la cuisine russe et européenne. Excellent
repas "traditionnel": paillasson de pommes de terre, potage (carotte/potiron),
agneau grillé (chachliks) et gâteau...
A 19H30 départ à pied pour
aller dîner au restaurant Arbat à 400 mètres de l'hôtel sur la
rue Mirzo Ulugbek (n°19), facilement repérable avec sa statue de femme au
parapluie ouvert (!) plantée au pied de l'escalier qui y conduit. Un resto chic
sur deux niveaux où l'on sert de la cuisine russe et européenne. Excellent
repas "traditionnel": paillasson de pommes de terre, potage (carotte/potiron),
agneau grillé (chachliks) et gâteau...
| ||||
![]() Après cela, la nuit sera
douce.
Après cela, la nuit sera
douce.