|
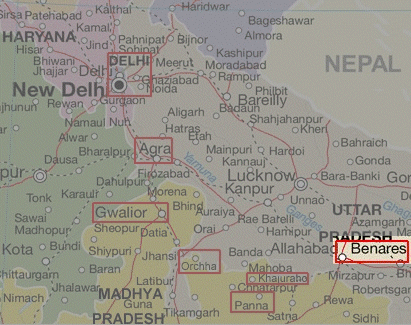
| ||||
| |||||
|
|
Avec notre programme mal défini, nous nous retrouvons à nouveau avec une matinée oisive.
![]() Nous avons rendez-vous dans le hall de l'hôtel à 12H15 où nous retrouvons
Mahipal.
Il nous accompagne à l'ancien aéroport, tout proche de l'hôtel et il prend
congé de nous.
Nous avons rendez-vous dans le hall de l'hôtel à 12H15 où nous retrouvons
Mahipal.
Il nous accompagne à l'ancien aéroport, tout proche de l'hôtel et il prend
congé de nous.
Nous aurons donc tout le temps de "déguster" les paniers-repas dont on
nous a gratifiés puisque l'avion ne décollera qu'à 14H.
Cet aéroport qui va prochainement être remplacé par un nouvel équipement est
vieillot bien qu'équiper des portiques de contrôles en double, une file pour les
hommes et une file pour les femmes. Petit aéroport puisqu'il n'a qu'une porte
d'embarquement. On ne risque pas de se tromper...
![]()
A
l'heure prévue, le Boeing 737-800 de la compagnie Jet Airways assure le vol 9W2424
à destination de Bénarès où nous nous posons 40 minutes plus tard. Un cours vol
qui nous fait repasser dans l'Etat d'Uttar Pradesh. Doit-on être rassurés
de voler avec cette compagnie? Récemment des pilotes ont laissé un groupe donner
un mini concert pendant un vol. Cela peut-il faire rétrograder son "classement
sécurité" qui est actuellement plutôt correct, B sur une échelle allant de A à
D?
![]()
![]() Nous sommes attendus
à l'aéroport Lal Bahadur Shastri par notre un chargé de transfert vers
l'hôtel et par nouveau chauffeur conduisant à nouveau une Toyota Innova..
En trajet, nous sommes joints téléphoniquement par
nouveau guide,
Nous sommes attendus
à l'aéroport Lal Bahadur Shastri par notre un chargé de transfert vers
l'hôtel et par nouveau chauffeur conduisant à nouveau une Toyota Innova..
En trajet, nous sommes joints téléphoniquement par
nouveau guide,
![]() Hanuman
Hanuman ![]() pour
convenir d'un rendez-vous en fin d'après-midi. Précisons que Hanuman est le nom
d'un héros du Rāmāyana qui à l'apparence d'un singe. Dans cette épopée, il aide
Râma à retrouver sa femme, Sita, enlevée par les démons....
pour
convenir d'un rendez-vous en fin d'après-midi. Précisons que Hanuman est le nom
d'un héros du Rāmāyana qui à l'apparence d'un singe. Dans cette épopée, il aide
Râma à retrouver sa femme, Sita, enlevée par les démons....
L'aéroport se situe à 22 kilomètres de l'hôtel Meraden Grand ***
(sur la rue Patel Nagar, non loin de l'avenue Raja Bazar), au nord-ouest. Donc
nous y sommes rapidement. Le quartier n'est pas très animé mais suffisamment
pour les chambres du côté rue, chambres mal isolées.
L'hôtel se trouve entre la gare et la rivière
Varuna qui se jette dans le Gange 7 ou 8 kilomètre plus à l'est. Non loin,
dans le centre d'un carrefour est occupé par un avion de chasse (un Follant
Gnat britannique du milieu des années 1950 que l'Inde a amélioré pour en
faire le HAL Ajeet) placé là en mémoire d'un pilote héroïque, tandis
que près de là pointe la croix surmontant la flèche de la cathédrale catholique Sainte
Marie construite en 1946.
Le nom de Varanasi provient du fait que c'est là que 2 rivières, la Varuna au Nord et l'Assi au Sud, convergent vers le Gange. Les colons anglais avaient du mal à prononcer ce nom qu'ils ont déformé en . Du coup, j'utilise indifféremment l'un ou l'autre nom selon l'humeur du moment. Cette ville est considérée comme l'une des villes les plus anciennement habitées du monde. Aujourd'hui, c'est la ville compte un peu plus de 1,2 million d'habitants.
Selon la tradition hindoue, c'est depuis cette ville que Shiva s'élança en direction du ciel sous la forme d'une colonne de lumière d'où l'autre nom de la ville, Kashi, "la ville de la lumière". Bien que la tradition la fasse remonter à 3000 ans avant notre ère, la ville de Bénarès a été probablement fondée au VIIe siècle avant J.-C., ce qui en fait l'une des villes les plus anciennement habitées du monde.
Dédiée principalement à Shiva, à ce titre, c'est l'une des 7 villes sacrées de l'hindouisme avec Haridwar (Uttaranchal), Ayodhya (Uttar Pradesh), Mathura (Uttar Pradesh), Dwarka (Goujerat), Kanchipuram (Tamil Nadu) et Ujjain (Madhya Pradesh). C'est un peu la Jérusalem des religions monothéistes, La Mecque des musulmans où le Lourdes des catholiques...
Depuis 1998, Bénarès est inscrite sur la liste indicative du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
En dehors de la population locale permanente et des touristes, il y a deux types de pratiquants hindous qui se rendent à Bénarès. Les (encore) bien portants qui viennent en pèlerinage se purifier ("remettre leur karma à zéro" oserait-on dire) et les mourants que l'on ne voit pas car hébergés dans des mouroirs voisins des ghâts jusqu'à l'issue fatale mais on voit leur dépouille sur les bûchers au bord du fleuve.
Notre guide Hanuman et le chauffeur passent nous récupérer à 17H. Notre fin de journée va être "consacrée à la découverte de la grande cérémonie hindoue qui a lieu chaque soir sur les ghâts du Gange (les marches qui descendent au fleuve), le Ganga Arti. Selon la manière plus ou moins fine de voir les choses, cette ville compte de 90 ghât à plus d'une centaine, qui s'étendent sur plus de 6 kilomètres.
En effet, le fleuve sacré est considéré par les Hindous un peu comme une mère céleste "Maa Ganga", issue de la chevelure (étrangement, certaines publications parlent de "la sueur des pied" !) de Shiva et descendue de l'Himalaya afin de purifier les êtres de leurs péchés. D'où le genre féminin utilisé ici pour désigner le fleuve "la Gange". Long de 2700 kilomètres, le Gange est un des 5 plus grands fleuves du monde grâce à son débit. Il traverse l'Inde du nord et s'écoule de l'Himalaya, au confins du Tibet, au delta du Bengale. Il est considéré par les Hindous comme le fleuve le plus sacré d'Inde et il joue, également, un rôle très important dans l'irrigation des terres.
|
|
![]() Dix minutes de voiture en direction des ghâts distants de moins de 5 kilomètres
mais pour aller jusqu'au bout il faut changer de moyen de locomotion en raison de la circulation la plus
chaotique que nous ayons jamais vues (nous sommes un dimanche n'est-ce pas?).
Dix minutes de voiture en direction des ghâts distants de moins de 5 kilomètres
mais pour aller jusqu'au bout il faut changer de moyen de locomotion en raison de la circulation la plus
chaotique que nous ayons jamais vues (nous sommes un dimanche n'est-ce pas?).
Le relais est pris par des vélos rickshaws (ou trishaw) plus ou moins brinquebalants pour une
vingtaine de minutes. L'immersion dabs le chaos est plus saisissante et on se
demande à tout instant comment on peut éviter d'être tamponner par les véhicules
plus importants, donc de fait prioritaires, surtout qu'aucune règle ne semble
s'appliquer sinon l'usage universel des klaxons pour tous les véhicules
motorisés. Lorsque l'élan est cassé ou que la route monte, le conducteur est
obligé de descendre et de tirer l'engin par le guidon. A deux passagers adultes
c'est vrai que la charge doit être de l'ordre de 140-150 kilos. On a alors très
mauvaise conscience, avec l'envie de descendre pour le soulager mais ce serait
faire insulte car c'est son gagne-pain. Aucun famille indienne faisant appel à
ce moyen de transport ne le ferait d'ailleurs. Au bout de l'avenue
Benia Bagh, nous passons près de l'imposante église Saint Thomas au crépis jaune
pâle construite au XVIIe siècle dans le style néogothique géorgien. A ce
carrefour, nous avons tourné sur la rue Godowlia qui conduit aux ghâts.
BENARES, trajet vers les ghâts
![]() Peu après, les rickshaws ne peuvent plus continuer donc nouvelle façon de se déplacer pour parcourir le dernier tronçon, la marche à
pied. Mais c'est aussi une aventure. Il faut tout d'abord savoir réussir à
traverser un carrefour que coupe des véhicules motorisés (auto rickshaws et
motos) sans se faire renverser. Pour cela
Hanuman a une
méthode infaillible qui consiste à faire une chaîne de ses touristes en
les faisant se donner la main. On a
presque l'impression de faire partir d'une couvée de canetons. Après ce passage
délicat, le risque c'est de se perdre de vue dans un indescriptible grouillement
de gens qui se pressent pratiquement (et heureusement) dans la même direction, surtout que le soir venant, il
est plus de 17H30, la lumière baisse. L'avenue à deux chaussées est tout
particulièrement encombrée côté gauche (circulation à l'anglaise oblige). A
l'approche du fleuve, le long de la barrière séparative, on voit des gens assis,
sans qu'on sache s'il faut les considérer comme des mendiants.
Hanuman nous
précise qu'il s'agit de pauvres venus en pèlerinage à Bénarès, logés près de là dans un
baraquement de tôles tordues qu'il nous désigne, et qui attendent que les pèlerins plus fortunés leur fasse une
aumône, le plus souvent de nourriture. En effet, le pèlerinage à Bénarès
ne serait pas valide si tous les rituels ne sont pas accomplis: prière de l'Arti
comme ce soir, bain rituel dans le Gange, prière au temple
Kashi Vishwanath
et faire l'aumône. La rue est bordée de boutiques de vêtements, saris et robes à
la mode. Les trottoirs sont envahis de marchandises diverses et d'offrandes
notamment des colliers et guirlandes d'oeillets d'Inde...
Peu après, les rickshaws ne peuvent plus continuer donc nouvelle façon de se déplacer pour parcourir le dernier tronçon, la marche à
pied. Mais c'est aussi une aventure. Il faut tout d'abord savoir réussir à
traverser un carrefour que coupe des véhicules motorisés (auto rickshaws et
motos) sans se faire renverser. Pour cela
Hanuman a une
méthode infaillible qui consiste à faire une chaîne de ses touristes en
les faisant se donner la main. On a
presque l'impression de faire partir d'une couvée de canetons. Après ce passage
délicat, le risque c'est de se perdre de vue dans un indescriptible grouillement
de gens qui se pressent pratiquement (et heureusement) dans la même direction, surtout que le soir venant, il
est plus de 17H30, la lumière baisse. L'avenue à deux chaussées est tout
particulièrement encombrée côté gauche (circulation à l'anglaise oblige). A
l'approche du fleuve, le long de la barrière séparative, on voit des gens assis,
sans qu'on sache s'il faut les considérer comme des mendiants.
Hanuman nous
précise qu'il s'agit de pauvres venus en pèlerinage à Bénarès, logés près de là dans un
baraquement de tôles tordues qu'il nous désigne, et qui attendent que les pèlerins plus fortunés leur fasse une
aumône, le plus souvent de nourriture. En effet, le pèlerinage à Bénarès
ne serait pas valide si tous les rituels ne sont pas accomplis: prière de l'Arti
comme ce soir, bain rituel dans le Gange, prière au temple
Kashi Vishwanath
et faire l'aumône. La rue est bordée de boutiques de vêtements, saris et robes à
la mode. Les trottoirs sont envahis de marchandises diverses et d'offrandes
notamment des colliers et guirlandes d'oeillets d'Inde...
A 17H45, nous prenons
place sur une terrasse sur le côté sud du ghât de Dashashwamedh ("le
sacrifice des dix chevaux") à proximité du temple de Vishwanath, avec le confort
d'être assis sur des chaises en plastique et avec vue directe sur les longues marches
descendant vers le fleuve et les autels, moyennant l'équivalent d'un ou deux euros.
Une foule considérable se presse à quelques mètres en dessous, foule dans
laquelle on peut même apercevoir quelques musulmans avec leur calotte blanche,
des moines bouddhistes et forcément de faux et vrais sâdhus (renonçants qui
ont fait vœu de pauvreté). Evidemment, une vache participe aussi au rassemblement,
couchée tout en haut des marches. D'autres pèlerins nous font face, sur des
centaines de barques bondées. Autour d'eux flottent des coupelles portant des
bougies. Combien sommes-nous ici et sur un autre ghât moins important ?
10 000 ? ou 20 000 ? puisque généralement les pèlerins restent ici deux jours selon
Hanuman... On
peut lire parfois le nombre de 60 000...
L'Arti (Ārtī)
ou aarti ou encore arati est un culte en l'honneur de la déesse Gangā, principalement
célébré au ghât
de Dashashwamedh. A sa droite est érigé un petit oratoire, le temple
Shitala, déesse de la variole, avec un lingam pour commémorer le sacrifice
légendaire des dix chevaux.
![]()
![]()
Huit parasols lumineux encadrent sept autels. Un peu avant 18H, les prêtres
commencent à se rassembler sur l'autel dressé au centre au-dessus duquel une
banderole porte l'inscription "Ganga Seva Nidhi", le nom d'une association qui
commémore la mémoire de Satyendra Mishra (Munnan Maharaj) né à Bénarès en
1951 et disparut en 2013 après avoir célébré ici l'Arti pendant de nombreuses
années....
| ||||
A 18H15, les sept brâhmanes officiant se sont rassemblés à l'autel central et commencent à prier ensemble durant quelques minutes avant de rejoindre chacun leur autel. Ils vont officier pendant trois quarts d'heures, accompagné par un chant retransmis par la sono et par le tintement de dizaines de clochettes suspendues à des portiques et accrochées à des fils que tirent des fidèles ou de celles tenues par les prêtres, par des battement de tambours et sons de conques. Mais ce n'est rien à côté des rassemblements Ganga Mahotsave et Dev Deepawali qui ont lieu fin novembre au cours desquels on peut voir 21 brahmanes effectuant le Ganga Aarti tandis que 41 jeunes filles chantent des hymnes et des prières.
| ||||
Les officiants sont jeunes car ils vont rester debout exécutant une
succession d'offrandes-bénédictions plutôt physiques dans les quatre directions
cardinales: à l'est face au fleuve, puis au sud, à l'ouest (vers nous, vers les gens
debout sur
les ghâts) et au nord pour finir. Cela commence avec des bâtons d'encens,
puis un brûloir dégageant beaucoup de fumée (bois de santal?), puis une
fleur, puis un lourd chandelier pyramidal à six couronnes de bougeoirs surmonté
d'une mèche sans doute
imbibée de ghī (beurre clarifié) ou de camphre, puis un flamme
puissante jaillissant d'une lourde vasque surmontée de 7 têtes
de cobra tenue à bout de bras et enfin un éventail en plumes de paons.
Même pour nous, c'est une atmosphère à la fois irréelle et prenante tant les
participants vivent intensément ce rituel.
![]()
![]()
![]() Nous quittons un peu avant
19H afin de ne pas être trop pris dans la foule puis des embouteillages
inextricables. Trois quarts d'heure plus tard nous serons à l'hôtel pour dîner
et dormir d'un sommeil rempli de rêves étranges.
Nous quittons un peu avant
19H afin de ne pas être trop pris dans la foule puis des embouteillages
inextricables. Trois quarts d'heure plus tard nous serons à l'hôtel pour dîner
et dormir d'un sommeil rempli de rêves étranges.
![]() Ce sera notre second lever matinal du voyage. Très matinal même puisque
Hanuman vient nous chercher à l'hôtel dès 5H45.
Nous partons le ventre
vide pour retourner aux ghâts afin d'assister au bain sacré.
Ce sera notre second lever matinal du voyage. Très matinal même puisque
Hanuman vient nous chercher à l'hôtel dès 5H45.
Nous partons le ventre
vide pour retourner aux ghâts afin d'assister au bain sacré.
La dernière partie du trajet est à nouveau pédestre et à 6H nous arrivons
sur la rive du Gange au ghât de Dashashwamedh, au même endroit que la
veille au soir.
La bonne heure pour une salutation au soleil qui va apparaître exactement face à
nous.
Nous attendons un petit moment l'arrivée du batelier qui a été réservé par le
guide pendant que la foule s'étoffe. Les fidèles (et les touristes) peuvent
acheter des coupelles fleuries portant une petite bougie et destinées à être
déposées par la suite sur le Gange où elles s'en vont à la dérive emportant de
frêles lumières.
Hanuman nous fait
par de sa demi surprise face à cette affluence et l'explique par la conjonction
de deux éléments du calendrier:
- dans l'univers hindi le lundi (Somavāra en sanskrit) signifie,
comme pour nous dans la plupart des langues indo-aryennes, "le jour de lune" (du
latin lunae dies)
- de plus nous sommes au premier jour d'une nouvelle lune, précisément
début d'une nouvelle année lunaire pour les Chinois mais pas pour les Hindous
qui célèbreront cette année leur Nouvel An le 14 avril (Premier
quartier de lune).
Avec l'humour dont il est coutumier, il nous indique que quelque part dans
la foule se trouvent son épouses et sa belle-soeur qui en tel moment ne peuvent
se dispenser du bain rituel, pour leur salut mais aussi pour préserver leur
mari... Selon Hanuman,
cet attachement peut aussi être obtenu par l'épouse qui fait 108 fois le tour d'un
banian sacré en enroulant un fil autour de son tronc. Foi de brahmane puisque telle est la caste de notre guide...
Ainsi, en respectant le patrivat (voeux de consécration à l'époux), la femme
accompli son dharma. Il faut savoir que le veuvage pour les femmes
hindoue reste une malédiction. Une veuve ne peut pas se
remarier et souvent la belle-famille la rend responsable de la mort
de son époux... Il y a un peu plus d'un siècle, les veuves se jetaient encre
dans le bûcher funéraire de leur mari. Ce terrifiant sacrifice des sati
était apparu au VIe siècle et s'est parfois poursuivi au-delà de son
interdiction promulguée en 1829.
 A 6H20, nous montons sur une petite barque qui va remonter le Gange, c'est-à-dire
vers le sud. Cela peut sembler curieux car le cours général du fleuve le fait
descendre de l'Himalaya donc du nord mais au niveau de Bénarès il effectue une
boucle. Quelques minutes après le départ du Dashashwamedh Ghât
nous sommes abordés par un vendeur de
coupelles-bougeoirs à déposer sur l'eau. Avec tout ce qui se dit à propos du
Gange, on pourrait s'attendre à ce que ses eaux dégagent des odeurs
incommodantes où qu'y flottent des déchets divers voire des restes humains. Rien
de cela, du moins dans cette partie amont du fleuve.
A 6H20, nous montons sur une petite barque qui va remonter le Gange, c'est-à-dire
vers le sud. Cela peut sembler curieux car le cours général du fleuve le fait
descendre de l'Himalaya donc du nord mais au niveau de Bénarès il effectue une
boucle. Quelques minutes après le départ du Dashashwamedh Ghât
nous sommes abordés par un vendeur de
coupelles-bougeoirs à déposer sur l'eau. Avec tout ce qui se dit à propos du
Gange, on pourrait s'attendre à ce que ses eaux dégagent des odeurs
incommodantes où qu'y flottent des déchets divers voire des restes humains. Rien
de cela, du moins dans cette partie amont du fleuve.
| ||||
![]() Alors que le jour se lève à peine, nous allons passer successivement devant une
série de ghâts plus ou moins fréquentés et rendus un peu flous par une
atmosphère vaporeuse et comme irréelle, certes magique mais guère plus propice
que l'obscurité à la prise de photos:
Alors que le jour se lève à peine, nous allons passer successivement devant une
série de ghâts plus ou moins fréquentés et rendus un peu flous par une
atmosphère vaporeuse et comme irréelle, certes magique mais guère plus propice
que l'obscurité à la prise de photos:
- Ahalya Bai Ghât construit au pied d'un imposant palais (XVIIIe s.)
- Munshi Ghât également au pied d'un palais de la même époque que le
précédent
- Rana Ghât, pas vraiment sacré puisqu'utilisé par les musulmans, au pied
du palais du maharana d'Udaipur
- Raja Ghât est très repérable par ses marches recouvertes de draps un peu
grisâtres mis à décher là par les dhobi, les blanchisseurs. Il est
surmonté par la résidence construite par un prince marathe au XIXe pour héberger
les brahmanes
- puis se sont de petits temples du Someshwara Ghât consacré à la
lune comme son nom hindi l'indique
- Manasarowar Ghât avec un palais de Man Singh d'Amber
- des égouts débouchant dans le fleuve
- Kedar Ghât où se presse la foule des pèlerins originaires du
sud comme en témoigne l'architecture du temple bâti ici et dédié à Shiva
- vers 6H45 nous rebroussons chemin à hauteur du Harishchandra Ghât, un
ghât de crémation situé en amont du fleuve et pour cela modernisé pour
effectuer des crémations au four électrique.
![]()
 Nous ne remonterons pas les 6 Ghâts suivants jusqu'à l'embouchure de la rivière Asi.
Maintenant nous redescendons le fleuve un peu plus au large des ghpats pour faire
place aux barques qui nous suivent. Nous passons devant le ghât principal,
le
Dashashwamedh Ghât,
un peu noyé dans la brume qui s'élève du fleuve. Face au disque solaire tout rose,
dans la brume matinale, nous
voyons les fidèles allant jusqu'à s'immerger totalement dans l'eau à plusieurs
reprises et on peut en voir qui en boivent une gorgée dans le creux de la main.
Les hommes sont torse nu, vêtus d'un simple slip, short ou pagne. Les femmes
sont généralement
en
sari sous lequel elles portent une sorte de brassière ou de corsage serré (choli)
laissant le ventre nu.
Nous ne remonterons pas les 6 Ghâts suivants jusqu'à l'embouchure de la rivière Asi.
Maintenant nous redescendons le fleuve un peu plus au large des ghpats pour faire
place aux barques qui nous suivent. Nous passons devant le ghât principal,
le
Dashashwamedh Ghât,
un peu noyé dans la brume qui s'élève du fleuve. Face au disque solaire tout rose,
dans la brume matinale, nous
voyons les fidèles allant jusqu'à s'immerger totalement dans l'eau à plusieurs
reprises et on peut en voir qui en boivent une gorgée dans le creux de la main.
Les hommes sont torse nu, vêtus d'un simple slip, short ou pagne. Les femmes
sont généralement
en
sari sous lequel elles portent une sorte de brassière ou de corsage serré (choli)
laissant le ventre nu.
Le bain sacré est l'une des nombreuses méthodes prétendant conduire sur le chemin de la
Moksha (ou libération). Pour sa part, compte tenu des circonstances,
Hanuman se
contentera tout en priant de s'asperger le visage à trois reprises en se penchant sur le bord
de la barque.
| ||||
| ||||
|
|
![]() Passant au dessus du Manikarnika Ghât, le ghât des
crémations, en se faufilant entre les tas de bûches, Hanuman
nous guide vers le dédale des ruelles de la vieille ville, le Chowk, une sorte
de bazar. Comme le Petit Poucet, vaches sacrées et chiqueurs de bétel ont chacun
à leur manière balisé leur itinéraire, ici de bouses et là de crachats
sanguinolents. Donc il faudrait avoir un oeil fixant le bout de ses chaussures.
On passe auprès de minuscules oratoires-temples le plus souvent dédiés au dieu
régénérateur Shiva si l'on en juge par les lingams (symbole phallique) et yonis (sexe
féminin) ou par le taureau Nandi qui le symbolisent. Au pied d'anciens palais
décrépits on a quelques peines à croiser des vaches tant les ruelles sont
étroites.
Passant au dessus du Manikarnika Ghât, le ghât des
crémations, en se faufilant entre les tas de bûches, Hanuman
nous guide vers le dédale des ruelles de la vieille ville, le Chowk, une sorte
de bazar. Comme le Petit Poucet, vaches sacrées et chiqueurs de bétel ont chacun
à leur manière balisé leur itinéraire, ici de bouses et là de crachats
sanguinolents. Donc il faudrait avoir un oeil fixant le bout de ses chaussures.
On passe auprès de minuscules oratoires-temples le plus souvent dédiés au dieu
régénérateur Shiva si l'on en juge par les lingams (symbole phallique) et yonis (sexe
féminin) ou par le taureau Nandi qui le symbolisent. Au pied d'anciens palais
décrépits on a quelques peines à croiser des vaches tant les ruelles sont
étroites.
A ce moment, le grand souci d'Hanuman,
c'est de savoir si l'on pourra passer au Kashi Vishwanath, autrement appelé
Temple d'Or, qui voisine avec une mosquée. En effet l'accès à toutes les ruelles entourant le pâté de maisons
est contrôlé par des militaires du fait de sa proximité avec la mosquée
d'Aurangzeb et cela rappelle une longue histoire émaillée de conflits inter-religieux.
DESTRUCTIONS ET RECONSTRUCTIONS MULTIPLES DU KASHI VISHWANTH (ou "Temple d'Or")
Un premier temple est évoqué par un texte sacré de l'hindouisme, le Skanda Purana écrit 5 siècles avant l'ère chrétienne. Le temple original a été détruit à la fin du XIIe siècle lors des premières invasions musulmanes. Reconstruit peu après il est à nouveau détruit par le sultan de Delhi au XVe siècle. Il est encore reconstruit peu après, pendant l'empire moghol, jusqu'à sa dernière destruction par le très intolérant empereur Aurangzeb en 1669. A sa place, il fait bâtir une mosquée que l'on connaît sous le nom de Gyanvapi Masjid (ne pas confondre avec la mosquée d'Aurangzeb située au niveau du Panchganga Ghât), en réemployant des matériaux de l'ancien temple. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Empire marathe avait envisagé de détruire cette mosquée pour rebâtir le temple à sa place mais finalement le maharaja de Jaipur choisit une solution plus pacifique en achetant des terrains dans le voisinage immédiat de cette mosquée afin d'y reconstruite un temple. Ce qui fut fait au siècle suivant et il fut embelli grâce aux généreuses donations en argent ou en or, don de 800 kilos d'or (certains donnent le chiffre de 500kg) par un maharaja sikh afin de recouvrir les plaques de cuivre des dômes.
Ici, c'est un lieu propice aux frictions, voire pire. Des émeutes ou des attentats ont parfois lieu et peuvent survenir à tout moment,
comme en 2006 (une quinzaine de victimes). Depuis, seuls les fidèles sont
autorisés à pénétrer dans l'édifice et peuvent voir dans le Saint des Saint, un
lingam noir poli reposant sur un autel d'or. Au mieux les non-hindous doivent se
contenter d'entrapercevoir la flèche depuis l'étroit boyau qui y conduit. Mais
rien que pour cela, le suspense dure jusqu'au dernier moment.
Hanuman joue de
son appartenance à la caste des brahmanes pour négocier avec l'un des siens qui
tient une boutique de tissus bien située puisque justement adossée au temple. Ce commerçant en
joue à son tour pour négocier notre passage auprès du militaire qui contrôle
l'accès au passage. Après avoir laissé nos sacs dans la boutique à la
garde du commerçant, nous nous insérons dans la file qui se faufile dans une
allée étroite, juste pour prendre une vague photo d'une flèche du temple. Bien des soucis pour pas grand chose.
Très vite de retour dans la boutique, on se sent un peu obligé d'y faire de
menues emplettes d'autant que l'on nous sert du thé masala, le thé indien au
lait très sucré et parfumé aux épices. Problème: "nous sommes plutôt "thé vert
non sucré". Pour ne pas faire d'affront, je me sacrifie stoïquement... Je
me préoccupe inutilement du nettoyage de l'ustensile car ces coupelles en argile
sont à usage unique mais malheureusement l'usage de verres et tasses en
plastique se répand, entraînant un lot de déchets supplémentaire...
![]() Chai, le thé masala
à l'indienne
Chai, le thé masala
à l'indienne
Chai [tcahi] veut tout simplement dire thé en hindi ! C’est un dérivé du chinois mandarin cha. La culture du thé originaire de Chine arrive en Inde en 1830, apportée par les colons britanniques inquiets du monopole chinois sur sa production. Aujourd'hui, plus de 80 % de la production est destinée au marché indien !
L’ancêtre du thé masala est une boisson aux épices, dont l’origine remonte aux textes ayurvédiques. Le mélange d’épices est directement infusé dans de l’eau bouillante avec le thé ainsi que le lait et le sucre. La préparation peut varier: certains suivent la méthode sri-lankaise, dans laquelle le lait est bouilli séparément et mélangé au thé épicé dans un shaker juste avant d’être servi. La méthode indienne orthodoxe consiste à bouillir le thé noir, le sucre et les épices longuement dans le lait, qui peut être ou non mélangé avec de l’eau. Parmi les épices utilisées on trouve de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle, de la noix de muscade, du poivre, du gingembre.
Au moment du service, le chaï est "étiré" de la casserole à la verseuse en un long jet, pour refroidir mais également oxyder le breuvage. De plus, ce service impressionnant est aussi un argument de vente: le chaiwallah avec le sens du spectacle le plus prononcé pour attirer les clients.
À l’origine, le chai était servi dans des coupes d’argile à usage unique, donc d'une certaine façon recyclables à l’infini. Modernité oblige, il est dorénavant servi le plus souvent dans des gobelets en plastique, ce qui n’est pas toujours très pratique lorsqu’il est bouillant et contribue à la pollution par les déchets dont on se passerait bien…
![]() Nous reprenons notre balade dans les ruelles voisines et par une porte bouchée
par un plexiglas crasseux on peut apercevoir la mosquée Gyanvapi Masjid, voisine
du temple d'Or.
Nous arrivons bientôt sur des rues plus larges et l'avenue du
ghât de Dashashwamedh
bordée d'anciennes constructions de l'époque coloniale afin de rejoindre notre
véhicule.
Nous reprenons notre balade dans les ruelles voisines et par une porte bouchée
par un plexiglas crasseux on peut apercevoir la mosquée Gyanvapi Masjid, voisine
du temple d'Or.
Nous arrivons bientôt sur des rues plus larges et l'avenue du
ghât de Dashashwamedh
bordée d'anciennes constructions de l'époque coloniale afin de rejoindre notre
véhicule.
BÉNARÈS:
un aperçu de la ville (Université, temples de Durga et de la "Mère Inde")
![]() Il
est environ 8H15 lorsque nous partons en voiture faire un tour dans les quartiers sud.
Il
est environ 8H15 lorsque nous partons en voiture faire un tour dans les quartiers sud.
![]() Nous
passons sous la Porte Shri Guru Ravidass avant de franchir celle qui donne accès
au vaste campus de l'Université Babaras Hindu University (ou Bharat
Kala Bhavan en hindi). Fondée en 1816 d'après
Hanuman qui la
connaît bie puisqu'il y a fait ses études, c'est la plus
grande université du pays et même d'Asie avec 40 000 étudiants et 4000
professeurs (fondée en
1918 et accueillant 20 000 étudiants selon Wikipédia). Organisée sur un
plan hémicirculaire, c'est une petite ville en marge de la ville. En effet, elle
regroupe 14 facultés (dont l'une dédiée à l'astrologie!), 5 instituts
professionnels et un hôpital, sans compter les résidences destinées aux
professeurs et aux étudiants pauvres et méritants, de petits squares, une banque
et un temple...
Nous
passons sous la Porte Shri Guru Ravidass avant de franchir celle qui donne accès
au vaste campus de l'Université Babaras Hindu University (ou Bharat
Kala Bhavan en hindi). Fondée en 1816 d'après
Hanuman qui la
connaît bie puisqu'il y a fait ses études, c'est la plus
grande université du pays et même d'Asie avec 40 000 étudiants et 4000
professeurs (fondée en
1918 et accueillant 20 000 étudiants selon Wikipédia). Organisée sur un
plan hémicirculaire, c'est une petite ville en marge de la ville. En effet, elle
regroupe 14 facultés (dont l'une dédiée à l'astrologie!), 5 instituts
professionnels et un hôpital, sans compter les résidences destinées aux
professeurs et aux étudiants pauvres et méritants, de petits squares, une banque
et un temple...
Non loin de là, après être passés par des rues sales avec des cochons fouinant
dans les détritus, nous apercevons le vaste temple de Durga (Durgakund)
au bord d'un bassin entouré de ghâts. L'édifice tout de couleur pourpre date de
la fin du XIXe siècle. Nous nous contenterons d'une vue extérieure. Il est dédié
à un avatar de Parvati, épouse de Shiva, considérée comme la shakti
(l'énergie) de l'Absolu. C'est l'une des divinités principales du panthéon
hindou. L'autre avatar de Parvati est Kali avec son collier de crânes, déesse de la
préservation, de la transformation et de la destruction des mauvais esprits.
| ||||
![]() En un petit quart d'heure pour 6 kilomètres, nous revenons
vers le centre de la ville et les anciens quartiers coloniaux, non loin de la gare. Spectacles de rue
toujours étonnants comme cette famille, une mère et six enfants d'âges divers
transportés sur un vélo-rickshaw. Une fois de plus passage au carrefour proche
de l'église Saint Thomas puis traversée d'un marché installé sur le trottoir et
nous sommes à destination.
En un petit quart d'heure pour 6 kilomètres, nous revenons
vers le centre de la ville et les anciens quartiers coloniaux, non loin de la gare. Spectacles de rue
toujours étonnants comme cette famille, une mère et six enfants d'âges divers
transportés sur un vélo-rickshaw. Une fois de plus passage au carrefour proche
de l'église Saint Thomas puis traversée d'un marché installé sur le trottoir et
nous sommes à destination.
![]() Nous allons visiter rapidement un monument qualifié de mandir, autrement
dit de "temple" alors qu'il s'agit plutôt d'une sorte de musée poussiéreux et un
peu laissé à l'abandon, le Bharat Mata Mandir, consacré à la "Mère Inde". Pas de
statue ici mais sur une centaine de m² le sol est occupé par une immense
carte en relief de l'Inde faite de plus de 700 blocs de marbre sculptés en
relief. L'ouvrage voulu
par les nationalistes Shiv Prasad Gupta et Durga Prasad Khatri fut inauguré par
le Mahatma Gandhi en 1936. On peut descendre en demi sous-sol afin d'avoir une
vue rasante du relief et en perspective, notamment depuis le sud, ce qui permet d'apercevoir
tout à l'opposé l'Himalaya dans la mesure où l'échelle du relief a été
volontairement exagérée. Pour la vue aérienne depuis l'étage, "il faudra
repasser" car pour des raisons de sécurité la porte qui y donne accès est
condamnée.
Nous allons visiter rapidement un monument qualifié de mandir, autrement
dit de "temple" alors qu'il s'agit plutôt d'une sorte de musée poussiéreux et un
peu laissé à l'abandon, le Bharat Mata Mandir, consacré à la "Mère Inde". Pas de
statue ici mais sur une centaine de m² le sol est occupé par une immense
carte en relief de l'Inde faite de plus de 700 blocs de marbre sculptés en
relief. L'ouvrage voulu
par les nationalistes Shiv Prasad Gupta et Durga Prasad Khatri fut inauguré par
le Mahatma Gandhi en 1936. On peut descendre en demi sous-sol afin d'avoir une
vue rasante du relief et en perspective, notamment depuis le sud, ce qui permet d'apercevoir
tout à l'opposé l'Himalaya dans la mesure où l'échelle du relief a été
volontairement exagérée. Pour la vue aérienne depuis l'étage, "il faudra
repasser" car pour des raisons de sécurité la porte qui y donne accès est
condamnée.
![]() Moins de 10 minutes plus tard nous sommes à l'hôtel pour prendre un
petit-déjeuner un peu tardif, puisqu'il est 9H15, et mérité après tant de
mouvements.
Moins de 10 minutes plus tard nous sommes à l'hôtel pour prendre un
petit-déjeuner un peu tardif, puisqu'il est 9H15, et mérité après tant de
mouvements.
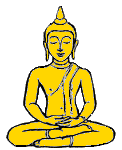 SARNATH: site bouddhique commémorant le premier sermon du Bouddha
SARNATH: site bouddhique commémorant le premier sermon du Bouddha ![]()
![]() Hanuman
nous a donné rendez-vous à 11H30 pour une dernière visite en sa compagnie.
Il s'agit de
se rendre à Sarnath, localité située au nord-est de Bénarès et distante d'une
petite douzaine de kilomètres du centre, un trajet d'une bonne demi-heure.
Hanuman
nous a donné rendez-vous à 11H30 pour une dernière visite en sa compagnie.
Il s'agit de
se rendre à Sarnath, localité située au nord-est de Bénarès et distante d'une
petite douzaine de kilomètres du centre, un trajet d'une bonne demi-heure.
Ici le Bouddha prononça son premier prêche il y a plus de 2500 ans (vers 500
avant J-C), c'est pourquoi c'est l'un des quatre grands lieux saints du
bouddhisme (il vient chronologiquement après Lumbini, lieu de naissance du Bouddha
aujourd'hui situé au Népal, Bodh Gaya, lieu de l'éveil et avant Kushinagar,
lieu de sa mort et de son accès au nirvana). Bouddha avait réuni là sa
petite communauté (Shanga) naissante avant de l'envoyer en mission pour
répandre la doctrine (Dharma). L'expansion du bouddhisme fut favorisée à
partir du IIIe siècle avant J-C par l'empereur Ashoka, un empereur également tolérant avec
les autres "religions indiennes" tels que l'hindouisme et le jainisme.
Le site continua à être
un lieu de vénération et de grands monastères s'y établirent jusqu'au XIIe
siècle, hébergeant des milliers de moines.
Brutalement tout va disparaître, la religion et ses monuments. Le site
est rasé par le sultan de Delhi Qutb ud-Din Aibak en 1194 et on assiste à la
quasi disparition du bouddhisme de la terre indienne dont une partie se convertit
de force à l'islam tandis que la majeure partie retourne à ses
croyances hindouistes issues du brahmanisme (900 à 400 avant J-C) et encore plus
loin, du védisme (un millénaire avant J-C).
Le site tombe alors dans
l'oubli durant six siècles jusqu'en 1794, lorsque Jagat Singh, le dîvân
(ministre des Finances) du raja de Bénarès, récupère des briques du Stupa
Dharmarajika pour les utiliser comme matériau de construction. Les fouilles plus
ou moins sauvages commencèrent alors et au début du XXe siècle les vestiges du
sanctuaire principal ainsi que le Pilier (ou Colonne) d'Ashoka brisé, malheureusement.
![]() Dans le joli Parc aux Daims d'environ 15 hectares ne subsistent que les vestiges
du vaste complexe érigé jadis en briques rouges de différentes factures
témoignant de différentes époques, entre le règne de l'empereur Ashoka et de
celui du sultan Aibak.
Dans le joli Parc aux Daims d'environ 15 hectares ne subsistent que les vestiges
du vaste complexe érigé jadis en briques rouges de différentes factures
témoignant de différentes époques, entre le règne de l'empereur Ashoka et de
celui du sultan Aibak.
| ||||
![]()
![]() En marchant à travers le site peu fréquenté, on verra des centaines de bases de stupas votifs à base carrée ou circulaire
ainsi que de divers temples. Selon
Hanuman, a présence d'escaliers monolithiques à 7 degrés
s'enfonçant dans le sol semble prouver que les fouilles ne sont pas descendues
au véritable niveau d'origine.
En marchant à travers le site peu fréquenté, on verra des centaines de bases de stupas votifs à base carrée ou circulaire
ainsi que de divers temples. Selon
Hanuman, a présence d'escaliers monolithiques à 7 degrés
s'enfonçant dans le sol semble prouver que les fouilles ne sont pas descendues
au véritable niveau d'origine.
Puis nous passons successivement
devant
- un élément imposant d'un garde-corps monolithique en grès, de près de
2,50 mètres de long par 1,50 mètres de largeur,
- quatre morceaux de la colonne ou Pilier d'Ashoka en grès poli qui à l'origine
mesurait une quinzaine de mètres et dont le chapiteau est exposé au Musée
que l'on va visiter tout à l'heure
- les fondations du Mulagandha Kuti Vihara qui indiquent la place où le
Bouddha passa sa première mousson
- nous approchons de l'imposant stupa reliquaire Dhamek
(son nom ancien était
Dharma Chakra), dont la structure originelle date des premiers siècles de notre
ère. On pense qu'un tumulus de terre préexistait ici comme tombeau d'un ascète.
Dans le stupa construit par l'empereur Ashoka, on aurait enchâssé de petits fragments d'os calcinés du
Bouddha et de ses disciples. Le monument cylindrique en brique, remanié et agrandi
plusieurs fois,
mesure encore environ 35 mètres de hauteur (42,60 avec les fondations) pour une
trentaine de mètres de diamètre. Il a été agrandi à six reprises
(notamment aux VIe- VIIe siècles) mais la partie supérieure est encore
inachevée. Sa base habillée de pierres jusqu'à 11 mètres de hauteur est décoré de
superbes frises de bas-reliefs
représentant des fleurs, des oiseaux ou des humains, des inscription en
l'écriture brahmanique et creusé de 8 niches orientées vers les points cardinaux
et intermédiaires. La forme cylindrique de ce stupa faisant penser à un
chapeau est différente de la
forme habituelle des stupas dans les pays bouddhistes d'Asie du Sud et du
Sud-est où ils ont l'apparence bol à aumône retourné ou de demi-sphère
posé sur une base carrée et surmonté d'une flèche. Des pèlerins tibétains en costumes traditionnel
pratiquant une circumambulation dans le sens des aiguilles d'une montre ou
sens solaire (pradakshina) autour du monument en récitant des mantra et
en faisant tourner un moulin à prière.
 Après cela, nous visitons le Musée ouvert dès 1910 à l'initiative des
archéologues britanniques. Il expose des sculptures datant du IIIe siècle
av. J.-C. au XIIe siècle de l'ère chrétienne, tant hindoues que
bouddhistes, prélevées sur le site lors des fouilles. Malheureusement les photos, même sans
flash, y sont interdites. Les pièces les plus remarquables sont exposées dans le
hall notamment le magnifique chapiteau du Pilier d'Ashoka en grès poli comme du marbre, ce
qui est extraordinaire compte tenu de la structure granulaire de ce matériau. Il
représente l'avant-corps de quatre lions dont l'un n'a subi aucune mutilation.
Ils symbolisaient cette inde impériale et symbolisent maintenant la République
indienne. Remarquable également, une imposante ombrelle en pierre, en forme de
lotus, qui protégeait la statue d'un bodhisattva. Il faudrait passer des heures
pour admirer toutes les statues présentées, non seulement dans le hall mais
aussi dans deux galeries latérales.
Après cela, nous visitons le Musée ouvert dès 1910 à l'initiative des
archéologues britanniques. Il expose des sculptures datant du IIIe siècle
av. J.-C. au XIIe siècle de l'ère chrétienne, tant hindoues que
bouddhistes, prélevées sur le site lors des fouilles. Malheureusement les photos, même sans
flash, y sont interdites. Les pièces les plus remarquables sont exposées dans le
hall notamment le magnifique chapiteau du Pilier d'Ashoka en grès poli comme du marbre, ce
qui est extraordinaire compte tenu de la structure granulaire de ce matériau. Il
représente l'avant-corps de quatre lions dont l'un n'a subi aucune mutilation.
Ils symbolisaient cette inde impériale et symbolisent maintenant la République
indienne. Remarquable également, une imposante ombrelle en pierre, en forme de
lotus, qui protégeait la statue d'un bodhisattva. Il faudrait passer des heures
pour admirer toutes les statues présentées, non seulement dans le hall mais
aussi dans deux galeries latérales.
![]() En
quittant le site, face aux fondations d'un ancien monastère, se dresse le stupa Chaukhandi, érigé
(d'après la tradition) à l'endroit de la rencontre du Bouddha et
des Bhadravargiya, ses cinq premiers disciples, et sur lequel Akbar (règne de
1556 à 1605) fit élever une tour octogonale en mémoire de son père Humayun
(règne de 1530 à 1556).
En
quittant le site, face aux fondations d'un ancien monastère, se dresse le stupa Chaukhandi, érigé
(d'après la tradition) à l'endroit de la rencontre du Bouddha et
des Bhadravargiya, ses cinq premiers disciples, et sur lequel Akbar (règne de
1556 à 1605) fit élever une tour octogonale en mémoire de son père Humayun
(règne de 1530 à 1556).
![]()
![]() Un quart d'heure de trajet pour aller faire une visite rapide dans un atelier de
tissage de la soie, une activité traditionnellement dévolue aux musulmans de Bénarès
qui réalisent les tissus de saris avec les motifs que leur commandent les hindous d'un
peu partout. Mais cette activité est renaissante suite à de
graves difficultés. En 1998 l'Inde a ouvert certains pans de l'économie aux
entreprises chinoises. Leur concurrence a mis en difficulté ce secteur du fait
qu'ils recourent au tissage mécanique à base de soie artificielle
en débitant jusqu'à 50 mètres de tissu par jour et par métier. De plus, pour
fabriquer les brocarts ils
utilisent du fil d'argent doré au lieu de fil d'or. En 2007, le gouvernement a
fait marche arrière en versant une aide aux anciennes familles tisserandes et en
les exonérant de taxes.
Un quart d'heure de trajet pour aller faire une visite rapide dans un atelier de
tissage de la soie, une activité traditionnellement dévolue aux musulmans de Bénarès
qui réalisent les tissus de saris avec les motifs que leur commandent les hindous d'un
peu partout. Mais cette activité est renaissante suite à de
graves difficultés. En 1998 l'Inde a ouvert certains pans de l'économie aux
entreprises chinoises. Leur concurrence a mis en difficulté ce secteur du fait
qu'ils recourent au tissage mécanique à base de soie artificielle
en débitant jusqu'à 50 mètres de tissu par jour et par métier. De plus, pour
fabriquer les brocarts ils
utilisent du fil d'argent doré au lieu de fil d'or. En 2007, le gouvernement a
fait marche arrière en versant une aide aux anciennes familles tisserandes et en
les exonérant de taxes.
L'atelier que nous visitons pendant une bonne demi-heure utilise deux types de
métiers à tisser: un très ancien où il faut le travail de deux ouvriers pour produire 1
centimètre par jour d'un tissu de luxe avec jusqu'à 70 nuances de
couleurs. Plus commun, le métier Jacquard semi-automatisé (dessins programmés
par carte imprimée) est plus productif, 10 centimètres par jour avec un ouvrier
mais seulement l'utilisation de 7 couleurs.
Il
est 14h lorsque Hanuman
prend congé de nous à l'hôtel, non sans nous avoir suggéré de retourner sur les
ghâts le lendemain matin puisque notre vol pour Delhi ne part qu'en milieu
d'après-midi. Il conseille de faire appel à des vélos-rickshaws (plutôt qu'à des
auto-rickshaws) qui nous y conduiront pour 150INR (2€) par
vélo donc pour deux passagers.
![]()
![]() Dîner à l'hôtel où l'on est impressionné par le grouillement de personnel en
cuisine, une dizaine de personnes.
Après le déjeuner, petit tour dans le quartier. Le ciel est bien laiteux et
l'air un peu frais car il a neigé sur l'Himalaya. Tout près de l'hôtel, nous
passons près d'une famille très pauvre, une femme et des enfants sales et en
hayons qui semblent habiter là sur un coin de terrain envahi d'ordures et qui
vivent en élevant quelques poules et des cochons. Ce sont des intouchables particulièrement démunis. On essayera de s'en
souvenir lors de notre balade du lendemain. Nous faisons un petit bout de
chemine sur le boulevard Raja Bazar très animé puis passons au carrefour
où est érigé le monument avec un avion de chasse, non loin de la cathédrale
Sainte Marie.
Dîner à l'hôtel où l'on est impressionné par le grouillement de personnel en
cuisine, une dizaine de personnes.
Après le déjeuner, petit tour dans le quartier. Le ciel est bien laiteux et
l'air un peu frais car il a neigé sur l'Himalaya. Tout près de l'hôtel, nous
passons près d'une famille très pauvre, une femme et des enfants sales et en
hayons qui semblent habiter là sur un coin de terrain envahi d'ordures et qui
vivent en élevant quelques poules et des cochons. Ce sont des intouchables particulièrement démunis. On essayera de s'en
souvenir lors de notre balade du lendemain. Nous faisons un petit bout de
chemine sur le boulevard Raja Bazar très animé puis passons au carrefour
où est érigé le monument avec un avion de chasse, non loin de la cathédrale
Sainte Marie.
BÉNARÈS:
un dernier tour vers la vielle ville, les ghâts et les bûchers de
crémations ![]()
Mardi 9 février
Nous avons fait provision de viennoiseries au buffet du petit-déjeuner pour en faire profiter la famille pauvre qui réside non loin de l'hôtel, sur le chemin pour aller vers les vélos rickshaws stationnés à un carrefour proche. Ces pauvres petites indiennes et leur mère n'en reviennent pas de cette pourtant bien modeste attention à leur égard.
 Un peu après 8H30, nous
sommes au point où stationnent les rickshaws. Pas de problème avec les
conducteurs, le tarif annoncé par le guide (sans doute majoré par rapport à
celui appliqué aux Indiens) est bien celui qu'on nous demande. Comme nous sommes
trois, il est fait appel à un second conducteur. On nous fait même comprendre
que les conducteurs sont près à nous attendre le temps de notre courte balade
d'environ deux heures et l'on ne paiera qu'au retour. Et c'est parti,
direction le quartier de Godoulia. Un parcours un peu différent de celui de la
veille dans sa première partie, avant de retrouver l'avenue Benia Bagh et, près
de l'église Saint Thomas, le carrefour avec la rue Godowlia
aboutissant aux ghâts. Comme les rues sont moins encombrées que les jours
précédents, le trajet aura duré seulement une vingtaine de minutes et il est
plus facile d'observer la vie local: enfants allant à l'école à pied ou en
rickshaw, livreur de coupelles à thé masala, troupeau de chèvres,
bâtiments coloniaux, moines bouddhistes près d'un temple...
Un peu après 8H30, nous
sommes au point où stationnent les rickshaws. Pas de problème avec les
conducteurs, le tarif annoncé par le guide (sans doute majoré par rapport à
celui appliqué aux Indiens) est bien celui qu'on nous demande. Comme nous sommes
trois, il est fait appel à un second conducteur. On nous fait même comprendre
que les conducteurs sont près à nous attendre le temps de notre courte balade
d'environ deux heures et l'on ne paiera qu'au retour. Et c'est parti,
direction le quartier de Godoulia. Un parcours un peu différent de celui de la
veille dans sa première partie, avant de retrouver l'avenue Benia Bagh et, près
de l'église Saint Thomas, le carrefour avec la rue Godowlia
aboutissant aux ghâts. Comme les rues sont moins encombrées que les jours
précédents, le trajet aura duré seulement une vingtaine de minutes et il est
plus facile d'observer la vie local: enfants allant à l'école à pied ou en
rickshaw, livreur de coupelles à thé masala, troupeau de chèvres,
bâtiments coloniaux, moines bouddhistes près d'un temple...
![]() Le premier conducteur s'en va stationner les engins dans l'arrière-cour d'un
magasin tenu par son frère qui se propose d'ailleurs de nous accompagner ainsi
que les conducteurs.
Le premier conducteur s'en va stationner les engins dans l'arrière-cour d'un
magasin tenu par son frère qui se propose d'ailleurs de nous accompagner ainsi
que les conducteurs.
Nous abordons les ghâts au
niveau de l'Ahalya Bai Ghât tandis qu'il y a toujours des pèlerins se
baignant au Munshi Ghât. Nous voici bientôt au ghât principal,
Dashashwamedh. De là nous nous
enfonçons une nouvelle fois dans les ruelles du Chowk, la vieille ville. Là
aussi, on
circule plus aisément que la veille.
Puis nous revenons vers les ghâts du côté de Lalita Ghât.
Sur des ghâts pratiquement
déserts, nous poursuivons vers le nord, par le Jalsain Ghât. Retour sur les
marches où se prélassent des chèvres tandis qu'un marchand d'offrandes attend le
chaland.
A 9H30, nous arrivons "dans le dur", au Manikarnika Ghât avec ses bûchers de crémation qui se signale à nous par un bruit de cognée tapant sur un coin d'acier pour fendre de grosses bûches. Sur les ghâts de Bénarès ont lieu quotidiennement 200 à 300 crémations (d'autres sources évoquent plus modestement 32 000 crémations annuellement).
Notre temps étant compté et
ne souhaitant pas assister au rituel jusqu'à la fin nous prenons congé du guide
en lui remettant la valeur de quelques kilos de bois pour ses futurs morts
indigents. Il nous dira en partant que les Indiens vivent cette séparation
sereinement puisque c'est l'aboutissement attendu de leur destinée et que l'on
ne revient pas en visite sur ce lieu comme on le fait dans nos cimetières.
D'après ce que l'on peut lire sur le sujet, pendant la suite de la crémation,
les dom veillent à entretenir le feu en rassemblant les morceaux au
centre du foyer à l'aide des perches en bambou qui servaient de brancard. C'est
également avec ces perches que l'officiant (ici le mari) brise le crâne du
mort afin de faciliter sa libération... Autre façon de procéder à cette ultime
délivrance, l'officiant brise le crâne calciné avec une noix de coco pour
que l'âme puisse s'échapper de son enveloppe charnelle. A la fin de la crémation, le sol est
sommairement nettoyé, les cendres balayées dans le fleuve. L'officiant qui est
resté le dernier remplit alors une vasque en terre cuite d'eau du Gange tourne
alors le dos au lieu de la crémation et jette le récipient par dessus son épaule
en guise de geste d'adieu. J'ai également lu que la cruche remplie d'eau
était placée inclinée près du bûcher afin de se vider peu à peu, symbolisant la
vie qui s'échappe...
Finalement, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce rituel n'a rien de
macabre. Au contraire, au-delà du respect témoigné au défunt, pas de tristesse
mais une grande
sérénité se dégage de cette cérémonie. En un mot: émouvant...
![]()
![]()
![]() A 10H, après avoir passé le Man Mandir Ghât, nous regagnons le ghât principal.
Nous
faisons un petit détour au temple dit "népalais",
réplique d’un temple de Pashupatinath
au Népal (lieu de crémation sur
la rivière Bagmati qui se jette dans le Gange) particulièrement original avec sa
double toiture en pagode. Il est construit en brique et en bois sur lequel on
peut voir quelques bas-reliefs érotiques. Après quoi, nous allons marcher
tranquillement en direction du sud pour nous arrêter avant
le Raja Ghât, le ghât des blanchisseurs.
A 10H, après avoir passé le Man Mandir Ghât, nous regagnons le ghât principal.
Nous
faisons un petit détour au temple dit "népalais",
réplique d’un temple de Pashupatinath
au Népal (lieu de crémation sur
la rivière Bagmati qui se jette dans le Gange) particulièrement original avec sa
double toiture en pagode. Il est construit en brique et en bois sur lequel on
peut voir quelques bas-reliefs érotiques. Après quoi, nous allons marcher
tranquillement en direction du sud pour nous arrêter avant
le Raja Ghât, le ghât des blanchisseurs.
Nous revenons sur nos pas. Quelques personnes se baignent encore
du côté du Munshi Ghât. On peut voir plus loin un guru shivaïte sur le front
duquel sont tracées à la cendre trois barres horizontales, assis en lotus,
portant une longue barbe, torse nu et bas du corps couvert d'un
pagne. Puis c'est un charmeur de serpent puis un sâdhu au corps couvert de
cendre de bouse de vache et totalement nu. Arrivés au
Dashashwamedh Ghât,
nous rencontrons un sâdhu aperçu la ville au soir, au corps également couvert de cendre.
Bien bedonnant, il est couché, vêtu d'un seul pagne. Ce qui semble indiquer
qu'il n'a pas renoncé à tout. Les vrais sâdhus vivent sans argent. Il accepte
d'être photographié sans rien nous demander. Il ne
touche pas le billet que nous tendons mais c'est "un jeune disciple" qui s'en
charge.
Coup d'oeil
à de petits temples, à un coiffeur qui rase la tête d'un homme qui a perdu un
proche et se prépare ainsi pour la crémation.
| ||||
LES ETAPES DE LA VIE: de la naissance au renoncement
Pour l'hindouisme, l'homme naît trois fois.
- La première fois, il naît de son père et de sa mère.
- Puis une seconde fois par le mariage. L’homme est symboliquement vêtu en blanc (le sperme) et la femme en rouge (le sang).
- Enfin, quand il meurt et qu'on le dépose sur le bûcher, c'est alors qu'il naît pour la troisième fois.
Chez les hindous, entre deux réincarnations, la vie est découpée en quatre étapes:
- jeunesse (de 5 à 25 ans),
- mariage et activité (25 à 50 ans),
- retraite (de 50 à 75 ans), les parents vivent en cohabitation avec leurs enfants et petits-enfants et se consacrent au domaine du spirituel. A 60 ans, c'est le second "mariage" symbolique (avec la même femme). Cette fois, l’homme est en blanc et la femme en jaune. Le fils, généralement l'aîné, prend alors en charge tous les aspects matériels de la vie. Il est donc essentiel que chaque famille ait au moins un fils, trop de filles sont, de ce fait, craintes et la dernière parfois abandonnée.
- et renoncement pour finir.
Après 75 ans, les sâdhu ou renonçants, se retirent du monde pour devenir ermites.
Les sâdhu ou sanyasin sont des ''renonçants'' (souvent shivaïtes) qui ont trouvé la sagesse dans l'ascèse, libres, errant sur les routes et faisant de temps à autre étape dans des ashrams (ermitages et lieux de retraite) lors de la mousson. Ainsi vivent-ils dans l'attente de leur délivrance du monde. Ils expriment leur détachement de ce monde par la cendre dont ils se couvent le corps, ce corps qui se consume à petit feu et qui exceptionnellement ne sera porté au bûcher mais enterré à leur mort pu jeté dans un fleuve sacré, comme le Gange à Bénarès.
 En retournant vers l'endroit
où sont parqués les rickshaws nous traversons un petit marché tout près de
l'endroit où les pauvres sont installés, attendant des offrandes. A 10H30,
nous voici repartis vers l'hôtel et une demi-heure plus tard nous y
sommes. Il ne reste qu'à payer la course en y ajoutant une petite gratification
bien méritée.
En retournant vers l'endroit
où sont parqués les rickshaws nous traversons un petit marché tout près de
l'endroit où les pauvres sont installés, attendant des offrandes. A 10H30,
nous voici repartis vers l'hôtel et une demi-heure plus tard nous y
sommes. Il ne reste qu'à payer la course en y ajoutant une petite gratification
bien méritée.
Ce que nous avons vu ce matin ne nous a pas retournés comme on pouvait s'y
attendre et nous aurons le temps de déjeuner tranquillement puisque c'est à 13H
que le chauffeur vient nous chercher pour nous conduire à l'aéroport Lal
Bahadur Shastri...
![]() Comme pour le trajet entre Khajuraho et Bénarès, nous prenons
le vol 9W2424 de la compagnie Jet Airways sur Boeing 737-800. Décollage
comme prévu à 15H25 pour une durée de vol d'une heure trente... Pour les
passagers se rendant à Delhi, c'est une escale seulement.
Comme pour le trajet entre Khajuraho et Bénarès, nous prenons
le vol 9W2424 de la compagnie Jet Airways sur Boeing 737-800. Décollage
comme prévu à 15H25 pour une durée de vol d'une heure trente... Pour les
passagers se rendant à Delhi, c'est une escale seulement.